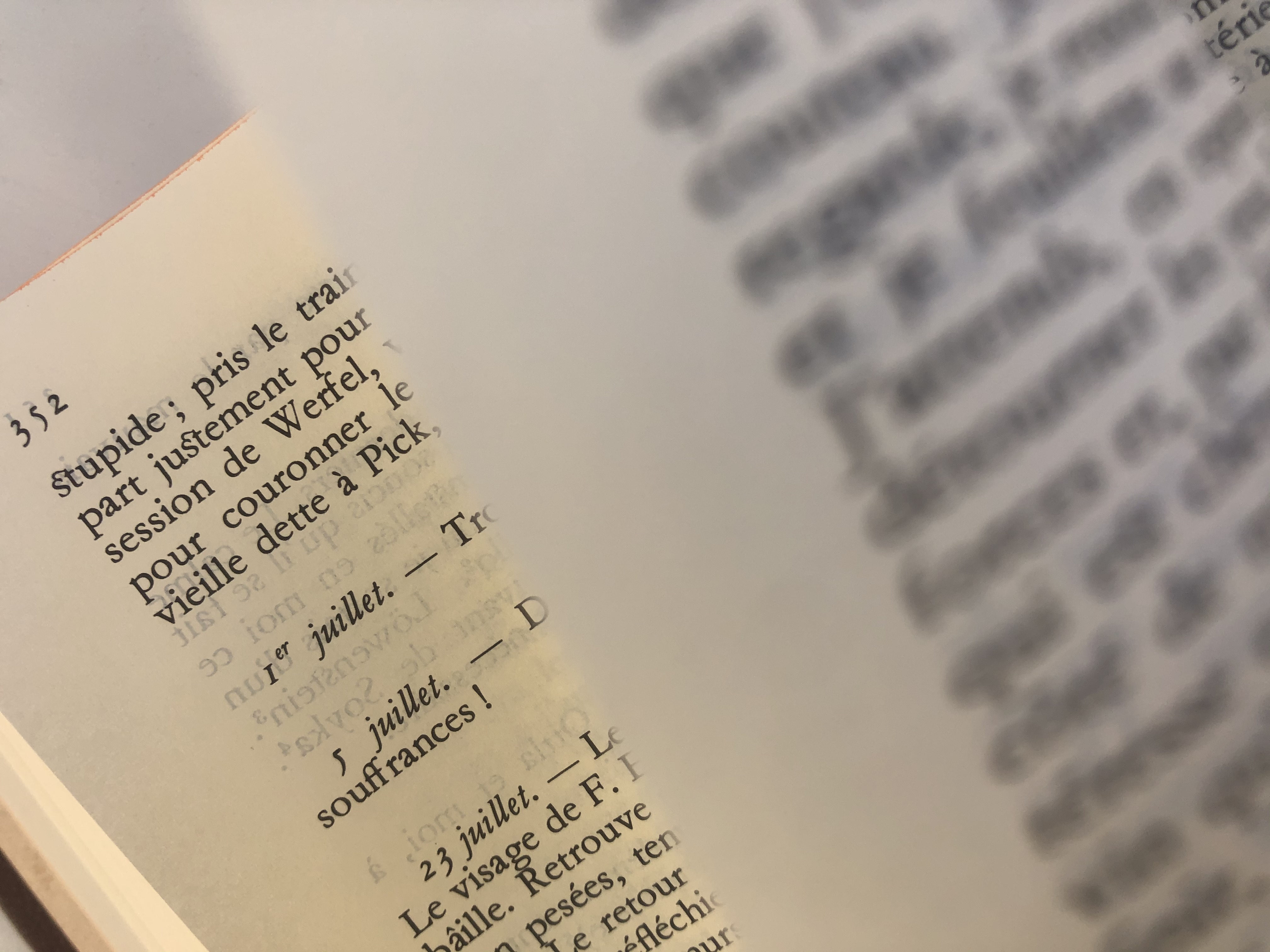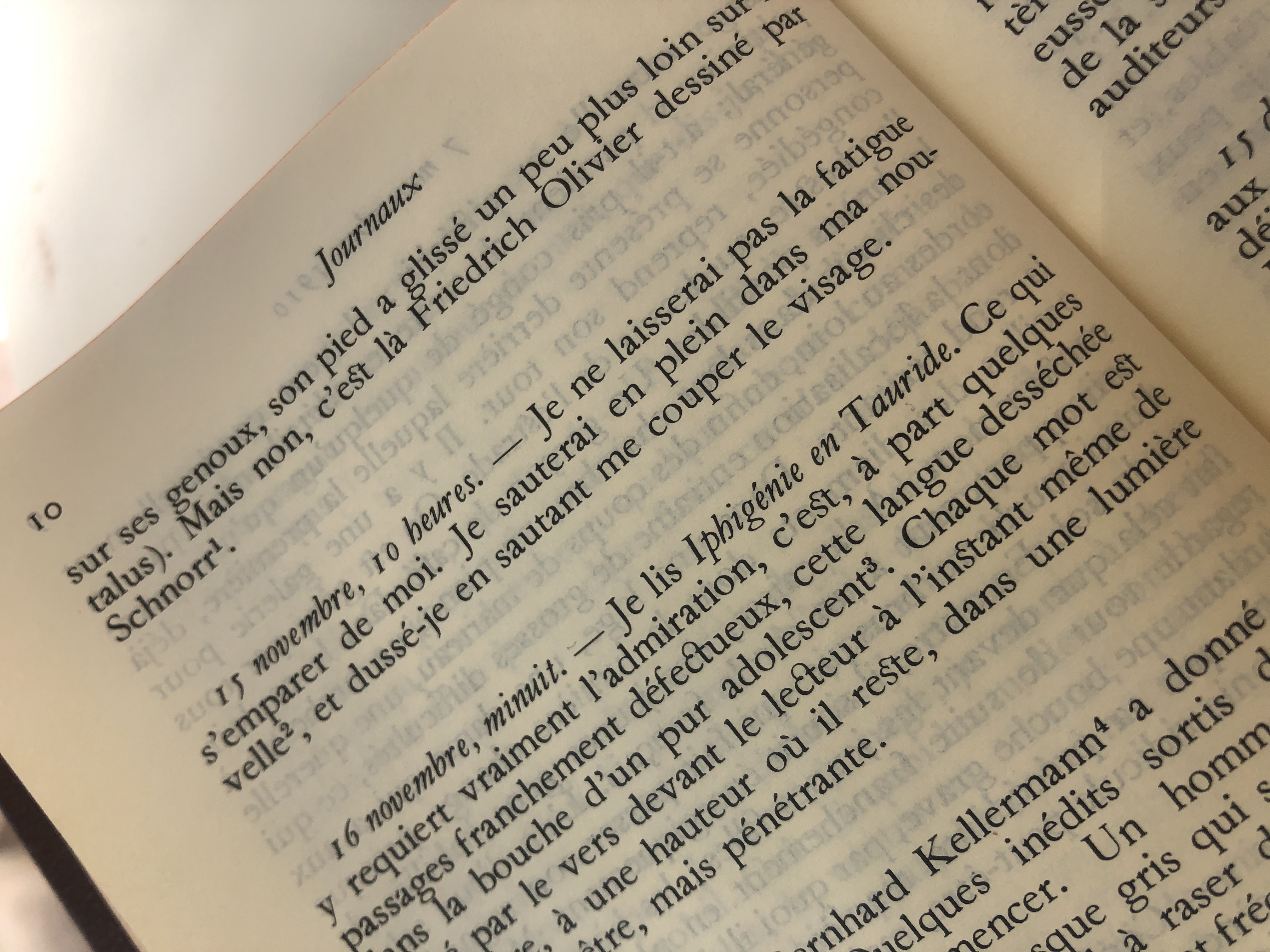Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog) > bien qu’on sache que cela se paye
bien qu’on sache que cela se paye
mercredi 8 avril 2020

31 janvier. — Jardinage, aucune issue.
Un combat dans lequel il n’y a aucun moyen, à aucun stade de l’action, d’obtenir une couverture. Et bien qu’on le sache, on l’oublie toujours. Et quand on ne l’oublie pas, on cherche néanmoins la couverture, à seule fin de se reposer en cherchant et bien qu’on sache que cela se paye.
Kafka, Journal
Rien que des rêves interrompus encore : je ne sais pas si ce sont des rêves ou des souvenirs de rêves ; l’impression de déjà-vu est permanente comme un apprentissage en profondeur et sournois de ce dont est tramé le monde chaque jour ces jours. Les phrases qui sortent de la radio le matin, le ton joyeux et soigné pour dire les morts comme si c’était des chiffres : pour débiter les chiffres et dire que ce sont des morts — me lancent dans le jour avec cette armure dont je ne me déferai que le soir tard, quand il faut se jeter dans les rêves, leurs fatigues d’avance, toujours interrompues.
L’interruption est le rythme de la réalité. Quand un homme politique prend la parole, c’est à cette interruption qu’il la prend. Personne ne peut penser ces semaines, et les journaux n’ont jamais autant publié de penseurs et de pensées. Elles convergent toutes, se complètent, se prolongent. Et comme chacun se fait éditorialiste de lui-même et de la situation, tous montent en généralité des solitudes qui se fracassent les unes sur les autres en s’annulant.
La seule pensée valable serait celle qui prendrait en défaut le monde.
Journal de Kafka traversé au hasard des pages et sans rien suivre de l’ordre, de la vie, ne surtout pas consulter les notes de bas de page qui ne pourraient être que désespérantes. Partout, lire la fatigue : celle qui accable, soulage, rassure, explique, consterne, échoue sur d’autres fatigues encore : le mot est à chaque ligne, avec celui qui dit l’incapacité d’écrire davantage que deux lignes. mpuissance qui n’est pas impouvoir : plutôt regard intraitable sur ce poids dont ill faut se débarrasser (sur quiconque, homme ou animal, passe devant soi ?) — et aller.
Ce journal est une arme plus labile, plus utile que toutes choses : elle ne s’ajuste pas à soi, c’est le contraire : elle est souvent injuste, cruelle, elle ne console pas. Elle est intempestive, ne manque jamais la cible, parce qu’elle lève immédiatement cette cible. Elle témoigne pour l’interruption. De nouveau à la radio : ces nouvelles de Chine qui ce matin ouvre les routes ; accents d’admiration. On rappelle à quel prix, mais comme en passant — les téléphones contrôlés, les confinements qui sont des emprisonnements, le biopouvoir exercé comme une intimidation. On a le droit d’aller dans la vie pourvu qu’on donne la preuve à chaque carrefour de répondre aux critères. Dans le Wuhan, les klaxons sur les routes dégagées ce matin sont d’étranges avertisseurs de lendemains insidieux. Le prix à payer dit aussi la dette à contracter.
Il a fait presque chaud hier : et alors ? Le ciel tombe sur nous sans nous toucher jamais.
Hier soir, deux heures dans le mois de septembre 1792. Tout reprendre. Tourner autour du mot de massacre, tâcher de porter l’assaut sur lui, le prendre à revers pour prendre à revers l’histoire. J’ai arrêté quand j’entendais les cris dans les prisons et dans la salle de la Commune insurrectionnelle, le ton dans la voix lasse de Robespierre, les regards qui se tournent vers lui, l’implorent ou l’encouragent ; je me suis couché quand j’étais l’un de ces regards — c’est dire la fatigue, c’est dire mon échec.
Dehors, sur le sol, les ombres écrivent aussi, et dans l’agitation des arbres, à la surface du monde, le sismographe récite la seule leçon qui vaille : le trouble ne sait pas vers où il va, et s’il évite le péril en s’agitant ou s’il va sa rencontre, s’il danse sur place ou s’il croit aller au-devant du réel : les ombres sur le sol trace des signes qu’on ne sait pas lire et qu’on prend pour le hasard : on se jette sur les livres et on y voit du sens partout où il n’y a que de l’encre, et des gestes trop précis pour parer les coups du monde.
Si le monde n’est plus qu’une gigantesque insulte et qu’une dérisoire et macabre plaisanterie, c’est parce qu’en lui parlent ceux qui se prennent pour le vent et qui ne sont que des ombres que le soir bientôt va recouvrir : eux penseront encore qu’ils sont la nuit sur le dehors, la nuit toute crue et plane, qu’ils sont de toutes choses la source et la fin. Le monde en arrêt respiratoire. Ils ne savent pas qu’après le souffle coupé, l’aube n’est pas le revers de la nuit, mais son interruption radicale. À midi, le soleil à la verticale du sol cachera l’ombre sous leurs pieds : ils ne pourront plus fuir alors.
–