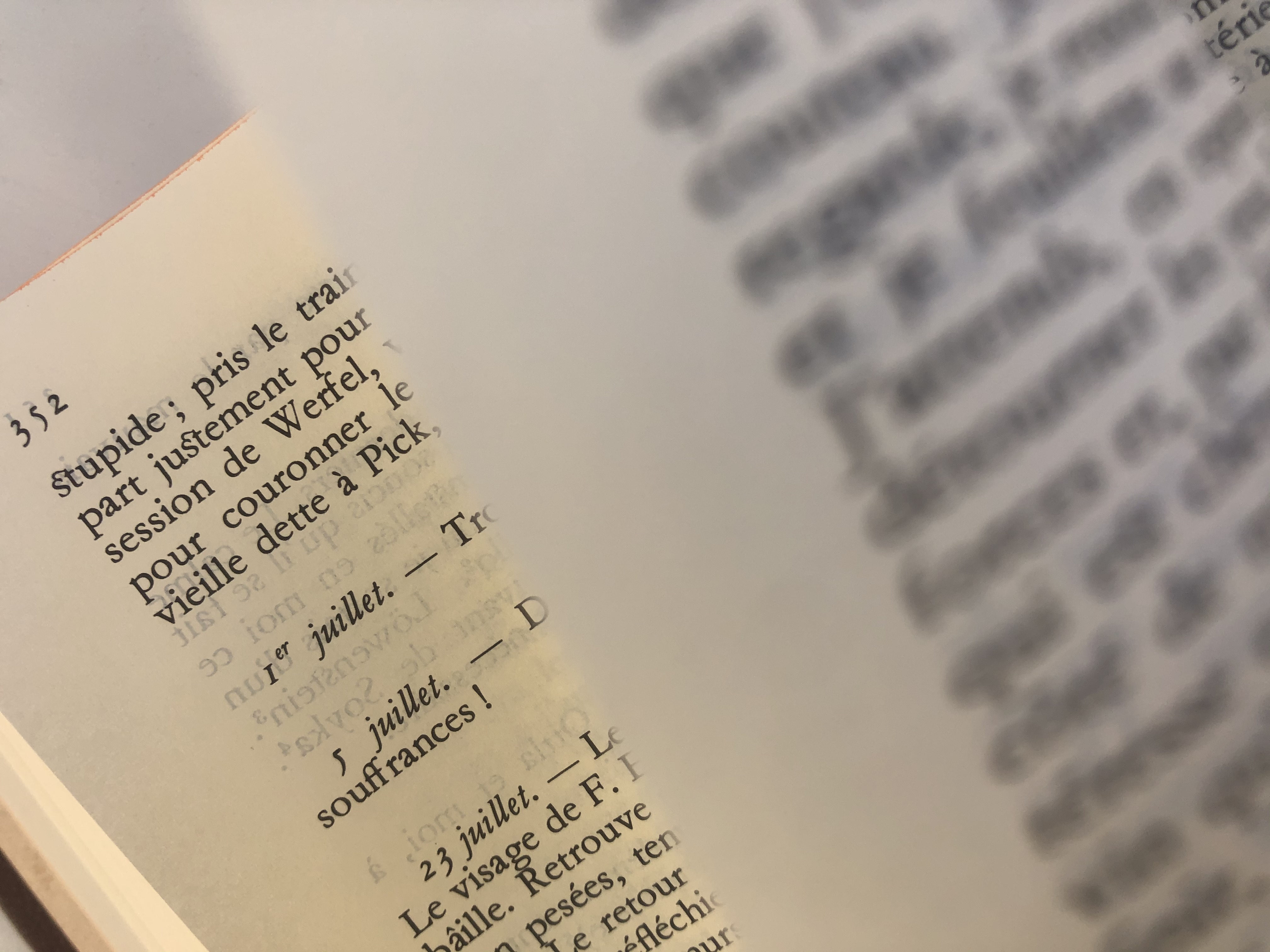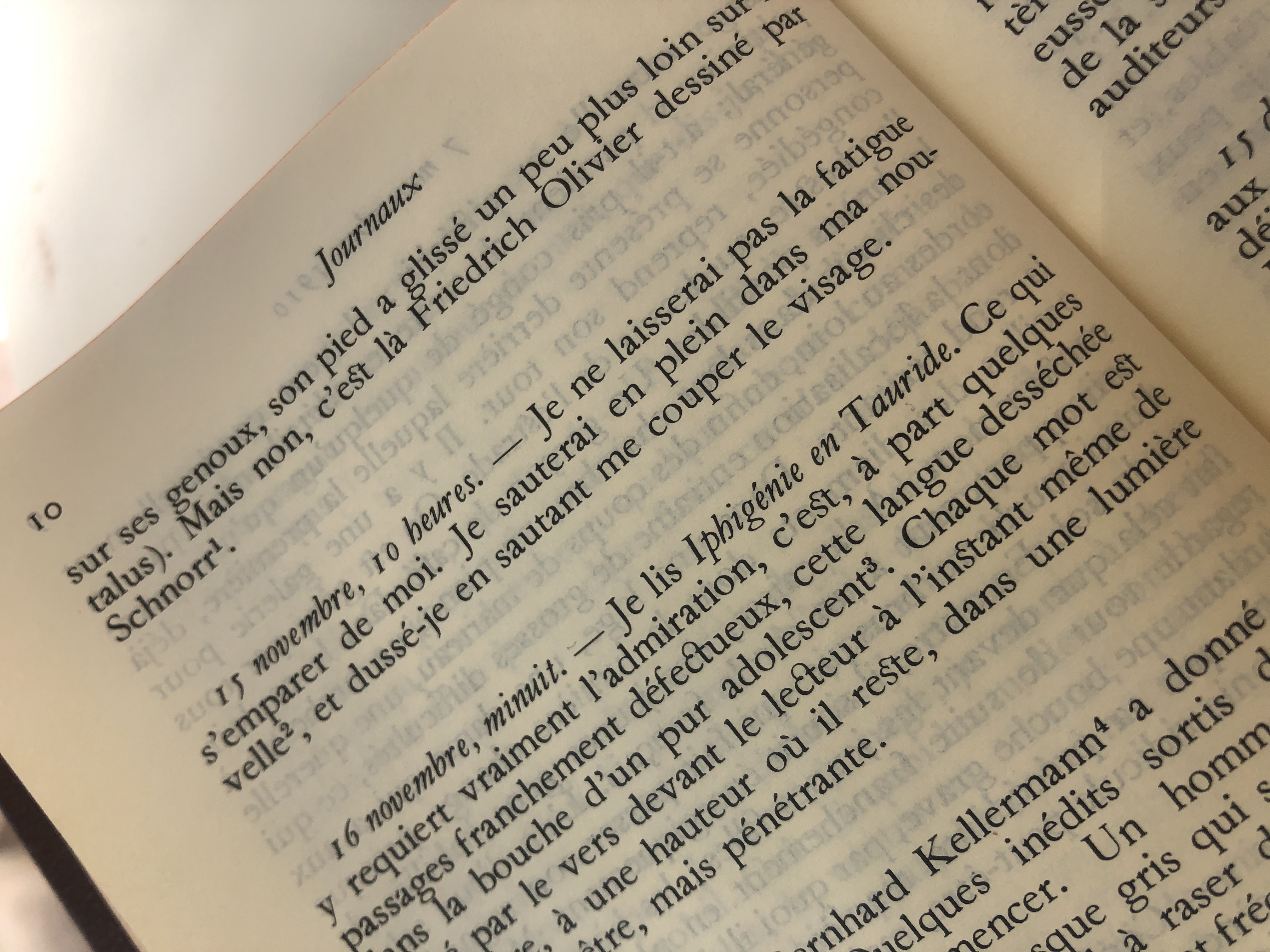Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
-
au-delà des fondations, la terre nue
jeudi 9 avril 2020

2 février 1920 — Ma cellule – ma forteresse.
Ce qu’il empêche de se lever est une certaine pesanteur, le sentiment d’être à l’abri quoi qu’il arrive, le pressentiment d’un lieu de repos qui lui est préparé et n’appartient qu’à lui ; ce qui l’empêche de rester couché est une inquiétude qui le chasse de sa couche, sa conscience, son cœur qui bat interminablement, sa peur de la mort et son besoin de la réfuter, tout cela l’empêche de rester couché et il se relève. Ces hauts et ces bas, ainsi que quelques observations rapides et insolites faire par hasard sur ses chemins, constitue sa vie
Kafka, Journal
Du soir au soir, en passant par cette lumière précise qui traverse le milieu du corps, vers 17h (chaque jour, passer au même endroit de cette ville et la prendre au passage — je ne dirai pas où) la révolution de la terre n’accomplit que de l’attente, celle qui pèsera dans la balance quand le monde nous sera rendu. Lecture de Kafka, se laver à grandes eaux par l’intraitable : l’incapable de compromis, l’absolu en exigence et sans romantisme, sans arrière-monde hormis l’obsession d’un paradis à la fois devant soi et déjà perdu. La vie au présent continu.
Ordinateur saturé : rien ne veut plus entrer. Je l’ai pourtant vidé. Plus je le vide, plus il est rempli. Y lire une image de ce temps : mais laquelle ?
Hier encore : les cavaliers dans les rues désertes. Le futur est tout entier voué au passé : il n’y a rien à attendre de lui, et tout arracher, tout prendre, tout voler quand il sera temps et il est temps chaque heure.
Deux semaines ont effacé cinq années de croissance — dit la radio. Mais on a croisé deux rorquals au large de Marseille. J’apprends le nom de ces bêtes, pourtant deuxième plus massif animal de la création, et restées inaperçues toutes ces années. Que l’homme ait déserté ce monde au moment où elles reviennent est sans doute une coïncidence (non). Du plus immense à l’être vivant le plus infime, rorqual et virus, animal sauvage et indomesticable reprennent possession des lieux.
Écouter infiniment le Stabat Mater d’Arvo Pärt : pourquoi ?
Il y a en tout dans ces jours quelque chose qui résiste à la résignation et c’est peut-être le plus miraculeux.
Neuf avril : il y a soixante douze ans, à Metz. Hier.
Ce qui reste d’une œuvre, par l’homme, la pensée qu’il nous laisse non en héritage mais pour usage : ce javelot lancé, qu’on ramasse, qu’on jette plus loin, avec les forces qui nous restent.
Je relis au hasard La Fuite à cheval très loin dans la ville pour chercher un passage qui peut-être ne s’y trouve pas : l’un des personnages écrit dans sa cellule des phrases définitives que personne ne lira, décisive sur sa vie, le destin de tous : et que personne ne lira. Personne, dans la fiction. Mais on est de l’autre côté de la fiction, dans cette vie qui possède peu de privilège, parmi lesquels : tenir ce livre et lire ces phrases. Celle-ci :
Je regarde le sol, et j’y vois, au-delà du ciment et des pierres, et des fondations, la terre nue ; c’est que je vais mourir.
Ô yeux qui ont le soleil en mémoire, yeux noyés d’eau sombre, contre qui suis-je en train de me débattre ?
Maintenant, mon regard aussi se tourne sur lui-même.
-
bien qu’on sache que cela se paye
mercredi 8 avril 2020

31 janvier. — Jardinage, aucune issue.
Un combat dans lequel il n’y a aucun moyen, à aucun stade de l’action, d’obtenir une couverture. Et bien qu’on le sache, on l’oublie toujours. Et quand on ne l’oublie pas, on cherche néanmoins la couverture, à seule fin de se reposer en cherchant et bien qu’on sache que cela se paye.
Kafka, Journal
Rien que des rêves interrompus encore : je ne sais pas si ce sont des rêves ou des souvenirs de rêves ; l’impression de déjà-vu est permanente comme un apprentissage en profondeur et sournois de ce dont est tramé le monde chaque jour ces jours. Les phrases qui sortent de la radio le matin, le ton joyeux et soigné pour dire les morts comme si c’était des chiffres : pour débiter les chiffres et dire que ce sont des morts — me lancent dans le jour avec cette armure dont je ne me déferai que le soir tard, quand il faut se jeter dans les rêves, leurs fatigues d’avance, toujours interrompues.
L’interruption est le rythme de la réalité. Quand un homme politique prend la parole, c’est à cette interruption qu’il la prend. Personne ne peut penser ces semaines, et les journaux n’ont jamais autant publié de penseurs et de pensées. Elles convergent toutes, se complètent, se prolongent. Et comme chacun se fait éditorialiste de lui-même et de la situation, tous montent en généralité des solitudes qui se fracassent les unes sur les autres en s’annulant.
La seule pensée valable serait celle qui prendrait en défaut le monde.
Journal de Kafka traversé au hasard des pages et sans rien suivre de l’ordre, de la vie, ne surtout pas consulter les notes de bas de page qui ne pourraient être que désespérantes. Partout, lire la fatigue : celle qui accable, soulage, rassure, explique, consterne, échoue sur d’autres fatigues encore : le mot est à chaque ligne, avec celui qui dit l’incapacité d’écrire davantage que deux lignes. mpuissance qui n’est pas impouvoir : plutôt regard intraitable sur ce poids dont ill faut se débarrasser (sur quiconque, homme ou animal, passe devant soi ?) — et aller.
Ce journal est une arme plus labile, plus utile que toutes choses : elle ne s’ajuste pas à soi, c’est le contraire : elle est souvent injuste, cruelle, elle ne console pas. Elle est intempestive, ne manque jamais la cible, parce qu’elle lève immédiatement cette cible. Elle témoigne pour l’interruption. De nouveau à la radio : ces nouvelles de Chine qui ce matin ouvre les routes ; accents d’admiration. On rappelle à quel prix, mais comme en passant — les téléphones contrôlés, les confinements qui sont des emprisonnements, le biopouvoir exercé comme une intimidation. On a le droit d’aller dans la vie pourvu qu’on donne la preuve à chaque carrefour de répondre aux critères. Dans le Wuhan, les klaxons sur les routes dégagées ce matin sont d’étranges avertisseurs de lendemains insidieux. Le prix à payer dit aussi la dette à contracter.
Il a fait presque chaud hier : et alors ? Le ciel tombe sur nous sans nous toucher jamais.
Hier soir, deux heures dans le mois de septembre 1792. Tout reprendre. Tourner autour du mot de massacre, tâcher de porter l’assaut sur lui, le prendre à revers pour prendre à revers l’histoire. J’ai arrêté quand j’entendais les cris dans les prisons et dans la salle de la Commune insurrectionnelle, le ton dans la voix lasse de Robespierre, les regards qui se tournent vers lui, l’implorent ou l’encouragent ; je me suis couché quand j’étais l’un de ces regards — c’est dire la fatigue, c’est dire mon échec.
Dehors, sur le sol, les ombres écrivent aussi, et dans l’agitation des arbres, à la surface du monde, le sismographe récite la seule leçon qui vaille : le trouble ne sait pas vers où il va, et s’il évite le péril en s’agitant ou s’il va sa rencontre, s’il danse sur place ou s’il croit aller au-devant du réel : les ombres sur le sol trace des signes qu’on ne sait pas lire et qu’on prend pour le hasard : on se jette sur les livres et on y voit du sens partout où il n’y a que de l’encre, et des gestes trop précis pour parer les coups du monde.
Si le monde n’est plus qu’une gigantesque insulte et qu’une dérisoire et macabre plaisanterie, c’est parce qu’en lui parlent ceux qui se prennent pour le vent et qui ne sont que des ombres que le soir bientôt va recouvrir : eux penseront encore qu’ils sont la nuit sur le dehors, la nuit toute crue et plane, qu’ils sont de toutes choses la source et la fin. Le monde en arrêt respiratoire. Ils ne savent pas qu’après le souffle coupé, l’aube n’est pas le revers de la nuit, mais son interruption radicale. À midi, le soleil à la verticale du sol cachera l’ombre sous leurs pieds : ils ne pourront plus fuir alors.
–
-
détruire le monde
mardi 7 avril 2020

5 février 1918 — Bonne matinée, impossible de tout se rappeler.
Détruire ce monde ne serait une tâche que, premièrement, s’il était mauvais, c’est-à-dire s’il contredisait notre sens, et si, deuxièmement, nous étions en mesure de le détruire. La première chose nous apparaît telle, de la deuxième chose nous ne sommes pas capables. Nous ne pouvons pas détruire ce monde, car nous ne l’avons pas édifié comme quelque chose d’indépendant, nous nous sommes égarés en lui ; bien plus : ce monde est notre égarement, mais en tant que tel, il est déjà quelque chose d’indestructible, ou plutôt quelque chose qu’on ne peut détruire qu’en l’achevant et non par le renoncement ; il est vrai que cet achèvement peut être aussi qu’une succession de destructions, mais à l’intérieur de ce monde.
Kafka, Journal
Que ce monde n’était pas vivable ; qu’il nous avait accoutumés à lui comme une peau : que s’arracher la peau nous laissait à nu, et au sang, et à l’os : qu’après l’os qu’on rongerait reviendrait la soif et d’autres profondeurs. Que la haine du monde était devenue celle de toutes choses qui portaient son nom et son sceau ; que la mélancolie n’était plus seulement une maladie, mais la seule attitude digne face à tout ce qui s’effondre, cela qui fabriquait la réalité qu’on nommait ville et les projets en elle. Qu’on s’endormait d’épuisement et de rage, dans la tristesse. Qu’on se levait plus fatigué encore. Qu’il fallait l’eau très chaude le matin et longue et lente pour laver tout cela : que rien ne partait, seulement de la peau morte. Que le jour recommençait chaque jour : que c’était cette vie, déchirée par instants d’éclats de joie plus intenses encore d’être abolis dans l’instant.
Le confinement n’est pas la période exceptionnelle de l’époque, mais son exacerbation. La société de contrôle et de surveillance s’exerce à merveille ; les êtres se découvrent dans la solitude au miroir de leur abandon ; ils pensaient pouvoir enfin trouver du temps : ils ne saisissent que de l’ennui : savent bien qu’ils sont chez eux enfermés — et ceux qui sont enfermés dehors se retrouvent face à la sauvagerie pure de forces de l’ordre jamais aussi bien entraînées que pour ces jours où elles contrôlent ceux qui passent sans distinction pour leur demander où ils viennent et où ils vont. Peu importe s’ils n’ont croisé personne : importe qu’ils auraient pu le faire.
Ce que ces semaines dévoilent et confirment, c’est que la militarisation de l’espace social, urbain, sanitaire témoigne d’une guerre faite surtout à ceux qui respirent dans ces espaces l’air qui ne serait pas soumis à une autorisation dérogatoire.
On dit la vengeance stérile : on dit la colère toujours injuste, toujours excessive ; on disait la radicalité toujours trop radicale. On regarde l’adversaire, celui qui tient encore le manche. En matière de radicalité, il nous rend des points. On découvre qu’on n’était pas assez vengeur à son égard, pas assez injuste et excessif.
Il paraît que ce temps serait voué à l’indicible : jamais autant parcouru pourtant de textes qui disent l’impossible de dire — ce n’est pas seulement une affaire de marin, cette manie de raconter des histoires, ou c’est parce qu’il y a partout la tentation de larguer les amarres.
Je salue la mer quand je le peux et ce n’est pas par amour : mais parce que l’envie furieuse de l’envers du dedans est insatiable ; parce que d’ici je vois la ville. Parce que la mer se bleuit ces jours et parce que les vagues ne heurtent rien dans l’espace qu’elle même, qu’elle semble se dégager, laisser libre cours à des délires, qu’en elle se devinent des profondeurs qui sont autant de menaces que de promesses : qu’elle est inaccessible et désirable, qu’elle proche dans le lointain, que New York est de l’autre côté du ciel.
Ça y est : ils en sont à étudier nos rêves. M’ont toujours fasciné les rêves de ceux qui vivent dans un pays étranger : ce moment où leurs rêves se mettent à parler cette langue — le verrou qui saute. On en est là ? Quand le verrou saute, d’autres portes s’ouvrent, on entre, il n’y a personne dans la pièce, la porte claque derrière nous, la nuit est immense ; on tend les bras, on avance : on trébuche sur un cadavre. Ce n’était que nous.
Autre rêve : je l’ai oublié.
Cette image quand je remonte dans mes jours : dans cet immeuble, mon site est hébergé (au moins administrativement). À quoi tient le lien avec le monde ? Pas à celui-là. Il n’y a pas de monde sans les relations qui nous séparent de lui. Il n’y a pas de connexion à distance. Il n’y a pas de continuité pédagogique par l’écran. La métaphore in absentia est censé laisser béante l’énigme : or il n’y a pas d’énigme qui serait une solution. Il n’y a pas de possibilité de survivre à ce monde, sauf à le réduire en poussière avant nous. C’est une course contre la montre qui durera toute cette vie. Dans le journal de Kafka, la page sur la destruction du monde n’est pas seulement désespérée : elle sauve, parce qu’elle appelle à détruire en nous ce que le monde a fait de nous. On n’a trop peu d’occasions radicales de voir le monde tel qu’il est. Détuire ce que le monde a fait de nous : ça ne concerne pas le monde d’après, ça commence maintenant.
-
rêve des conjurations
dimanche 5 avril 2020

Longuement couché, insomnie, je prends conscience du combat.
Dans un monde de mensonges,
le mensonge n’est même pas supprimé par son contraire,
il ne l’est que par un monde de vérité.La souffrance est l’élément positif de ce monde,
c’est même le seul lien entre ce monde et le positif.Kafka, Journal, 4 février 1918
5 avril 2020Arnaud Maïsetti/Journal
Lire [1] ces derniers jours, soirs, mille lectures du Decameron. Parmi celles-ci : que l’épreuve de la Peste ne fut pas tant la guerre des hommes contre la maladie, que le lent apprentissage de la conjuration de la peur. Conjurée, la peur de la mort pouvait bien s’étendre à toutes formes de terreur qu’on avait su dominer, traverser, vaincre puisqu’on avait été épargné par le sort. Après avoir conjuré la peur de la mort, les hommes surent conjurer la peur de leurs Seigneurs. Ils n’avaient plus peur de rien et plus rien à perdre : ils avaient survécu à la terreur de mourir.
La conjuration est bien plus précieuse que la prise de conscience : s’il suffisait d’avoir conscience (d’être dominés, d’être insultés, d’être plus nombreux, d’être), les émeutes auraient depuis longtemps été des soulèvements. Devant la mer depuis la plage, on possède des pensées que la tempête nous arrache brutalement. La conjuration n’a pas lieu avant la plus haute vague sur le point de se fracasser sur le radeau, mais juste après.
Après ? On n’est même pas avant, on est au dedans du ressac.
Et pendant que tout est sur le point de chavirer, que New York étouffe après Rome, ici comme partout les mensonges étalent leur arrogance et la peine est double : le pouvoir dit vouloir « réévaluer sa doctrine » sur les mesures de protection. La langue française sait aussi être obscène quand elle parle le verbe haut des puissants. Le faux n’est plus un moment du vrai, mais une doctrine réévaluable à outrance. C’est cracher sur les morts et les agonisants.
Le vernis qui se détache révèle : ceux-là qui parlent en notre nom crachent plutôt.
Monde qui craquèle sous lui-même.
Et il faudrait regarder la réalité en face : disent-ils depuis toujours, pour justifier les chiffres et les lois. Réalité qui asphyxie, qui appelle surtout aux fictions, les grands récits dont l’Histoire nous aurait vaccinés ? On n’a pas besoin de vaccin, mais de récits qui raconteraient les chemins détournés de la réalité, ou qui, la doublant, l’appelleraient ; on n’a pas besoin de cette réalité qui cerne comme sur un visage les contours déjà là du toujours : mais des fables qui rendraient pensables des expériences de vies inventées.
Ce mot de réalité comme dernier argument : comme il est criminel.
La vérité est concrète : Brecht avait gravé la phrase au couteau, sur la poutre qui tenait le toit debout, au-dessus de sa table de travail. La vérité concrète, c’est une courbe exponentielle, la croissance des chiffres qui n’iront enrichir aucun actionnaire ; c’est la couleur lavée du ciel sur les villes sans voiture ; c’est les animaux sauvages dans les centres vidés ; c’est le nom des morts que des mensonges d’État ont fait graver à la hâte dans des funérariums déserts ; c’est souffrir dans des comas artificiels d’où personne ne sort indemne. Est-ce qu’on rêve en salle de réanimation ? Et quelles formes ont ces rêves ? Quel monde sortira de ces rêves ? Quelle réalité sera vengée ? De quelle conjuration des rêves ces jours à venir sortiront-ils vainqueurs ?
-
la mort, mais pas celle-ci
samedi 4 avril 2020

Matin ensoleillé.
L’évolution humaine — une croissance de la puissance de mort.
Notre salut est la mort, mais pas celle-ci.Kafka, Journal, 26 février 1918
4 avril 2020Arnaud Maïsetti/Journal (2020)
Fatiguer la fatigue — chaque jour, la guerre qu’on mène est d’abord surtout intime, elle se livre contre soi. Cette vie qu’on porte est peut-être une maladie auto-immune. Le monde continue de battre le rappel des troupes de sa propre déroute.
Là-bas, l’antiterrorisme pour détecter le malade : plus loin, des QR codes pour filtrer l’entrée des magasins ; bientôt, la géolocalisation pour surveiller et guérir : partout l’espace public militarisé comme avant-garde possible du futur, projet d’un monde neuf. Gouverner est depuis toujours soumis à la tentation de contrôler les populations ; d’enseigner l’obéissance à ce contrôle ; d’organiser la fin de la politique en fabriquant les conditions de consensus généralisé à des causes sacrées. L’époque est aux essais cliniques : politiquement aussi. Cette fois, le monde est l’échelle appropriée à des méthodes d’envergure. On remplace l’école et la médecine par des connexions à distance : la fonction phatique du langage est la seule qui surnage. Tout le monde déteste la police et zoom. Pendant ce temps, on massacre ce qui reste du droit du travail, puis du travail tout court, du droit ensuite, de ce qui reste enfin.
Qu’à force de massacre, le monde se défend comme il peut, et il peut fort.
Antidotes : un film de Bresson, dans le milieu de la nuit ; Au Hasard Baltazar — et le visage d’Anne Wiazemski, son regard têtu, obsédant. Rancière plongé dans Les Temps modernes, la férocité de dévisager les ruses de la domination. Brecht, son ABC de la Guerre, puisque nous y sommes : et comment travailler en sourdine d’autres formes de guérilla.
Il y a la chaleur soudain, marcher les bras nus.
Il y a aussi : le soir qui a mordu sur le jour, aura avancé d’une heure sur la lumière pour renverser l’ordre établi. Depuis trois jours, les jours sont plus longs que les nuits, et cela donne une idée du miracle que produit le temps chaque seconde.
Évidemment ma montre s’est arrêtée : j’ai perdu toute notion de l’heure, mais pas l’habitude de regarder au poignet et d’être pris de panique à l’idée que j’ai perdu cette montre. J’accepte les signes, pourvu qu’ils n’aient aucun sens.
Par exemple : les arbres en fleurs.
Autre exemple : l’abîme partout. Et impossible de savoir ce qui surgira de ce long couloir de mort qui pue l’association de midazolam ou de propofol et d’un morphinique, l’éther partout, la justice nulle part, et le manque de curare. Fatiguer la fatigue est une tâche à temps plein : on ne manque pas de minutes, mais de force. On pense aux villes vidées [2] ; on pense à des pensées pleines en retour ; on pense que tout ça va finir, on pense à ce qu’on fera ensuite ; on pense qu’on ne fera pas la même chose ; on pense que le monde est devenu une routine qui l’a transformé en cadavre ; on pense à ceux qui se préparent déjà à ventriloquer ce cadavre ; on pense à des pensées sauvages, érotiques, sereines et féroces ; on pense à ce qui manque et qu’il faudra accomplir ; on pense à la fin de l’automne 1792 ; on pense à d’autres pensées inavouables, par exemple : celle-ci.-
-
l’air et le silence d’avant le monde d’après
vendredi 3 avril 2020

Allons, ouvre toi. Que l’être humain sorte.
Aspire l’air et le silence.Kafka, journal, décembre 1917
3 avril 2020Arnaud Maïsetti/Journal (2020)
Maintenant a toujours autant lieu qu’hier : l’avenir n’a aucun avenir, le temps est jeté devant nous comme s’il était derrière l’horizon. Les dates reculent : les rendez-vous s’annulent. À mesure que le temps avale du temps, deux semaines ont fini par fabriquer cet événement considérable. Un million de personnes affectées par la maladie. Le phénomène est plus mondial que tout ce que le monde a pu connaître. Les quatre murs autour reçoivent leur lot de poussière. Les cheveux poussent dangereusement. Le sens de l’histoire ne fait signe vers rien d’autre qu’un lendemain provisoirement sans cesse ajourné. Maintenant jaunit.
Pendant ce temps qui n’en est pas vraiment un dans le grand ciel dégagé, les insultes continuer de pleuvoir et de prouver s’il était besoin (non) l’abjection du pouvoir : aujourd’hui, sur l’air du c’est bien fait pour eux, le préfet de Police crache sur ceux qui dans les salles de réanimation ont les poumons reliés à la machine : le soir il présentera des excuses plutôt que sa démission, et on aura presque pitié pour son indignité (c’est faux : peu de pitié, beaucoup de rage : elle maintient vive la douleur des jours, celle qui fera les jours d’après).
Le monde d’après : l’expression est partout. Le monde d’avant a besoin de lui pour s’inventer. Décidément, rien ne serait pire qu’un retour à l’ordre. Ni le retour ni leur ordre ne saurait sauver autre chose que des meubles qu’il faudra surtout renverser pour rendre le monde respirable : vivable.
Ce qui est condamné ? Une partie de l’ordre ancien, qui pourtant ne cesse d’occuper l’espace seul qui reste (les ondes). À la radio, l’homme qui parle dit que ces jours lui rappellent mai 68. Éteindre la radio soulage, un peu.
Et lire Rancière soulève. C’est le propre des grands événements : qu’ils rendent paranoïaque d’une part — tout fait signe vers eux —, et fabrique de l’irréversible — rien ne sera comme avant, la preuve, tout ce qui a été écrit avant est frappé d’une obsolescence radicale, ou plutôt comme s’il s’en trouvait daté, parfois pour le meilleur. Premier chapitre de ses récents Temps modernes. Cette force de Rancière de renverser les dualismes. Et cette puissance de penser dans le temps long les structures qui organisent les oppositions. Par exemple, le partage qu’il opère entre ceux qui ont le temps et en jouissent, et ceux qui n’ont pas le temps parce que le travail n’attend pas. Ou comment l’Histoire — qui fabrique des faits les uns après les autres — est le prolétaire du récit, quand la fiction — qui rêve les possibles de lui-même — se paie le luxe de sortir du temps pour l’envisager dans ses au-delà.
Lecture en temps de confinement qui rend plus sensible le dépit devant ceux qui s’enthousiasment de profiter de ce temps qui pour refaire leur cuisine, qui pour apprendre l’art de la pâtisserie, le chant des oiseaux. On fait ce qu’on peut, oui : mais qu’on n’oublie pas dès lors de quel côté du partage du temps et de son luxe offert on est. Ici, je n’ai le temps de toute manière que d’être au présent de chaque minute. Le soir, je m’effondre en arrachant quelques mots à l’incompréhensible.
Donner du sens au confinement : ce pourrait être le titre de toutes ces émissions qui remplissent le temps. Le sens n’est pas un don, c’est une fabrique, un choix ?
Dans le journal de Kafka, sa grande fatigue. Ce pourrait être ce qui le fait écrire aussi : opposer à la fatigue une force plus féroce encore, une autre fatigue, celle capable de fatiguer la fatigue. Leçon encore.
Ciel des jours passés : on n’en aura pas la mémoire. Quand on se racontera l’époque, ce sera dans le manque de l’air qu’il faisait, dans le silence des rues quand on s’offrait cet air une petite heure ; quand on se souviendra, la peau aura été à peine effleurée par ces ciels-là. Il y aura la voix d’un préfet de Police, et en moi le journal de Kafka, quelques lignes de Rancière parmi les cris des enfants, et dans la pièce noire, le bruit des touches qui refusant de dégager le sens pour mieux l’inventer de mes doigts, se déchire. Il n’y a pas d’horizon dans ces jours d’attente et de répétition, qui entasse rage, dégoût, désespoir et silence : pas d’horizon, seulement l’acharnement à construire du temps qui saura le transpercer et renverser le désespoir et la rage en monde.
-
d’être fécondée par toi
jeudi 2 avril 2020

La maladie se tient tapie sous toute intention comme sur la feuille de l’arbre. Si tu te penches pour la voir et qu’elle se sente découverte, elle bondit, la maigre et muette diablesse, et au lieu d’être fracassée, elle exige d’être fécondée par toi.
Kafka, Journal, 15 septembre 1920 2 avril 2020Arnaud Maïsetti/Journal (2020)
La moitié de l’humanité serait confinée : et l’autre ? Abandonnée à son sort, vulnérable ou invincible : laissée de côté par le monde qui va ? L’autre moitié de l’humanité est peut-être tout simplement chinoise — idéologiquement confinée. La moitié de l’humanité regarde par la fenêtre le temps qui passe ou qu’il fait, défait ce qui passe, renforce ce qui ne passe pas, ou en travers de la gorge.
Fable de ce capitalisme : un homme rentre dans un cimetière et demande de la terre pour faire pousser des plantes, des fruits. On lui dit qu’il peut la louer, mais qu’il ne pourra en jouir que bien plus tard : quand c’est lui qui, sous terre, fera pousser la terre.
Répétition des jours : chaque matin une insulte du pouvoir. Son crime ne tient pas dans sa défaillance, mais dans sa nature même, celle d’exercer sur la vie en dernier ressort un pouvoir impuissant à fabriquer autre chose que des lois objectives à l’exploitation de la vie. Oui, vraiment : la maladie n’est pas de son fait ; seulement, elle fait tomber le masque de ce monde organisé pour faire l’économie de la vie. Les masques qui manquent sur le visage de ceux qui font face à la mort renvoient implacablement à ce mécanisme des pouvoirs mis à nu : sa logique macabre qui, hors maladie, appliquait sa machine de mort — et maintenant que tout s’efface, tout est clair. Répétition des jours : comme un long et lent mouvement de rétraction, comme une prise d’élan avant l’assaut.
On ne voit jamais de cormorans ici. Il fallait que les hommes abandonnent la grève pour qu’on puisse leur laisser la place, celle qui leur revient. Les voir ouvrir les bras à la ville.
Un jour ou l’autre, c’est la jungle qui gagnera. Plutôt l’autre jour, mais déjà, les prémices.
Les rues ne sont pas vides : elles sont vidées. Au dedans du corps caverneux de la ville résonnent les cris de guerre, non la fausse, la larvée, qu’ils nomment ainsi pour battre le rappel des troupes et le silence qui va avec : mais la guerre qui vient.
En application de l’article trois du décret du vingt-trois mars deux mille vingt prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, je m’autorise chaque jour ce déplacement bref, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour de mon domicile, lié non pas tant à l’activité physique individuelle de ma personne, ou aux besoins des animaux de compagnie que je ne possède pas, qu’à la promenade [3] — et aussi pour éviter de devenir fou.
J’encours pour cela et malgré cet article trois l’amende de deux cent euros désormais pour mise en danger de la vie d’autrui.
Il y a cette pensée terrible de Beckett [4], qui affirmait l’homme libre, oui, mais comme est libre l’homme dans ce bateau qui l’emporte vers l’ouest : et qui est libre de marcher sur le pont, dans le sens inverse du bateau, si cela lui chante. Me voilà exerçant ma liberté de marcheur : sous les insultes de ceux qui passent en voiture à ma hauteur, et dans les yeux desquels je vois une haine absolue, sans rémission possible : je suis pour eux sans doute coupable de meurtres innombrables [5] — entre moi et le ciel, il y aura davantage que la police (la police est là), mais la justice, et la condamnation.
Bateaux laissés presque à l’abandon. Je regarde leur nom comme je le fais sur les stèles, rêvant à des vies perdues, des amours, des joies sublimes et minuscules, oubliées par tous : sur l’un d’eux, celui-ci : vagabond. « Qui erre çà et là. », dit Littré (qui ne se trompera jamais), puis « Déréglé, sans ordre, en parlant des personnes. » Et enfin, particulièrement, et en un sens péjoratif, « personne sans état, sans domicile, sans aveu. »
Littré achève par cette remarque : « Corneille a dit miroirs vagabonds, en parlant des ondulations de la mer où l’on se voit. »
D’ici, on ne voit pas la mer ; elle me sépare de la ville et de toutes choses, de leurs fins et d’un commencement prochain — en attendant, il faudrait s’efforcer de ne pas attendre, d’errer seulement dans le but de trouver, sur le sol ou en soi, l’instrument vrai qui sera à la hauteur des jours à venir, de l’autre côté des cadavres qu’on finira bien par enjamber.
-
nous vivons dans une fausse croyance
mardi 31 mars 2020

Si ce qu’on prétend avoir été détruit dans le paradis était indestructible, ce n’était rien de décisif ; si c’était indestructible, nous vivons dans une fausse croyance. Kafka, Journal, décembre 1917
On répand par hélicoptère de l’eau bénite sur des centaines de kilomètres au nord de l’Inde, on affrète un navire de guerre médicalisé sur Manhattan, on licencie trois cents salariés en une seule visioconférence [6], on meurt toutes les trois minutes à New York, on demande aux habitants de Lagos, Nigeria, sept millions neuf cent trente-sept mille neuf cent trente-deux êtres, à rester chez eux — un tiers est sans abri.
Ce monde est le nôtre, et à grande échelle, la militarisation de la survie organise l’hallucination collective de la panique. Tout est sous contrôle : la preuve, ce sont les usines qui fabriquent des aspirateurs qui prendront en charge la production à marche forcée des respirateurs.
Le sens de l’histoire épouse les courbes exponentielles qu’on lit comme on regarde le futur et envisage le passé. On possède toujours quelques jours d’avance sur l’Italie, et l’Allemagne sur nous. On avance chaque jour dans les jours avec son compte de cadavres à entasser et brûler pour laisser la place. Le pire est toujours le jour d’après. Le sens de l’histoire double sur l’axe des ordonnées tous les sept jours. Le huitième jour, l’interne de réanimation ne se repose pas.
Nous étions imposables, éligibles, contribuables, ou redevables : nous nous révélons confinables. Sommes-nous ainsi accrus d’une propriété existentielle neuve ? Haine de l’intériorité, et plus encore : dehors seul est le possible.
Or, dehors est désormais livré aux flics qui rançonnent. La police montée sillonne le quartier. Il faut ruser pour simplement gagner ce parking vide. Bien sûr, ne mettre personne en danger et ne pas se mettre à la merci du premier éternuement croisé. Mais dans les rues vides, criminaliser une heure de solitude arrachée à ces jours ? Entre nous et le ciel, il n’y aura décidément toujours que la police.
Longue, patiente, et irraisonnée écoute de rap conscient ces jours. Se charger à la colère.
Ce n’est pas l’organisation économique du monde qui a produit la maladie ou l’a répandue. Mais pour la combattre, on se retourne sur ce que cette organisation a négligé, et se révèle la nature de ce monde : on est dépouillé.
Ciel par gros temps qu’on voit arriver, par vent d’est. Ceux qui sont enfermés dehors reçoivent chaque jour de plein fouet l’oubli, l’insulte qu’est la terre pour eux : l’obstination de vivre contre le monde est leçon, puissance par quoi vivre après ces semaines sera seul possible.
À vingt heures, applaudir ceux qui en premières lignes reçoivent les mourants et la charge virale dans leur propre corps : à vingt-heure une, cracher sur le sol pour ceux qui les auront laissés à mains nues devant la mort aveugle. À vingt heures deux, tendre la main et sentir le vent se lever. À vingt heures trois, prendre des nouvelles des proches, des nôtres. À vingt heures quatre et pour la nuit, dans l’automne 1792, prendre des forces pour les mois qui arriveront bien assez tôt, et le plus tôt possible.
-
je ne jetterai pas l’ancre ici
samedi 28 mars 2020

Ce sentiment : « Je ne jetterai pas l’ancre ici »… et sentir aussitôt autour de soi les flots houleux qui portent.
Un revirement. Aux aguets, timide, pleine d’espoir, la réponse rôde autour de la question, scrute désespérément son visage impénétrable, la suit sur les chemins les plus insensés, c’est-à-dire sur ceux qui entrainent aussi loin que possible de la réponse.Kafka, Journal, janvier 1918
Qu’il est tard, que tout s’efface avec la fatigue sauf la fatigue, qu’on change d’heure — mais laquelle ? Toujours la même question inutile et belle : toujours la tentation que ce qui se joue dans le saut de l’heure perdue ou gagnée touche à l’impensé —, qu’on traverse collectivement des solitudes, les mêmes : qu’un jour après les autres est le même aussi, de plus en plus attaqué par le suivant : que tout cela commence à fabriquer un événement historique dont on peine à éprouver le sens.
Mais un événement qui recouvre tous les autres, plutôt qu’il ne les met en perspective : est-ce un événement ? Plutôt le contraire d’un événement ? Au nom de l’union sacrée qui serait surtout un ralliement aux puissants, l’épidémie aurait ainsi suspendu la lutte des classes ? Mais les antagonismes de classe, eux, demeurent, et plus vivaces sans doute : se renforcent. Les pouvoirs qui mènent la lutte durcissent la guerre contre le virus et les pauvres. Dans les cités universitaires, la générosité va jusqu’à lever la caution : mais le reste, tout le reste ? Dans neuf mètres carré avec interdiction de sortir, on sait qu’il faudra régler la facture, ensuite. Dans les prisons, il n’y a pas d’ensuite, il n’y a qu’un maintenant de l’enfer. Il y aurait mille exemples. On ne dispose pas encore du taux de suicide, ni du nombre de meurtres dans les foyers réconfortants. Oui, le confinement n’est pas la même épreuve d’une classe à l’autre : et tout serait suspendu ?
Ce soir, on entasse les cadavres dans les stades en Italie, dans des patinoires. En France, on ne manque pas seulement de respirateurs, mais de cercueils. L’événement historique que nous traversons, c’est d’assister sans rien voir, entre nos murs, au spectacle invisible d’un manque généralisé : comme le souffle manque aussi, tout autour se dérobe du monde.
Images des files de familles en Inde qui fuient les villes : par millions. On a au moins ces images-là. On n’a pas les images dans les centres de tri à l’entrée des salles de réanimation. Ni celle des funérailles en solitaire. On a aperçu cette messe d’un pape devant la place vidée, et marchant lentement rejoindre en fantôme les fantômes de fidèles absents. Images : le corps du Premier ministre parlant ce soir, j’avais coupé le son : j’imaginais sans peine les mots, l’indécence des leçons données.
À la radio, le désarroi des commentateurs économiques rejoignait celui des journalistes sportifs. Rien à sauver d’eux. Le soir, je prends des nouvelles des amis. Ai-je besoin de la catastrophe pour me savoir lié à eux ? Cela me désole, me console. Il y a ces mails qu’on ne lit que le soir tard ou le matin tôt : la vie pleine de vie quand même, saluée à distance, celle qui va, ira bien où le désir mène.
Et il faudrait encore compter les jours ?
Bob Dylan, ce matin, dépose une chanson-fleuve sans aucun rapport avec le drame mondial qui occupe chaque jour toutes les pensées. Ô, politique intempestive et oblique de Dylan, sublime et nécessaire. Mais puisque l’événement a cette vertu de nous confier une vision paranoïaque du réel, appelant à lui tous les signes et les projetant autour de lui, on lit dans ses vers qui diraient la fin de l’innocence de l’Amérique après l’assassinat de Kennedy, le chant de la Chute, et les forces qu’il nous faut pour lui survive.
If you want to remember, you better write down the names Longue litanie de noms : des noms de chansons, de silhouettes, des intimes et des publics, des figures, des anonymes.
De quels noms dispose-t-on, alliés dans l’incertain ? On sait les amis, les forces qu’on puise en eux ; on a le nom de quelques livres, de quelques auteurs qui ont commis les livres et répandu les puissances ; on a le secret de quelques êtres qui ont bien voulu nous les confier ; on a le nom en souvenir de ceux qu’on a perdus, mais qui demeurent : on a des noms pour provoquer l’incertain, et le devancer peut-être. On n’a pas tant de noms. On n’en a peut-être pas besoin de mille, de cent. Une poignée, qu’on serrerait fort, et on jetterait nos poings pleins de ces noms, au-devant de l’incertain : l’incertain jeté à vive allure contre nous ne sait peut-être pas que nous n’avons pas seulement des anticorps en nous qui nous aideront à vaincre la maladie, mais le souvenir de quelques noms sortilèges qui serviront à survivre à la guérison.
Ce soir, au milieu de l’heure perdue, je ferai intérieurement la liste des noms.
-
la seconde qui s’écoule entre deux pas faits par un voyageur
vendredi 27 mars 2020

L’histoire humaine est la seconde qui s’écoule entre deux pas faits par un voyageur.
Ce soir, promenade vers Oberklee
Kafka, Journal, 20 octobre 1917
L’atomisation sociale n’aura pas été seulement le projet rêvé par ce monde depuis trente ans : mais notre expérience singulière et collective de ce printemps. Ainsi le raffinement suprême de l’époque tient dans cette ironie funeste : son rêve se réalise en l’anéantissant. Les flux marchands et productifs quasiment à l’arrêt — malgré l’effort des pouvoirs de maintenir à flot la machine au risque des victimes : voire en toute connaissance de cause —, ce qui se retourne contre l’organisation forcenée du monde est sa propre logique, cruelle et fatale.
Elle rêvait les êtres solitaires en empêchant la solitude par multiplication des branchements connectés projetés sur écran : et voici la solitude à nu, et le contraire des solitaires. Cette vie se révèle pour ce qu’elle est : une vie absente. Déjà des solidarités actives naissent un peu partout, étendent leur toile sur la toile. Des projets pour l’après qui sont autant de complot.
L’atomisation qui favorisait les dominants se déploie à telle échelle et dans une telle radicalité qu’elle convainc les plus indifférents à voir le monde tel qu’il surgit sous le masque craqué des compromis : restez chez vous est le slogan qui sauve des vies aujourd’hui, et maintient tranquille la domination les jours ordinaires.
Au large, respirer. En mesurer le luxe.
Respirer tue, dit l’affiche, tandis que toutes les quatre minutes dans ce pays on meurt d’étouffement parce que le souffle manque et les machines respiratoires.
Respirer tue : la vie est mortelle — ce monde qui compte les outils de la survie comme autant d’économies à faire : retenir sa respiration comme on retient les coups ?
Confinement prolongé ce jour, pour quinze autres. Mais on sait bien que pour bien faire, et à ce rythme, ce sont neuf mois de confinement qu’il faudrait [7]. Quand ils nous relâcheront — parce qu’ils ne tiendront pas, parce qu’on ne tiendra pas, que le monde s’écroulera dans deux mois à cette allure —, où en sera-t-on du nombre par minute des souffles arrêtés, des vies branchées sur respirateur (des vies auxquelles on n’aura pas accordé le droit d’être branchées) ? Où en sera-t-on de la solitude ?
Le monde d’après est venu : c’est celui-là, il meurt de respirer.
On pensait que la fin du monde était davantage imaginable que celle du capitalisme : on ne pensait pas que la fin de l’espèce pouvait survenir bien avant l’une et l’autre, que la terre se vengerait de l’autre en s’en prenant à l’une. On respire une dernière fois dans ce monde où on a grandi, et qui bascule : dans le pire de la répression, avec masque obligatoire pour aller dehors jusqu’au restant de la vie, et distanciation sociale à perpétuité ? Ou le meilleur : avec renversement des rapports de force ?
Le port est vide. Les bateaux ne semblent même plus attendre.
Le large paraît virtuel, comme l’au-delà pour un athée. Le mois de mars n’a pas eu lieu ; le mois d’avril vient d’être annulé. Oui, on reste décidément à quai.
Lire le journal de Kafka : à chaque page, l’aveu qui le terrifie et le console : je n’ai rien écrit. Jusqu’à la fin, il le dira. Rien n’a eu lieu. Mais cela, il l’écrit ? Dans son journal qui est au moins cet espace où rendre gorge à l’impuissance. Journal de Kafka : expérience politique qui renverse le pouvoir de l’impuissance. Qui décrit les conditions d’énonciation d’un réel enfin advenu au-delà de ce qui a lieu : non, pas au-delà, mais au-dedans, ou au creux. Journal de Kafka : un mise à mort joyeuse et patiente de l’impossible dans sa réalisation même.
[1] à peine, survoler plutôt, dans les seules heures possibles qui me restent : entre neuf heures et minuit
[2] En rêvant devant les diptyques de François Bon.
[3] Furieuse envie de relire Robert Walser, ces jours.
[4] Ou plutôt la tenait-il de tel philosophe hollandais ?
[5] À part ces voitures qui roulent à tombeaux ouverts, je ne croise jamais personne sur la route qui mène au parking vers le port de l’est.
[6] L’annonce faite, on splitte l’écran entre ceux qui ont été sauvés du naufrage, et ceux qui viennent d’être licenciés à qui on coupe le micro et qui hurleront en silence
[7] Article de Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS, dans Reporterre : « Pour le comprendre, il suffit de revenir au paramètre essentiel d’une pandémie : R0, le nombre de personnes à qui un humain infecté peut transmettre la maladie. Tant que R0 est supérieur à 1 — c’est-à-dire, tant que je peux transmettre le virus à plus d’une personne —, le nombre de personnes infectées croît exponentiellement. Si nous sortons du confinement sans autre forme de procès avant que R0 ne soit descendu en dessous de 1, nous aurons les centaines de milliers de morts que, depuis le début, la pandémie menace de provoquer. Or, pour que l’immunisation collective fasse redescendre R0 sous la barre de l’unité il faut qu’environ 50 % de la population soit immunisée, ce qui, compte tenu du temps moyen d’incubation (cinq jours), prendrait probablement plus de cinq mois de confinement (à supposer que nous soyons un million à être contaminés aujourd’hui, deux mois et demi si nous ne sommes que 500 000, mais qui le sait puisque nous n’avons pas dépisté ?). C’est ce type de calcul qui est sous-jacent aux annonces publiques du gouverneur de l’État de New-York, selon qui le confinement pourrait durer jusqu’à neuf mois. »