Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
-
la poésie est-elle encore impossible ?
mercredi 21 novembre 2012

c’est au dix-huitième étage de la BNF — le Belverdère tout près du ciel, le #midi, juste avant l’enfoncée en sous-sol pour la lecture de l’après-midi — l’enfoncement dans moi-même aussi pour la parole brève mais violente, serrée contre moi comme un secret qu’on délivre (et devant, à bout portant, des visages plongés dans le noir, oh quelle autre image plus juste que cette plongée, et le noir, l’invisible des corps — même si pourtant ; il y avait les visages amis dans la lumière derrière qui soutenait tout ; et il y avait l’adresse dans le noir rougi de sang au visage comme les fauteuils, comme les rideaux, comme l’attente)
Mais avant donc, on montera tout là-haut — j’avais déjà regardé la ville d’ici, mais c’est toujours à couper le souffle. On est si haut, qu’on se dit qu’on n’est encore pas assez haut. On voit mieux, puisqu’on ne voit rien des rues que des traits au crayon. Et les circulations, seulement des vitesses, ralenties. Un grand corps d’écriture, oui, un corps à prendre, on pourrait tomber presque pour cela.
Je dirai peut-être un jour ici la lecture (mais les mots de celle-ci suffisent peut-être, c’est-à-dire qu’ils ne suffisent pas, et c’est cela qui suffit) ; mais la hauteur, non, je n’en dirai rien — la hauteur avant cette chute dans le corps et sa langue quand on la voudrait, différence de potentiel, de cette vitesse là tombée : c’est la seule loi de physique que j’ai retenue (et encore, si mal, que j’invente tout peut-être))
je ne dispose pour dire la profondeur de cela,que des images en hauteur : la ville comme on ne la voit pas, et qu’elle parait si petite quand elle est si vaste. j’ai posé mes doigts sur la vitre, et j’ai regardé longuement, comme si mon regard pouvait en éprouver le pouls. il battait fort.
et le visage de Saint-Just sur tout cela, de ses cheveux tombés à nos pieds



la poésie est-elle encore impossible ? (la question de Roubaud, portée toute cette journée ; je la porterai encore jusqu’à la fin de la semaine, en talisman)
-
devenir mon propre corps (songer)
jeudi 8 novembre 2012

— Ah songer est indigne
Puisque c’est pure perte !
Et si je redeviens
Le voyageur ancien
Jamais l’auberge verte
Ne peut bien m’être ouverte.A. Rimb. (Comédie de la soif)
Le dehors partout, maintenant — maintenant qu’il n’y a plus de voiture, maintenant qu’il fait presque froid (mais pas encore celui qui transperce), maintenant surtout qu’il est trop fatigué pour dormir, en soi, et qu’on traînera quoi qu’on fasse cette fatigue demain tout le jour, c’est trop tard pour la conjurer, dormir maintenant ou dans deux heures n’y changera rien — non, rien à y faire, à part marcher au milieu de nulle part, et je le veux bien si ce nulle part est ce lieu où j’avance, ce soir là (c’était hier, il y a quelques heures pourtant).
Sortir du théâtre ne sauve pas, et de moins en moins — la dérision en tout qui blesse, l’esprit malin : et si le spectacle de ce soir-là fut beau, c’était aussi de refuser de l’être. Comment accepter ce monde ?
Comment le vouloir ?
J’ai cette pensée, en rentrant de si tard, dans la fatigue que je laisse traîner le long ces longs boulevards (il n’y a plus personne) que ce que je deviens ne m’appartient plus, que ce devenir que je rejoins un pas après l’autre rue tolbiac interminable ne me concerne pas, ne concerne pas le pas que je pose au moment où j’appuie sur mon corps pour aller vers lui — et ainsi de cette vie. C’est une manière de répondre.
Il fait noir autour (cela aussi est une manière de répondre aux demandes d’éclaircissements qu’on pourrait me faire.)
Ce que je suis devenu de moi-même, je l’ignore, vraiment : je regarde, je ne vois rien (il y a, au moment où j’écris cela, des photos de moi sur la table, des images officielles, celles où on nous interdit de sourire (sourire sur les photos, je ne l’ai jamais fait), celles qui servent pour partir : les photos restent sur la table en attendant).
Le passé que je commence de posséder est encore jeune et pourtant.
Il y a vingt ans, je dormais dans la même position que maintenant : et les rêves que je faisais, si différents ? Je ne m’en souviens pas. Et je construis ma vie sur cet oubli.

Ébloui par les soleils, là-bas, qui approchent, je m’écarte. Et dans l’écart que je fais, le choix répété de la vie.
Alors, cette question ce soir, brûlante de fièvre : devenir celui que j’étais, ou m’inventer autre ? De part et d’autre, deux impossibles. Celui que j’étais ne cesse de résister en s’effaçant (que ma splendeur soit cette manière de m’effacer), et celui qui s’invente en moi s’arrache de mon propre corps pour me faire face. Où je suis ?
Encore ?
Je pourrais les présenter, l’un à l’autre. L’un pleurerait, l’autre ne consolerait que son ombre. Qui le père, qui l’enfant ? Qui veillerait l’autre, lui tiendrait la main pour traverser le fleuve ? Je pourrais les envoyer d’un bout à l’autre du monde : l’un écrirait des nouvelles à l’autre, qui les lirait peut-être.
Ce que je deviens est justement celui que j’invente comme mon propre passé déjà : se rêver autre, dans la mesure de ma vie — c’est à cela que je travaille, d’arrache-pied, avec toute la tendresse dont je suis capable envers moi, cette violence.
On vote, de l’autre côté du monde. Ici, ils regardent comme si cela leur appartenait (donnent leur avis). Suivre cela de loin comme si c’était de près. Puis, lire la Comédie de la soif de Rimb. (ou Les Présences qui ne devraient pas être là de Michaux). Être sauvé, un temps.
Mais replonger. Écrire la vengeance : être incapable d’écrire autre chose que chacun de ces mots-là — n’en accepter aucun. Recevoir cela comme un fardeau. Accepter l’inacceptable. Signer cela de mon nom, quand même. Moi, je veux pourtant le vert immense où marcher sans heurter aucune pierre, je veux les lits défaits, les cheveux morts, les corps sur la grève, les marées qui montent et descendent, comme elles chercheraient à mordre la terre, pénétrer son secret, entrer en elle et sortir pour mieux en elle entrer de nouveau, et chercher plus profondément l’énigme de son désir.
Dans le noir de toute cette ville, devenir ma propre ombre : elle s’allonge si je m’approche, et si je m’éloigne elle s’allonge aussi, mais vers moi. La nuit, je rêverai de cela — que j’oublierai immédiatement.
Et tout le jour, je ne posséderai que mon corps, son ombre partout, et cet oubli. Oui tout le jour, le vertige toujours neuf d’habiter au dehors de moi : alors sonner à chaque porte, chercher un endroit où m’effondrer, que je ne trouve pas.
Et chaque jour ce miracle : un autre jour qui devient peu à peu en se défaisant tout ce dehors qui vient m’envelopper, et se confondre en moi. Chaque jour cet autre jour neuf, cet autre corps neuf sur moi, tout ce désir encore, la morsure des lèvres — ce qui vient vers moi, ce qui devient de moi le jour unique et qui ne reviendra plus, le jour qui calmement m’aura traversé comme une route ; ou comme lever au ciel l’aube de la nuit.

-
François Bon | Une réorganisation du monde
vendredi 2 novembre 2012

Affrontements — l’un des textes de Michaux qui m’importent le plus et au plus haut. L’été dernier et jusqu’à l’automne, l’ouverture d’un blog — que je ne signerai pas : on a parfois de ces besoins d’espaces et d’affranchissement — à partir de l’incitation de ce mot (et de plus loin aussi) avec fiction continue sur voix, visage, corps, combats, ceux qui se donnent contre soi aussi.
Quand François Bon me propose il y a peu un échange pour les vases-communicants, c’est presque naturellement à partir de ce mot et ce qu’il convoque. Michaux en partage (je sais la place qu’il occupe pour lui), mais pas seulement, non : et ces derniers jours par exemple, dans le croisement entre fictions sur la ville et son imaginaire quand le numérique la réinvente, ouverture d’un chantier sur Hendrix, hommage au poète disparu, mais aussi espace de mise en demeure du monde, l’inacceptable de sa violence, la dignité de lui faire face, cette question qui brûle : qui sont les assassins de Jallal ?. Tout cela ensemble et comme en même temps parce que c’est toujours un même monde devant lequel écrire, et face auquel répondre aussi.
Si le site est son atelier, on est nombreux pour qui il est aussi territoire essentiel de ces lignes brisées qui portent tous même exigence de commune présence. Et toujours, en parallèle (parallèles qui se croisent aussi évidemment) l’énorme travail publie.net, cet autre espace de haute respiration.
Grande joie d’accueillir son texte alors dans mes carnets, à partir de ce mot d’affrontements et comme une prolongation des fictions de son labo, où comment faire face au monde en l’inventant autre. Puis, simplement dire que l’échange revêt pour moi d’autant plus de sens, en ce mois de novembre ; merci pour l’accueil dans tiers-livreEt d’autres vases communicants ce mois — pour m.h.
Dans le monde d’après les affrontements on avait préféré diviser les terres, les mers, les montagnes, les pays en zones parfaitement délimitées.
Chacun savait où il était.
Si on se déplaçait, on prenait les routes, on tournait à gauche, à droite, on continuait le temps qu’il fallait et on arrivait à sa zone de destination.
On n’empiétait pas, on ne s’installait pas, ne demeurait pas, ne communiquait pas.
Quand on était dans sa case on avait tous les droits, recevoir, échanger, parler à distance, s’équiper.
Des entrepôts, des fabriques, vous parvenait ce dont vous estimiez avoir besoin.
Ce que vous-même fabriquiez ou cultiviez ou organisiez participait à l’échange général. Les usines avaient adopté ce mode neuf de fonctionnement : partout au monde, c’était tellement plus simple si on restait chez soi.
Le mode d’emploi restait compliqué, parce qu’on avait été trop habitué, avant, à se déplacer sans précaution, à traverser les cases des autres, à proposer des villes où des fêtes et des concerts et des tribunes où chacun venait se mêler sur la même case.
Alors on avait ces signes, au sol, ces panneaux aux croisements. Non, la rançon de cette nouvelle paix, c’était notre respect de ce qui avait été décidé en commun, à échelle globale du monde. Tu pouvais aller jusqu’en Chine par la petite route droite, en tournant quand il fallait, et circuler où tu voulais.
Il fallait seulement respecter les signes au sol : les zones d’arrêt, de ravitaillement, de guidage, de croisement.
On développait maintenant les règles pour les malades, les morts, les incivils.
Pour qui n’entrait pas dans cette catégorie, la paix qui résultait dans le monde, et la tranquillité où chez vous on vous laissait, n’avait pas de précédent connu.
Le grand affrontement avait permis enfin la réorganisation territoriale, on avait refait un monde qui autorisait l’humain, à condition de les séparer tous et chacun.
On n’aimait pas ceux qui tenaient désormais discours contre les routes trop droites, et la porosité des lignes.
On avait rétabli ses habitudes. Tout allait mieux.
On avait enfin la possibilité de distance.
-
ce qui toujours se relève (au lieu du théâtre)
vendredi 26 octobre 2012

Tout réapprendre des gestes, mêmes les plus simples, comme par exemple se lever. Je veux dire, de moi-même, sans rien, juste à cause de la lumière ou d’un cri dans le rêve, le hurlement dans ma gorge, mais tendre, ou parce que la fatigue a passé comme une couleur — non plus à cause du bruit d’un réveil qui perce. Tout réapprendre comme l’eau chaude laissée lentement tomber sur soi et que s’écoulent toutes les pensées (nouveau rite, dans l’aube : me rappeler des images du rêve pour les laisser partir de moi, sous l’eau chaude, qu’elles s’enroulent avec la dernière eau et me laissent en paix). Tout réapprendre : de marcher dans la ville, avec seulement le jour à voir comme de l’eau chaude tombée sur moi.
« L’âme est un suppôt (non un dépôt), ce qui toujours se relève, se soulève, ce qui d’autres fois a voulu subister. Rémaner… Être le reste qui va remonter »
Ces phrases d’Artaud que je viendrai exprès entendre le matin justement, dans une salle de fac, phrases qui prendront toute la place. Des gens au début, parce qu’il y a de la lumière qui passe, tireront les rideaux pour ne rien laisser du jour — alors je ne verrai rien du ciel et de sa lumière, mais je trouve cela juste : c’est un endroit tellement coupé, tellement déchiré. La lumière ne rentre pas, ici, le temps n’y passe pas, on parle des siècles passés comme s’ils avaient une importance maintenant, et du temps présent comme d’un siècle passé. Les phrases d’Artaud sauvent.
« Les figures sur la page inerte ne disaient rien sous ma main ; je veux dire qu’en ignorant aussi bien le dessin que la nature, je m’étais résolu à sortir des traits… [inaudible] une protestation perpétuelle contre les lois de l’objet créé »
Je saisirai les phrases à la volée — j’écouterai fort, mais j’entendrai mal —, et peut-être que ces phrases ne sont pas d’Artaud. Je pense au double, comme le théâtre et son double ne sont pas l’envers l’un de l’autre : mais l’âme corporelle des choses. Je rêve toute la journée de l’âme corporelle des choses. L’ombre vivante de la matière. L’écheveau des vibrations de l’être.

Au théâtre, c’est toujours le lointain qui revient, et le mime. Il paraît que la mode est au militantisme : faire jouer sur scène le réel en tant que tel. Il y a aussi toutes ces scènes qui jouent au théâtre, la répétition du théâtre dans ses mêmes termes : ce petit langage qui joue avec lui-même. (Oui, "comme le sacré manque, la grâce, l’amour !" Oui.)
Le soir en rentrant, ces lignes d’avion qui se croisent, qui se cherchent, qui se manquent. Comme on réapprend la route, et l’autre.
Toute la journée, ces derniers jours, c’est cela : inventer intérieurement un théâtre qui saurait être neuf, et qui pourrait frayer la possibilité de la grâce, ce sacré qui manque partout et qu’il faudrait réinventer lui aussi, maintenant que dieu est parti, comme on dresse une assiette à celui qui ne viendra plus, et pour cette raison même.
J’ai des histoires derrière la tête, moi aussi. Je voudrais réapprendre à les dire, je sais qu’elles sont aussi devant le visage, partout, qu’il faut traverser parfois le rideau des cheveux pour les rejoindre — seulement apprendre parfois, quand on marche sur une route, lever la tête, voir que la route est aussi plus haut, qu’elle se dessine de la trace d’un avion qui s’éloigne (Montréal, Lisbonne, le Pérou). Dans l’avion, on ne voit pas la trace, le chemin, mais seulement la terre qui s’éloigne. C’est là le double et son théâtre.
Apprendre à regarder le ciel, c’est une manière d’inventer le théâtre qui dirait le manque au lieu où il redevient nôtre — et, à gauche, à droite, toutes les richesses flambant comme un milliard de tonnerres — et devant aussi.
-
la nuit d’après (pour garder le chemin)
dimanche 21 octobre 2012

C’est d’avoir rangé tous les livres, toute la journée, qui a tout terminé. Ranger tous les livres a fait passer la journée, d’un bout à l’autre (il y avait beaucoup de livres partout, sur la table, sur le sol, aux moindres recoins de poussière : il a fini par y avoir plus de livres que de poussière, c’était une conquête de chaque jour). Ces trois derniers mois, un livre sorti ne pouvait revenir à sa place, il fallait le poser ici, près de l’écran ; parfois, ce n’était que pour une phrase (un mot (même pas : parfois, c’était simplement pour l’avoir auprès de moi, au sein de ce champ de forces que je dessinais dans le désordre le plus grand, la précision la plus sûre)).
Mais voilà : toute cette journée, ranger les livres a été une manière de clore ces trois mois aussi, de terminer d’écrire (je n’ai pas ouvert l’ordinateur pourtant aujourd’hui).
Je n’avais pas eu le temps de rêver beaucoup sur le jour d’après — quand on travaille sans lever les yeux, l’horizon de l’écran est le seul, il porte les mots qu’on dresse comme un voile. Ainsi, quand le jour d’après est venu, qu’il n’était pas un lendemain, lointain, mais ici et maintenant l’heure qu’il faisait au poignet, alors il n’y avait plus rien à faire que de ranger les livres comme on enterre un corps, qu’on jette sur lui de la terre avec les mains.
Je range même les couvertures de certains arrachées, aussi précautionneusement.
Je ne dirai rien sur mardi, qui a suivi samedi, dimanche et lundi (ces trois jours n’en ont formé qu’un seul, de veille affolée, de nuits blanches continues où pencher sur le travail, traquer les mots là où ils se cachaient) ; lundi midi (il était midi pile, oui), j’envoyais ces trois années à l’impression (le point de non-retour : j’aurais pu envoyer cela une heure après, la semaine prochaine, dans dix ans : le terme est arbitraire), c’était aussi cinq ans de travail, et sept années en tout (un travail qui commença de plus loin, aussi, est-ce qu’on peut le finir ? Oui, on le finit : c’était lundi, midi, précisément). J’ai alors pensé, en regardant par la fenêtre à ce moment-là, au geste de la main, répété deux fois, de la mère orpheline, et à la phrase qu’elle prononce au soleil.
Le prix que j’ai payé pour cela.
Toute la semaine, c’est ensuite tomber de si haut du fil tendu soigneusement depuis ces années pour qu’il soit ainsi tranché ; et c’est traverser ces jours avec des obligations (toutes ces aberrations sociales qui me dépassent) [1] , et jeudi et vendredi, loin de Paris, c’était aussi manière de continuer de terminer ce travail (il faudra que je redise, dans ces pages, comme il m’a fallu prononcer le nom de mama, comme j’ai entendu le nom de mama prononcé sur scène le soir aussi). J’imagine comme ces phrases doivent paraître obscures si on devait tomber sur ces pages — mais c’est parce que cela ne compte pas ; ce qui importe, c’est comment, ce matin, il a fallu se lever, et que c’était fini.
Les premiers gestes qu’il faut apprendre à faire, les gestes dont il faut se défaire ; tout ce qui commence quand la fin est arrivée. Je pourrais très bien dire : oh, faisons comme si une tâche avait été accomplie, un poids enlevé, un temps passé, et continuons. Mais c’est qu’il ne s’est agi ni d’une tâche, ni d’un poids (au contraire), ni d’un temps — plus simplement d’une part de la vie : en prendre mesure est une manière de lui rendre grâce, et de se ressaisir dans la part de la vie qui s’ouvre.
Marcher longtemps ce soir, et tourner autour de l’immeuble qui se construisait, à l’ombre duquel j’ai écrit, et qui s’élevait en même temps que la thèse. Lui est encore en construction, presque achevé, mais presque seulement. Est-ce que j’ai gagné cette course, au moins ? Je ne sais pas. Je souris en levant les yeux sur lui, et prenant la photo (en l’adressant). Voilà l’état de mon travail aussi : aussi inachevé que des ruines qui n’ont pas encore été habitées.
Quel livre je peux lire, ce soir ?
Incapable d’en ouvrir un, ce soir — mais ces phrases de la Genèse (livre 2). Je me demande comment, puisqu’il n’y a que deux arbres, l’un des deux peut se trouver au milieu. S’il y avait trois arbres, il y aurait un arbre du milieu, mais avec deux arbres (à moins que le Livre ne parle du milieu du jardin ? Mais le milieu est toujours où l’on se trouve, dans le jardin, puisqu’il n’a ni bord, ni terme, ni dehors). Je comprends : si sur une page, on dit que l’arbre de vie est au milieu, sur l’autre, ce sera l’arbre de la connaissance — les deux arbres se trouvent au milieu l’un et l’autre, mais jamais confondus (sauf quand, au moment de la Chute, ils s’assemblent pour former l’objet de la quête désormais qui commence).
« pour garder le chemin de l’arbre de vie » Je pense à Eurydice qui marche derrière Adam, à la nuit qu’il fait autour d’elle, comme peut-être ils se tiennent la main tous deux, sans se voir (ce geste qu’on lance derrière soi quand on traverse la route au feu rouge et qu’il faut se presser, qu’on tend la main derrière pour dire : viens, vite, traverse avec moi — mais cette fois la route est longue comme des larmes) ; je pense à Eurydice, au bruit de ses pas qui sont les miens ; je pense à sa voix, qui ne sait nommer Orphée d’un autre nom qu’Adam, et prononce d’autres noms encore : oui, c’est ainsi qu’elle lui parle, juste en disant son nom, son nom à lui qui se trouve ainsi nommé tandis qu’elle porte le mien, et lui, devant, porte celui que ses cheveux lui donnent.
Je pense aussi, maintenant que la table de travail est nette, qu’aucun livre n’est plus reposé, à la nuit qui tombe ou qui se lève, au poids du rideau rouge comme le désir, aux corps qui, derrière, commencent à bouger déjà, sans que je sache si ces mouvements appartiennent au théâtre ou à la vie.
Je pense : demain, la lumière qui viendra se poser est à cet instant sur le visage d’un autre de l’autre côté du monde — elle m’appartient déjà.
-
la roue du temps (shalom shabbat)
vendredi 5 octobre 2012

Une chance de naître LA CHEVELURE
La chance du jour de la nuit
tient à un cheveu Ah Combien
d’épreuves cycles confondus
pour une chevelure épriseEdmond Jabès
il fait encore nuit, dehors comme toujours, la nuit répandue en désordre, et moi debout, à peine, moi marchant, à peine, moi avec mes mains minuscules frappant tous les mots, comme s’ils devaient ouvrir des portes (et la clé, où est-elle), je me retourne et tout autour la ville est restée là, et pourtant, oh ; le carrousel du manège est vide, à mes pieds la nuit que je relève encore, l’effondrement
hier aussi, mais davantage ; alors quand je me suis couché hier, il a fait tout seul, j’ai laissé la lumière allumée pour que la peine soit moins grande et que la solitude ne me laisse pas quelque part où je ne verrai même plus mon ombre
au réveil, il faisait jour, et la lumière de la lampe, je ne la voyais plus, confondue dans le jour, inutile ; je me suis levé, la douche chaude et les yeux fermés sur l’oubli du rêve déjà emporté dans la ville pour écrire encore, comme moi, écrire les mots qu’il reste avant qu’on n’en parle plus
toute la journée il n’a pas plu, pas une seule goutte dehors, et pourtant le ruissellement sur la vitre comme un visage que je porte ; dans le café, personne. Au fond, qui pour me voir, j’aurais pu partir sans payer. Il faut que je prenne mesure de mon propre silence aussi
ce soir, je m’effondre plus lourd encore de ce que j’ai abandonné comme ces phrases derrière moi, et j’ouvre ce livre parce qu’il le faut, que tout brûle en moi de cela, Jabès, lire cinq minutes me console de l’inconsolable : cette vie commence quelque chose de neuf comme jamais
LA BOUCHE Merveille des minutes
que les lèvres colorent
Nous sommes deux à vivre
le désir des parolesE. J.
j’aurais voulu laisser les pages de mon journal contretemps encore vierges comme un scorpion sous les dunes, dans la nuit qui attend que la chaleur revienne et la lumière du jour pour aller vite vite déposer ces traces infinies sur le sable comme on écrit avec le désir d’être ailleurs et qu’on s’éloigne pour rejoindre une autre nuit, et l’amour des dunes emportées sous le pas, j’aurais voulu revenir ici avec le sac déposé, le chemin accompli ; mais non : cela aurait été triché - peut-être que je laisserai ces pages vierges jusqu’au sac déposé, mais ce soir, il faut écrire, parce que la nuit dehors est là, que mes cheveux poussent, que le désir est profond et le jour à venir une promesse
et que cette promesse tient de la lumière et des marches de scorpion qu’on rêve, oui, qui ne vont nulle part, des marches comme auprès de qui ils sont le ciel même ; j’ai en souvenir la morsure du sable, quand on veut porter aux lèvres le pain laissé sur le sol, et le bruit de verre, et la joie surtout
la roue du temps n’est pas passée ce soir ; et pourtant si : c’est naître qu’il faut, à cela aussi
ce soir encore, mes pas d’animaux légers sur le sable, ici, pour dire : le chemin est le désert même, ce sont nos pas qui le dessinent, comme à la surface du corps quand les mains l’inventent de pur désir dans la lenteur, ou sur la page, quand ils disent, c’est par là.
MIROIR
Les réverbères dorment
allongés dans l’espaceSi faible pour le passant
est la lumière du songeAh la crue
belle nuit
qui débordeE. J.
-
sarcophage (que l’on referme)
mercredi 12 septembre 2012

jour après jour, après jour, le chantier accomplit sa fin, on commence seulement à voir à quel immeuble il ressemblera jusqu’à sa destruction.
ils ont posé les vitres, la semaine dernière, ou hier, et encore aujourd’hui, comme sur un tombeau, mais pour qu’on puisse voir à travers : comme pour un tombeau pourtant.
une vitre après l’autre, j’imagine le travail, à bout de bras, montés sur les épaules des autres, j’imagine, la pesanteur (et j’imagine aussi : le bruit que cela ferait, si on lâche une seule vitre de verre pur sur le sol depuis là-haut)
travail de précision, mais qui le verra ; l’ouvrier dans sa solitude tire les fils, qui resteront invisibles. ceux qui allumeront la lumière ne verront même pas la lumière, mais l’objet à prendre, dans l’insomnie, pour la calmer. c’est tout.
c’est une vitre après l’autre, que l’on pose sur le vide, pour conjurer quelque chose qui tiendrait de la catastrophe et du retard. Babel si proche qu’on ne croit plus en elle. Moi, je crois en elle.
quand ils ont creusé les fondations, j’étais là pour les voir, ces trous que la pluie recouvrait, et j’aurais voulu planter quelque chose, jeter des cheveux, déposer tendrement des crachats moi aussi comme la pluie sur le trou. je n’ai rien fait.
quand ils fermeront la dernière porte, je serai où.
et quand tout s’effondrera, Babel encore.
cet immeuble s’est dressé comme mon désir, une page après l’autre, a pris forme du désir plus grand de le rejoindre, de bâtir avec lui un sarcophage de verre où tout serait de précision, et d’inutilité — inventer le monde comme on fait un enfant pour le marcher enfin plus longtemps, et croire au miracle, puisqu’on l’aura ainsi produit. être l’enfant de cette pensée, à jamais.
sauvagerie joyeuse de mordre dans la blessure.
je me suis coupé tant de fois aux vitres de verre, ceux que j’ai moi-même montées de mes mains, et installées aux fenêtres donnant sur le vide, que je n’ai plus peur de tomber, seulement hâte que la chute épargne mon corps.
au fond du sarcophage, corps de poussière, qu’on prendra pour de la poussière (moi, je verrai le corps, et le sourire)
pupille de cendre.
éclat rouge, sang écoulé comme du temps, sous le ventre.
œuf noir.
ciel ouvert, vue sur le vertige.

Mots-clés
-
la ville est un sas (et la lumière)
samedi 8 septembre 2012

Entre le bureau et le bureau, la ville est ce sas. Tous les matins, vers 9h, puis le soir, quand le soleil tombe, il est 19h, être seulement dehors celui qui croit qu’il n’est plus dedans. On a comme cela, de ces ruses. Pour tromper qui ? Quand je me retournerai sur ces mois (cela finira bien par arriver), il me restera peut-être ces marches par dessus tout, quand il s’agit de faire le vide : en fait, le vide se fait tout seul. Même plus besoin de musique. Sortir dans le vide de soi. Voir seulement se lever puis tomber la lumière. Il restera seulement de la ville dressée entre moi et le temps pour la rejoindre ; sur la table ce qui repose, et en moi ce qui se dresse puis retombe, se redresse encore,

c’est par exemple ce fragment de ville allongée avec au loin la ville levée ; pourquoi ces souvenirs de Montréal soudain ? La brique rouge, peut-être, la lumière et tout ce ciel sans doute, l’allure lente de la ville ici (le désir d’y retourner),

c’est toute cette hauteur des choses qui semble infranchissable, et y aller pourtant à mains nues ; parfois je regarde derrière l’épaule, en bas, je ne vois plus le sol ; mais je ne vois pas la hauteur du ciel non plus, seulement mes mains détruites sur la pierre, que je lève encore, trace les lignes droites sur fond penché ou est-ce l’inverse, je prend exemple sur l’avion, une ligne après l’autre,

c’est la lumière que j’intercepte, je la recueille sur telle pierre, qui elle-même la recueille sur tel immeuble là-bas, qui lui-même l’a prise à un autre, et l’origine ainsi dégradée de la lumière finit par se perdre, on ne sait plus si elle existe vraiment, seul importe le geste de celui qui va la prendre, là, ici ; je veux bien être celui-là,

c’est parfois le soleil en face, quand c’est insoutenable, et que je soutiens le regard, il est si tard, les yeux pourraient fondre, c’est le soleil qui cède le premier,

c’est l’ombre coulée de la vie jusqu’à moi (ou est-ce mon ombre à moi, coulée, jusqu’à elle),

c’est le sexe du soleil,

c’est le sang perlé du soleil à la coupure de la ville,

c’est tout cela que la lumière rend invisible, sauf elle,

c’est tout ce chantier que j’ai élaboré comme s’il pouvait tenir droit, une maison que j’ai habité près de cinq ans, les trois dernières chaque heure de chaque minute, un rêve que j’ai fabriqué, percé de fenêtres, pas assez peut-être, et la porte, oui, où la porte (je sais les pièces secrètes),

un seul mot pour accéder à tout, mais ce mot, oh, combien il a besoin de milliers d’autres,

c’est the trees of life là-bas.
-
le maître est là (et il t’appelle)
dimanche 2 septembre 2012

le maître est là, et il t’appelle : je me retourne, il n’y a pourtant personne que moi.
il t’appelle et la porte est fermée. je frappe, j’entends le vide qu’il fait à l’intérieur, et puis beaucoup de silence.
le maître t’appelle encore : quand on viendra répondre présent, il répétera le nom, dans tout le vide qui s’est bâti depuis le temps qu’il lance ton nom, ton nom qui lui revient dans le vent, qui a fini par creuser ce lieu de toutes nos absences.
il faudrait peut-être croire en dieu pour cette raison seule : faire taire son appel. on viendrait là, dans le silence, on s’allongerait sur l’herbe poussée entre les dalles, on aurait le ciel au-dessus de la tête qui passerait dans les murs bleus des verrières, on fermerait les yeux enfin.
le monde, c’était le nom qu’on donnerait à tout cela ; quand le temps finit, ce qui commence n’aura pas de fin. on se retournerait : tu serais là avec ton nom, tu me donnerais le mien.
plus loin, l’eau passerait. on ne s’y noierait pas, on tendrait les mains pour la soif.
là, des enfants lâchent des ballons gonflés à l’hélium : sur chacun un nom : manon, erich, ethan, victor. quand ils se poseront plus loin, dans des milliers de kilomètres peut-être, le nom portera le secret de celui qui l’aura confié au hasard. chaque enfant est dieu soudain.
le maître t’appelle, il demande de ses propres nouvelles : personne ne comprend, on s’éloigne ; moi, je pleure lentement dans les feuilles de l’arbre.
il t’appelle par mon nom, tu me regardes, j’ai tant sommeil que je ne peux pas dormir ; mon visage me brûle, je demande un autre nom.
dans mes cheveux la grâce de mes plus belles années, je m’y entortille les doigts — puis, quand je les pose sur le clavier pour écrire, j’en ai encore enroulés, alors je frappe les phrases sur la racine de mon être, à la racine de tout ce qui pousse en moi, ce corps.
du désir j’en suis plein, comme un manque : plus loin, on appelle, mais la rue est si déserte que le nom se perd, entre dans une maison au hasard, ce n’est pas la mienne.
le maître est là, qui t’appelle, moi, je te regarderai entrer, je n’attendrai pas.
Mots-clés
-
pourquoi vous prenez les voitures en photos
vendredi 31 août 2012

— Pourquoi vous prenez les voitures en photo ?
— je ne prends pas les voitures en photo, je prends ces feuilles-là, sur le trottoir,
— C’est pas ce que j’ai vu. J’ai bien vu, de l’autre côté du trottoir, sous l’abri bus où j’essayais dormir, que vous preniez des photos des voitures : pourquoi, pourquoi ?
— non, vous vous trompez, madame, regardez,
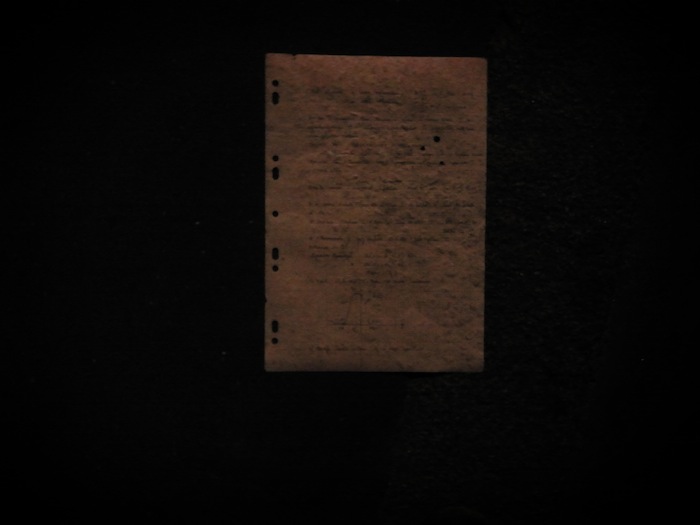
— c’est ce que vous dites. Moi, en Loire-Atlantique, j’ai jamais vu ça, quelqu’un qui prend en photo les voitures, pourquoi ?
— non, non vous vous trompez : c’est de loin j’ai vu ces feuilles-là, depuis le coin de la rue, dispersées : voyez ; c’est parce qu’elles formaient ce chemin triste, et c’est parce qu’elles conduisent jusqu’à ma porte, qui est juste là, où est la dernière feuille ; des feuilles d’école la veille de la rentrée (je crois que c’est la veille de la rentrée, je ne sais pas vraiment, je crois, d’ailleurs, il a plu aujourd’hui pour la première fois depuis des mois), je crois que c’est une fille, je me suis penché sur l’écriture pour la voir, il y a des schémas, des calculs, sans doute très savants, un secret peut-être, comment savoir, avec la pluie, et les pas de ceux qui passent sans les voir, oh, comment ne pas les voir,

— mais pourquoi vous prenez en photos les voitures, vraiment pourquoi ?
— ce sont les feuilles, madame, parce que je suis sorti ce soir, il fait tard, dans le froid, la fatigue plus grande que moi, que je voulais trouver quelque chose qui m’aurait dit : c’est par là que la vie passe en toi, et je n’ai rien trouvé, mais juste à dix mètres de la porte, car c’est là mon immeuble madame, j’ai trouvé ces feuilles, j’ai reconnu l’écriture et j’ai regardé longuement les schémas, j’ai pris les photos pour qu’un soir je puisse écrire que je n’ai pas renoncé à voir les chemins, pour qu’en les regardant je me dise non, je n’ai pas inventé ce chemin de feuilles répandues dans le noir pour que je puisse le voir, et le suivre, et m’envelopper de lui, et qu’un autre soir comme celui-là, je puisse le prendre aussi ; mais je vais remonter, ce soir, le travail m’attend, il n’attendra pas plus longtemps, et je vous souhaite une belle nuit, madame,
— pourquoi vous me dites pas pourquoi vous prenez les voitures en photo ?
[1] sauf mardi, oui, mardi matin, où je me suis trouvé au lieu d’un rendez-vous fixé de sept ans en arrière, et dont je ne parlerai pas, sauf en marges, comme ici






