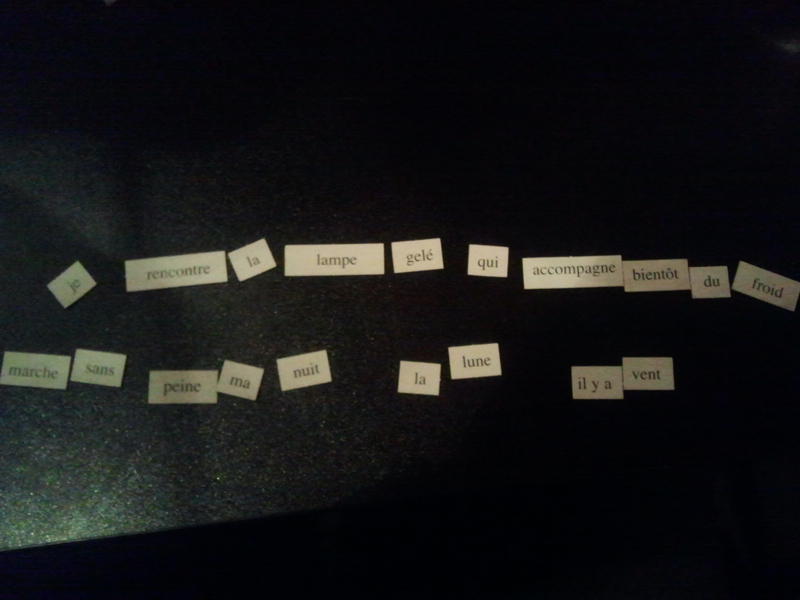Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
-
je marche (interminablement)
jeudi 16 février 2012

LA SOIF J’appelle l’éboulement
(Dans sa clarté tu es nue)
Et la dislocation du livre
Parmi l’arrachement des pierres.Je dors pour que le sang qui manque à ton supplice,
Lutte avec les arômes, les genêts, le torrent
De ma montagne ennemie.Je marche interminablement.
Je marche pour altérer quelque chose de pur,
Cet oiseau aveugle à mon poing
Ou ce trop clair visage entrevu
A distance d’un jet de pierres.J’écris pour enfouir mon or,
Pour fermer tes yeux.L’épervier, Dupin
À portée de moi, cet homme qui marche comme au-devant de moi et déjà moi je le sais, dans quelques mètres, mais dans quelques mètres où je serai sur ces pas, lui plus loin continuera à m’ouvrir la route en deux comme une blessure, et moi plus loin, mais jamais aussi près de son lointain, moi qui demeure à même distance de lui et de moi, dans cette nuit qui ne tombe pas, neige retenue ailleurs où elle est davantage désirée, et cette fadeur des lumières autour de chaque chose ainsi suspendue dans l’air, oh la mort pourrait venir je ne la verrais pas, d’ailleurs elle vient, la fille sur le trottoir me regarde et je pourrais la suivre, je ne la suis pas, à la place je lève les yeux, l’homme a disparu, à la place il n’a laissé que mon ombre et quelqu’un parle autour de moi,
je ne me retourne pas, pas tout de suite, j’ai dans ma poche l’harmonica serré contre ma main, je suis armé, j’ai toute ma vie avec moi et peu de souvenirs à protéger, je les donnerais tous dans la minute si on me le réclamait, je ne résisterais pas et si on demande plus, j’ai l’harmonica serré contre ma main et le poing serré contre lui, alors je n’ai pas peur : la voix se rapproche, elle avance des mots plus vite que mes pas, bientôt m’aura rejoint, je tourne main gauche sur cette rue, il n’y a personne que moi,
et les mots de la voix qui approchent derrière moi disent comme une ritournelle l’organisation du temps, l’emploi du temps plutôt, les heures une par une dévidées, structuration mentale des heures et des minutes et de la ville, la voix se rapproche tellement que je l’entends dans ma tête, et je mets encore une autre rue à comprendre que c’est moi qui parle depuis tout à l’heure, que c’est moi qui organise tout haut ma journée de demain : depuis quand, je ne le sais pas, il fallait me le dire, oui, que je parle tout haut dans la rue (mais la rue est vide, et j’en emprunte une autre, plus vide encore, comment est-ce possible),
ainsi je parle dans la veille, si seulement c’était dans le sommeil je ne m’en rendrais pas compte : il a fallu que je m’approche de moi pour m’en rendre compte, encore une habitude à me défaire ; alors je repense à mon homme de tout à l’heure qui me devançait de trente mètres, je me dis (tout bas cette fois, de peur de l’entendre et d’y croire) que c’était moi, déjà, tout moi, et mon visage, je me dis que si j’avais crié, retourne toi je t’en supplie, j’aime le corps que tu avances loin devant moi, il se serait retourné, et m’aurait regardé avec mes propres yeux, et que serait-il resté de mon visage, je ne le sais pas, je préfère marcher dans l’ignorance, et interminablement, aller dans ces pas qui me devancent et me désirent, cheveux en bataille et la ville défaite pour moi, paroles de combattant, et l’écrire, je l’ai déjà fait, je le referai.
Demain, j’irai jouer de l’harmonica dans les cimetières, souffler cela quelque part à qui l’entendra.
-
ombres des bancs
jeudi 2 février 2012

Dans cette ville, ceux qui retirent les bancs ne savent pas – peut-être est-ce pour des raisons précises : aménagement urbains, vastes plans de réinvention des quartiers, rêves formulés en secret par des architectes inconnus qui complotent pour disposer les énergies de la ville autrement, répartitions neuves des forces.
L’idée que les bancs seraient enlevés pour chasser ceux qui la nuit y allongent leurs corps, seraient retirés pour faire place nette la nuit quand les immeubles chauffés éteignent leurs lumières, et pour effacer ainsi la misère en la repoussant aux quartiers encore pourvus de bancs : cette idée m’effleure et disparaît : non, bien sûr, dans quel monde cette idée pourrait naître, et serait appliqué ?
Il y a peut-être un endroit où l’on dépose les bancs qu’on arrache du sol ; on les entasse en attendant que d’autres les recouvrent, ou qu’ils se changent d’eux-mêmes en poussière.
Il y a des bancs qui sont des ponts lancés sur la ville : des endroits de franchissement, comme ici (ou plus loin, ces bancs posés sur des ponts justement, près de la Bibliothèque). Des bancs sur lesquels soudain la ville arrêtée se laisse voir, et rêver ; partage des colères et des désirs, les cheveux mêlés dans les doigts qui passent en eux et les lèvres d’alcool, les harangues des types sans toits qui en font leur lit, de Rome à Place Clichy, longue avenue dortoir hérissée de bancs aménagés en villas : ici, il y a des lois propres qu’on ignore, des coups d’État les soirs de grandes chaleurs, et des tendresses terribles quand le froid tombe comme une pierre. Sur certains de ces bancs, on y dépose sa vie.
Sur un banc comme celui-ci, la mienne par exemple.
Plus loin, près de Rivoli, ou au Luxembourg, encore : les bancs qu’on emprunte (à qui), mais qu’on trouve toujours vide quand on passe, là où on prolonge telle parole qui ne pourrait avoir lieu qu’ici, où se taire pour voir la ville passer.
Dans cette ville, arracher un banc du sol n’est pas ce que l’on croit : accélérer les flux, interdire qu’on vienne interrompre la ville pour la voir. Je l’ai compris après le temps de tristesse et d’accablement devant l’absence de banc, oui : c’est surtout le dernier recours dont on dispose pour construire des routes dans cette ville bâtie de toujours. C’est déployer de nouveaux chemins à la place.
Alors, on serre le poing un peu, on crache sur le sol, on pleure un peu. Et là où le corps se déverse, où le banc jadis recevait nos regards (celui de Ferdinand et de Arthur, au début du Voyage), là se creuse une route encore vierge, on voit les traces de terre.
Je pose les pieds à l’endroit du banc. Il n’y a que mon ombre dédoublée par la lumière qui y restent accrochée. Je m’éloigne. Le fantôme du banc me suit. La route, elle, s’en va là-bas.
-
le cercle qui m’est assigné
mercredi 18 janvier 2012

Ne pas écrire chaque jour, cela ne veut pas dire que chaque jour, on n’écrit pas – je demeure incapable de ne pas composer mentalement des phrases sur tout ce dehors que je vois ; cet apprentissage long de naître à soi dans le dehors ouvert comme une plaie. L’appareil photo est un stylo tenu ainsi à bout de bras qui me permet d’écrire, même dans ces jours où tout fuit, où ne pas guérir d’une crève qui insiste, où il n’y a plus que les heures après minuit, comme celles-ci, pour — heures qui ne sont plus bornées et permettent qu’on s’y livre, dans la sauvagerie.
L’insomnie sauve au moins de cela ; préserve du silence. Mais l’insomnie, éprouvée à force de fatigue plus que par décision, je l’occupe à lire. J’emprunte ici quelques minutes à ces moments pour m’arracher à eux, à la fatigue, à ce dehors, à la vie passée devant moi sans interruption : pour m’y poser.
Ne pas écrire chaque jour n’est pas un manque, ou alors comme on manque de temps pour le vivre : le temps est toujours là cependant. Écrire dans l’inconfort, dans l’entre-deux de la vie, cela je l’accepte. La sauvagerie aussi, sa tendresse.
Et puis, je suis moi-même dans cet entre-deux toujours inacceptable de ce temps où l’on vient de finir un texte longtemps porté, et où on n’a encore rien entrepris. Mais le rêve d’un autre texte est en train de prendre, lentement, très lentement, plus lentement encore que le désir de se dépouiller de ses vêtements, plus lentement que le temps mis par le cheveu à tomber quand on le jette après le désir : alors je me tiens au pas de la porte, sans oser pour le moment. Ma valise à la main est encore lourde : puis, il me faudra la laisser à l’entrée pour pénétrer.
Heureusement, j’ai l’appareil photo : j’écris encore, intérieurement, des phrases sans mots, pas même des images ; simplement, de brusques poussées de lumière qui me fuit.
De la sauvagerie tendrement couchée sur cette ville que je viens rejoindre dans mon sommeil quand il voudra de moi. Je n’ai rien d’autre.
Si : cette phrase de Kafka :
Au début de la vie, tu as deux tâches : restreindre de plus en plus le cercle qui t’es assigné et vérifier sans cesse que tu ne te caches pas quelque part en dehors.
Le cercle qui m’est assigné, j’apprends à le mesurer. J’apprends à désirer sa démesure aussi. J’apprends peu à peu à l’encercler de cette lumière froide.
Quant au dehors : j’apprends la troisième tâche de vérifier au dehors que je ne m’y trouve pas. Oui, chercher et ne pas m’y trouver, afin de m’y rendre, armé, et plus insomniaque que la nuit : trouver ce pont jeté entre moi et le dehors, la solitude et sa déchirure, pour continuer de prendre la route comme on prend la parole, ou la main : dans la sauvagerie et la tendresse.
-
l’heure prime
mercredi 11 janvier 2012

De prime face, qu’on rejoigne le jour d’un bout à l’autre de lui-même, de minuit à minuit, et cela produit dans le corps cette continuité faible du courant qui maintient la lumière dans la pièce, d’après le silence qu’il fait, on peut entendre le courant, la vibration infime qui traverse, jette les ombres qui recouvrent les fissures sur le mur ;
chaque jour, j’apprendrai ainsi comment c’est de mourir chaque jour de le vivre, comment c’est de le naître intérieurement, et de saisir en chacun de ses points les lieux d’intensité les plus sereins, les plus calmes comme sous les bombardement, les espaces qui resteront protégés :
vieille sagesse des combattants : on sait que l’obus ne tombe jamais deux fois dans le même trou : la solution : s’asseoir au milieu du premier trou, dans les amas de corps éparpillés, compter les bombes et les étoiles entrelacées, s’adresser à tout cela comme un tout qui fabriquerait la vie ;
de prime saut, se dresser non dans l’alcamie mais dans les orages tellement forts qu’on ne s’entend pas crier, et avancer dans le silence de son cri lancé au-devant de soi comme une armure, un premier amour, la bouche ouverte, les doigts en sang crispés sur l’arme (mais on sait qu’on a lâché l’arme depuis longtemps, on n’a que son corps, porté à bout de bras), et aller, vers la tranchée plus loin qui tire à vue, aller en fermant les yeux et imaginer la chute des cheveux sur le torse les poignets entourant ses poignets posés sur les draps du lit défait comme du ciel le soir de dix heures, et aller encore, dans le cri de joie qu’on tient comme son dernier amour ;
et ne pas même s’étonner d’être en vie quand on ouvre les yeux, qu’il n’y a rien que du jour blanc prêt à se déchirer, rien que le froid qui se change en buée sur la vitre, rien que soi et la table de travail qui vient recueillir tous les autres en soi, rien que cette vie qui tient de si peu, et debout pourtant, je suis debout cette vie qui avance vers moi quand je lève les yeux sur elle et que je la rejoins, réalise qu’elle n’avance pas mais se laisse ainsi rejoindre, et que je suis vivant de la voir ainsi rejointe en moi, appelé par elle, en cette heure qu’on dit de prime, non parce qu’elle est première, mais parce qu’elle ouvre, une porte levée devant moi non pour arrêter le regard mais pour s’ouvrir sur elle quand j’aurai la clé :
cette clé, je passe des heures à la fabriquer – j’ai tellement rêvé autour des formes de la serrure que je sais composer mentalement l’effraction : j’ai l’instrument qu’il faut et en moi les mots qui viendront la soulever, le bruit des combats ne s’éloignent pas pour autant, mais les combattants se jettent les uns sur les autres pour mesurer leur faiblesse, je le comprends maintenant, dans ma faiblesse qui est ma seule force de vivant :
dans mes mains, la clé : l’agresseur ne sonne pas, non, puisqu’il a la clé ; il y a cette porte quelque part, ce qu’elle ouvre,
-
vingt-neuf fois mille et une nuits
mardi 10 janvier 2012

Jamais su où sur ma main la ligne de chance était gravée ; jamais pu reconnaître la couleur de mes yeux, entendu ma voix sans sursauter et me retourner, lâcher dans l’effroi : qui est là ; jamais su retrancher le nombre des morts en moi ; jamais entendu le bruit de l’eau de pluie tomber sur la plage en pleine nuit ; jamais vu non plus le sommet des toits dans Paris au coucher des soleils ; jamais montée plus haut que la cheville l’eau du Pacifique ; jamais eu froid à Montréal ; jamais levé la tête sur New York et m’entendre dire lève la tête : c’est la ville ; jamais bu la rosée en dehors de mes rêves ; jamais couru plus vite que moi ; jamais ; jamais vécu cinq heures douze du matin, toutes les autres minutes oui, mais pas cinq heure douze ; jamais réussi à compter les étoiles tombées ; jamais parvenu à regarder mes mains dans mes rêves ; jamais croisé mon regard dans mes rêves ; jamais été mordu par un chien dans mes rêves : ni caresser ce chien ensuite pour le consoler ; jamais vu mes cheveux blancs pousser ; jamais baigné dans un autre fleuve que moi ; jamais rêvé en espagnol dans un pays africain ; jamais été dans un pays africain ; jamais su dire autre chose que el manana en espagnol (et encore : avec l’accent chilien) ; jamais su dire : on y va quand ; jamais pris le train au hasard des destinations sur le tableau ; jamais vu l’intérieur du corps ; jamais brûler aucune flamme ; jamais aspiré aucune cendre ; jamais dansé sur les guirlandes ; jamais dansé ; jamais dire : c’est par là ; jamais m’être entendu répondre : oui, par là ; jamais posé sur ma ligne de chance la lame chaude du couteau et serrer le poing ; jamais pleuré en regardant l’étoile s’effacer ; jamais vu la terre après l’orage s’effacer ; jamais autant désiré la lumière en plein ; jamais cru autant essentiel chaque mot ; jamais vu briller autant de siècles ; jamais traversé de si longues coulées de boue et d’ivresse ; jamais tenté le diable jusqu’à le soumettre ; jamais creusé l’horizon de mes soleils aussi large ; jamais cru la mort éternelle ; jamais éprouvé la mélancolie du feu ; jamais approché de si près l’origine et la folie ; jamais voulu le désir comme l’approche de l’origine, de la folie, et du désir réalisé de l’amour désiré ; jamais dit avant ce soir vingt-neuf fois mille et une nuits dressées devant moi dans l’insuffisance d’une vie possible, qu’on réaliserait ni comme un rêve, ni comme un film, mais comme une idée déjà là, joyeuse et belle, soudainement vécue dans la joie et la beauté des choses incarnées pour toujours, parce qu’éprouvées une fois, ici, et maintenant, c’est ici et maintenant où les choses jamais accomplies se promettent pour l’an neuf : non pour le bilan prochain, mais pour le cœur qu’il me restera (cracher même rire) : oui, aligner les jamais comme des promesses : jamais rien d’autre désormais, que cette route prise pour être prise ; jamais d’autres étoiles ; jamais d’autres lignes, ni d’autres chances,
-
fonds obscurs des contes ancestraux
samedi 7 janvier 2012

« puis il retourna à son ouvrage comme si de rien n’était » : c’est là une phrase que nous citons souvent, venue, semble-t-il, d’un fonds obscur de contes ancestraux et qui peut-être ne se trouve dans aucun.
Kafka, aphorisme 108.
Jamais plus que ces derniers jours je n’avais ressenti le besoin de la lumière – évidemment, c’est parce que j’en suis privé. Je compte sur les doigts d’aucune main les fois où j’ai vu le soleil, en deux semaines. Question de circonstances, de manque de chance ? Peut-être. On me raconte que tel jour, on l’a vu, sans erreur, qu’il a été là, à tel moment de l’après-midi : l’heure juste où j’étais dans le métro, ou dans une salle sans fenêtre (il y en a tant de ces salles dans la ville que j’habite ces dernières semaines). Je crois les gens sur parole. Mais je garde le doute pour moi : le soleil est peut-être une chose du passé, comme les chevaux, comme les épées, comme les dieux. Il s’en trouve encore, mais on les regarde justement comme des choses du passé, avec la curiosité de ceux qui savent bien le fin mot de l’histoire, à qui on ne le fait plus ?
Tout à l’heure, sur l’avenue, cette preuve pourtant : un moment d’inattention, et j’étais là pour le voir : le soleil, indéniable, rapide, évident. Bien sûr, le temps que je sorte l’appareil photo, quelques nuages, et c’en était fini, jusqu’à la nuit. Mais tout de même : cela m’a fait la journée.
La lumière est tout ce qu’il reste de la consolation du temps passé à ne pas la voir. Sa promesse est plus grande que ma vie. Son interruption, un don. Quand je reviens au travail, sur la table, l’ordinateur est posé, affiche la page. J’allume la lumière ; les lumières qui viennent de l’intérieur de l’écran répondent à la pression de mes doigts, nomment ma vie. Je me suis éloigné de ces carnets, sans préméditation, parce que l’écriture directement branchée au jour me semble inaccessible ces derniers jours sans lumière : je comprends aujourd’hui que c’est l’absence de lumière qui rendait cette écriture injoignable. Me suis réfugié dans les fictions secondes, des poèmes (comment nommer cela autrement ?) et les voix : ce soir, ici, journal contretemps qui note mon jour, je reviens (pour combien de temps).
Je reviens pour dire ceci : la rareté de cette lumière ; les incidences sur les rapports intérieurs qu’on entretient avec la vitesse des choses ; la rétraction puissante qu’elle implique, qu’elle impose, en soi.
Je reviens seulement pour ajouter enfin cela : que la lumière est une croyance, qu’en elle on lui confie tout. Sa fragilité est la condition de cette vie ; sa possibilité, une rédemption incertaine sur laquelle on adosse le présent comme une éternité. Un jour, peut-être recommencera-t-on à courir, le dos nu, sur l’herbe légèrement brûlée par le soleil, cheveux collés aux tempes par la sueur – un jour, peut-être qu’on aura soif de nouveau : cela semble tellement impossible. J’ai oublié la sécheresse de la gorge quand on a soif : j’ai oublié cette sensation qui seule me rend la vie possible. J’ai oublié que la vie en son présent pouvait se vivre comme des éternités successives.
Pardon : ces mots sont larges, je n’en dispose pas d’autres.
Moi, je l’ai vue, cette lumière passée devant moi pour s’effacer (pour dire : vois, je sais aussi produire cela, l’effacement de mon passage). Que l’effacement soit ma façon de resplendir, dit le poète. Il parlait pour demain. Aujourd’hui, l’obscur tient lieu de regard, pour moi. Le traverser, y survivre, est une tâche de chaque heure. En attendant, tenir tête – sur la page, arracher à chaque mot la lumière laissée comme une trace, de cette trace, approcher de son signe.
Dehors, le jour grandit un jour après l’autre jusqu’à me rejoindre, quand ? — moi, je serai là.
-
« Napoléon en haillons (et les mots qu’il disait) »
jeudi 29 décembre 2011
[…] Princess on the steeple and all the pretty people
They’re drinkin’, thinkin’ that they got it made
Exchanging all kinds of precious gifts and things
But you’d better lift your diamond ring, you’d better pawn it babe
You used to be so amused
At Napoleon in rags and the language that he used
Go to him now, he calls you, you can’t refuse
When you got nothing, you got nothing to lose
You’re invisible now, you got no secrets to conceal. […](no direction home) Mots-clés
-
solstice intérieur
jeudi 22 décembre 2011

Toi que la nuit constellée enfante en s’éteignant, [1] Au jour le plus court, moi terrassé de la ville, jette un dernier regard au dernier jour éclairé en moi du temps passé à l’épuiser – toujours au solstice d’hiver cette sensation en moi : rétraction de toutes choses au dedans du corps qui signe la concentration extrême du temps : chaque seconde éprouvée en son entier, oh si rare cette sensation, et de douleur, l’épuisement du temps, briser le sablier découlé accéléré comme si la peau était une main tendue qui ne retenait rien que de la poussière de sable tombante toujours montante encore jusqu’au ciel descendu lui-même à l’encre : à peine levé le ciel, que déjà.
Toi dont la nuit endort les feux à ton coucher, Tous les vingt-et-un décembre, mêmes sensations, mêmes morts intérieurs qu’il me revient de coucher, et de porter le deuil le soir venu décombres, mes mains en mausolée ; vieille superstition : le jour tellement rétréci, comment croire qu’il ne va pas rejoindre la nuit dans la nuit et s’y confondre, abîme, des corps à corps coïncidés au désir des morsures, des sexes de nuit et de jour entrelacés, éclats de jouissance à la jonction de l’œil, cheveux en désordre mêlés sous la brûlure de l’eau, lèvres absentes de mots qui disent : je suis à toi, maintenant ; oui, comment ne pas penser que le jour à force d’approcher la nuit ne va pas fatalement se retourner en elle et y dormir pour toujours. Tous les vingt-et-un décembre, moi, je suis le dernier croyant de cela, oui. Moi, je me tiens, vers cinq heures, fidèle d’une religion, litturgie au plus simple : je me tiens droit sur le bord de cette croyance, et je regarde cela, qui s’efface pour moi seul. Et c’est comme un spectacle qui a lieu pour moi seul. D’ailleurs, il a lieu.
Soleil, Soleil, je t’en supplie, révèle moi Perdue la folie des sacrifices, des corps éventrés pour satisfaire aux dieux leur caprice de lumière : et que faire donc, désormais, pour que le jour revienne, dis moi – moi je dirais tous les mots qu’il faut. Il se trouve que le jour revient alors que je n’ai rien dit, ne sachant que dire. Je ne sais pas ce qui tient du miracle, ou du hasard : folie de cette folie qui n’obéit à aucune croyance.
Où séjourne, oui où, le fils d’Alcmène Oui mais j’ai pour moi les vers de Sophocle : ce jour-là, ils sauvent. Chaque année, je dois me trouver un stratagème pour survivre à ce jour, pour accepter la rapidité de ce jour. C’est la leçon de ces dernières semaines : savoir accepter le mouvement, ce qu’il apporte, ce qu’il suscite. Le jour tombe, moi, je viendrai le ramasser là où il est tombé, à l’endroit précis de sa chute.
Astre resplendisant de lumière ! Le lendemain (aujourd’hui), le jour s’allonge comme un corps, le désir de ces coïncidences quand sur un corps il vient s’allonger : et allongé en lui le désir de lui appartenir. L’année recommence en moi ainsi, dans cette joie un peu vive des deuils qui inaugurent leur vie. L’année recommence maintenant, comme tous les ans pour moi maintenant, non pas le premier de l’an, mais dans le jour tombé du vingt-deux, quand il vient prolonger d’une minute le jour de la veille : c’est ainsi, comme dans Melancholia, la mesure de ce qu’on arrache à la lumière, que je mesure en moi ainsi : la vie prise de violence à tout ce qui s’y oppose. La renaissance est soudaine, violente dans le corps et l’esprit, salvatrice en tout.
Est-ce aux détroits marins
Ou à la jonction des deux continents ?Une ligne après l’autre arrachée dans ce deuil des morts en moi qui vivent pour toujours d’avoir été brûlés. Lumière du soleil invente en moi, à l’instant de l’année qui vient vers moi, la vie que je n’ai pas encore, que j’aurai, j’en suis sûr, puisque je l’arrache à cette lumière là, de cendres éparpillées quand je pose le premier pas.
Dis-le nous, Œil sans égal en acuité. -
la pluie sauve
dimanche 18 décembre 2011

— Douceurs ! — les feux à la pluie du vent de diamants jetée par le cœur terrestre éternellement carbonisé pour nous. — Ô monde ! —
Rimb.
La pluie est cette puissance de déflagration dans ma vie qui recommence le temps, ces intervalles irréguliers et fabuleux qui prennent possession de tout, battent un rythme unique, continue, recommencé : la pluie est tout ce qu’il me reste quand je suis dehors, sans clé, sans armure ni protection d’aucune sorte. La pluie me sauve pour toujours, je me penche sur elle : elle me dit de choisir entre certaines de ses chutes : je prends tout, écrirai en travers elle comme d’un corps noyé dans la baignoire tiède, le visage tendu vers moi, la part secrète : pour réclamer que j’y prenne part.
Là où la pluie tombe, il faut poser le corps : alors je le pose, ici, à cet endroit précis de la terre où elle s’effondre, selon les lois précises et inconnues, oui, là pour en recevoir chaque goutte.
La pluie ne tombe que pour cela, et pour nous, qui l’acceptons.
Ainsi : cette pluie à l’envers des corps — la pluie montée depuis le corps jusqu’aux larmes, qui tomberont en retour (cycle infini) sur le sol pour laver toute cette eau descendue jusqu’à nous : finira par monter jusqu’aux chevilles, aux genoux, au sexe, à la gorge avalée de salive pour noyer les derniers mots qui les diront aux soupirs gercés jusqu’au sang.
Ici, au lieu même du passé : le présent continue, c’est le miracle. Cette ville change de place à mesure qu’on la marche : sous les Pyramides, l’eau qui coulait sur les vitres tombent maintenant depuis le plus haut du ciel toutes les larmes de nos corps : conjuration de la douleur. Nous sommes là pour en recevoir la Chute, et ce n’est pas la condamnation de l’homme, seulement sa rédemption : oui : nous sommes là pour cela, qui l’acceptons.
Chute des corps effondrés plus lentement que la lenteur même, un voile qu’on jetterait sur de la terre, et qui s’envolerait un peu avant de retomber, sans secousse, majestueusement lent pour inonder tout ce qui s’est retiré : au creux du corps, cet espace sans nom que l’eau remplit figure l’âme vive de mon corps suspendu à sa seule jouissance.
Pluie qui lave d’une seule fois et sauve.
Je lève les yeux : entre le ciel et moi, il n’y a que de la ville, son corps immense pressé contre moi pour ne pas qu’il m’échappe : sentir en lui combien je lui appartiens ; ce qui me lie à lui, sécrétion intime qui jaillit de moi et de lui (comment le savoir), le vers séminal d’une pluie aux douze syllabes recommencées douze fois par seconde, rythme, formes, pulsations soudaines, mystères des harmonies intérieures qui nomment dans ce bruit le nom de la ville, le nom de la ville, le nom de la ville, le nom de la ville, et ce désir, oh.
Vitesse immédiate de la pluie.
Ce qui se lave, quand je me penche pour la boire sur ces lèvres, celles de la pluie, cheveux de cette pluie noués sur toutes les façades de Paris oh dressée d’écume noire, je recueille autant le mystère de sa naissance, que le fruit de son origine intacte ; elle dit : il faut partir maintenant, allons, recommençons de marcher, si tu es là pour la soif, je suis là pour la faim, qui dit : allons, nous marcherons d’autres villes sous d’autres pluies centenaires, nous marcherons d’autres vies qui les inventeront ainsi, magnifiques, tombées sur le sol à mesure de la pluie brûlée sur la peau comme de la joie, allons [2]
-
toute folie bue
vendredi 16 décembre 2011

Dans ma vaste ville – c’est la nuit.
De ma maison en sommeil, je vais – loin
Et l’on pense : c’est une femme, une fille –
Mais je me rappelais seulement – la nuit.Fenêtre ouverte dans le vide : ici, posée au plafond, trois mètres du sol, comment l’atteindre : sans doute pour empêcher cela précisément, de l’atteindre – interrompre le ciel en nous, le rendre impossible, et qu’on lève les yeux vers lui, toujours, sans espoir de le voir jamais : ainsi cette ville. Ainsi, cette nuit. Sous la pluie pourtant, laisser la marche faire en soi le travail. Se laver au-dedans de soi de tout ce qui pèse, la fatigue, l’impossible, la folie de marcher encore au-delà.
Le vent de juillet me balaie – la route,
Quelque part, à une fenêtre de la musique – à peine.
Ah, qu’il souffle maintenant jusqu’à l’aube – le vent
Par les frêles parois de ma poitrine – dans ma poitrine.Fenêtre comme un œil posé sur soi qui ne regarde de moi que mon dehors ; je suis plein d’impatiences, oui, tout fabriqué d’un précipité noir et blanc (comme vierge de tous mots à dire, peut-être). Accepter les correspondances, prendre au pied de la lettre les signes pour chercher en eux les appels au dehors : la porte est ouverte pour la franchir. Elle est fermée pour être franchie, aussi. La pluie tombera toujours sur ces évidences. Et de si haut qu’elle puisse m’atteindre, elle ne frappera jamais ces lieux secrets du corps où la salive se change dans les larmes aux puissances de s’écrire, toute folie bue, du jour passé comme la nuit à les échangers l’un et l’autre dans le corps comme les liquides de la tempérance.
Il y a un peuplier noir, à une fenêtre – une lueur,
Un tintement dans une tour et dans la main – une fleur,
Et il y a ce pas- personne – il ne suit,
Et il y a cette ombre, mais moi – je ne suis.
Fenêtre comme une chaise, simple chaise basse pour la prière : la table d’écriture – on s’y penche pour mieux voir, mieux dévorer les lèvres. Au lieu même de la déchirure, penser la plaie secrète et la déchirer elle-même, qu’il ne reste que des lambeaux tombés comme de la pluie, tombés avec la pluie : et ruisseler avec elle, en elle. Cheveux collés aux tempes des façades : traverser la rue comme un miroir, dans la peur des voitures, du cri qui pourrait renverser : traverser la rue comme le jour, l’émerveillement : « Avance sur ta route, car elle n’existe que par ta marche » disent les siècles passés ; et la route avance en moi alors, car la marche n’existe plus que par moi ; oh que la nuit vienne.
Les feux sont des fils de colliers d’or,
J’ai le goût de la feuille de nuit – dans la bouche,
Libérez-vous des liens du jour,
Amis, sachez-le, je vous parais en rêve.
[3]
[1] _Les Trachiniennes, Sophocle, traduction Robert Davreu, Actes Sud, 2011, (Parodos du Chœur).
[2] _texte fantôme : écrit avant-hier, mais avalé par l’ordinateur : dans la violence de la perte, ne rien écrire d’abord, parce que la douleur est telle qu’on ne peut rien dire, à trois heures du matin, pour l’apaiser dans l’écriture qui ne fera de tout façon que mimer le geste premier sans jamais le rejoindre : restent quelques phrases. Je reprendrai ces phrases, le lendemain, sans pouvoir d’abord éprouver autre chose que la démangeaison du membre fantôme, bras ou jambe amputé dont la blessure gratte encore. Ce soir seulement, j’écris, mais avec tout ce qui s’est déposé depuis trois jours, comment l’accepter : accepter que ce texte ne dise pas tout ni même partie de ce qu’il disait, à l’origine. Il n’y a pas d’origine, je le comprends à présent. Il faut accepter la perte, et la comprendre : si le texte premier n’a pas été gardé, du moins aurais-je pour moi la joie d’avoir pu l’écrire, une première fois (texte qui m’importait plus que d’autre, oui) ; si elles n’existeront jamais, ces quelques lignes que personne ne lira (que personne n’aurait lues, de toute façon), du moins auront-elles été dites, sans doute pour être oubliées. On apprend une chose de ces douleurs, cela : on écrit toujours dans cet oubli, concédé, ou accordé par la beauté des choses. Une seconde aussi : si le site entièrement devait être emporté, ce n’est pas ma vie qui s’effacerait, mais la part arrachée à cet oubli, rien de plus (mais rien de moins). Si le site disparaissait, je l’accepterais comme un présent. Au lieu de tout réécrire, ou de l’expliquer comme je le fais maintenant, avec toute la maladresse de ce deuil encore en moi, dans les marges du texte qui servent surtout à ne pas être lues, peut-être irai-je dans les territoires non visités de moi : incitation à y aller tant qu’il est temps, et dès maintenant ? Oui, sans doute. En attendant : ces phrases déchirées, celles que j’ai pu extraire de la perte : je n’ai pas cherché finalement à en reproduire l’exacte formulation première, seulement un rythme, une pression, une exigence intérieure dans le désir de la ville : et surtout, le goût de la pluie, quand se produit l’échange de la douleur avec la joie.
[3] _17 juin 1916, Moscou, Tsvétaiéva, Insomnie.