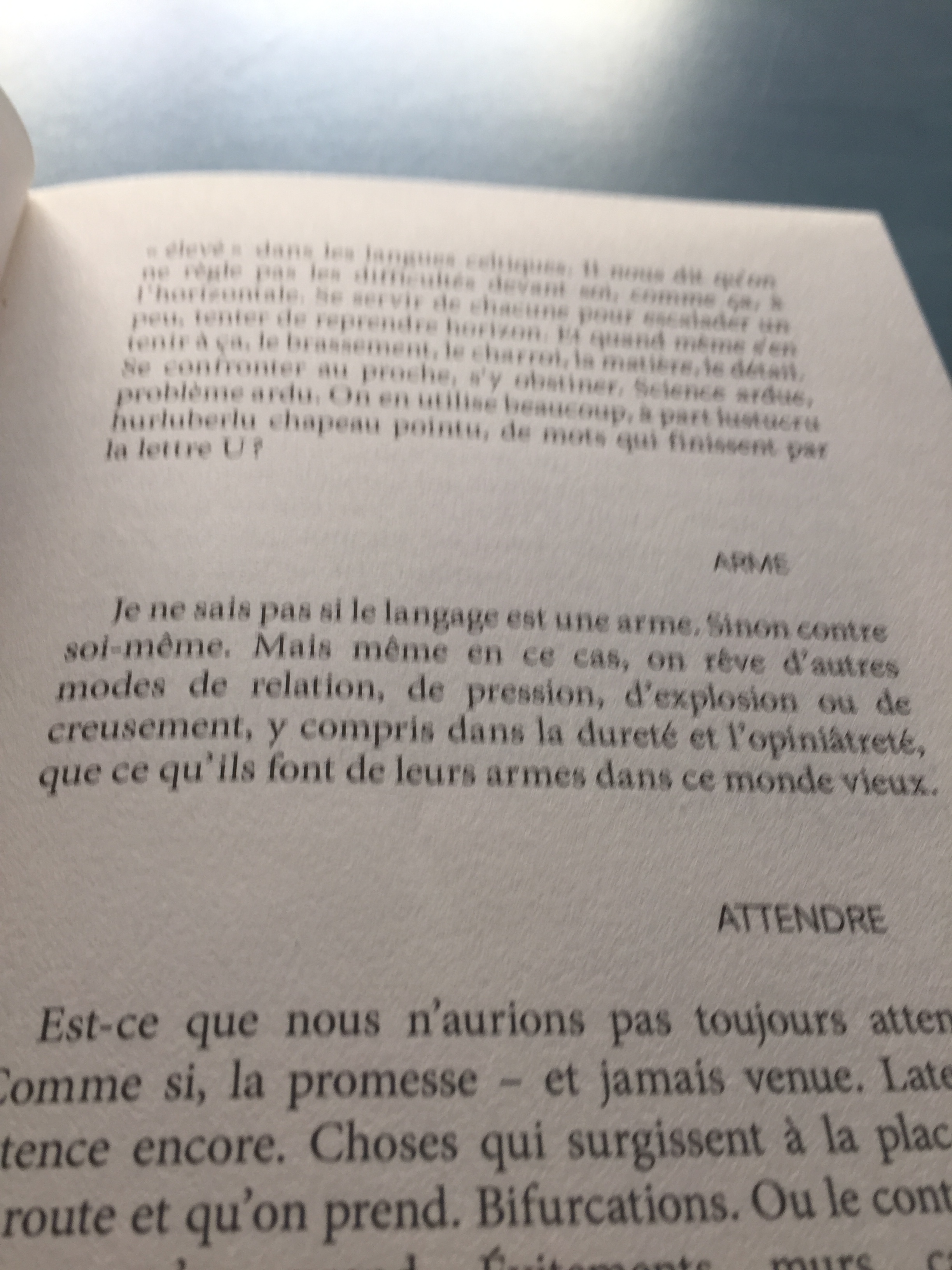Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
-
Marseille est une ville impossible
vendredi 8 janvier 2016
Marseille est une ville impossible. Ils lèvent cette ville comme du ciel. Par pelletées de nuages et en écrivant sur tous les murs des lettres dans le désordre. La mer touche un peu de la montagne, ou est-ce l’inverse ? Il y a des routes qui longent des routes, et plusieurs centres que rien ne relie. Il y a ce type près d’ici, tout près de l’endroit où je prendrai l’image de cette grue par-dessus l’arbre qui retient les dernières feuilles de l’automne, au cœur de l’hiver, ce type qui dort par terre et tous les matins lit le journal en commentant les nouvelles, à haute voix. Il y a cette femme tout à l’heure qui frappait à la porte de l’immeuble juste à côté de lui, qui frappait doucement, doucement, peut-être depuis une demi-heure, peut-être depuis des heures, et quand je suis parti, qui frappait encore, doucement, le regard terrible.
Les points d’exclamation comme des bras ouverts au ciel vide. Affiche qui pourrait être là depuis des années, et pour des années, qu’on n’arrache même plus. C’est au rond-point du Massalia, cette affiche sous la pluie, dans un angle de rue où personne ne passe. Les points d’exclamation lancent le souvenir (Eurydice ! Eurydice ! Oh Dio ! Rispondi ! Io son pure il tuo fedel ! Euridice ! Euridice ! Ah ! non m’avanza Più soccorso, più speranza, Né dal mondo, né dal ciel ! Che farò senza Euridice ? Dove andrò senza il mio ben) Que ferai-je sans Eurydice.
Regarder le ciel vide est ici une tâche de chaque jour.
Lire la ville aussi, sur les murs qui l’écrivent comme sa légende. Un corps éventré où tous se jetteraient pour griffer entrailles et mordre la peau. La ville à la bousille, oui.
Sa peau tatouée à vif. Je t’aime voleur à peine déchiffrable, les cris d’amour sont autant de cris de douleur. Regarder cette ville seulement dans ces mots qui finissent par raconter la plus belle histoire du monde, sans ordre et sans personnage, seulement des voix aux échos provisoires.
Même les écoles sont des lambeaux d’étoffe que la main vient saccager avec toute la beauté du monde.
Ville palimpseste, mais sans mémoire. « Entre le palimpseste qui porte, superposées l’une sur l’autre, une tragédie grecque, une légende monacale et une histoire de chevalerie, et le palimpseste divin créé par Dieu, qui est notre incommensurable mémoire, se présente cette différence, que dans le premier il y a comme un chaos fantastique, grotesque, une collision entre des éléments hétérogènes ; tandis que dans le second la fatalité du tempérament met forcément une harmonie parmi les éléments les plus disparates » écrivait Baudelaire, qui s’il avait connu Marseille, aurait jeté son œuvre au feu et prononcé ses crénom dix ans plus tôt.
-
derniers ciels
dimanche 3 janvier 2016
Derniers ciels de l’année – comme l’image d’un épuisement continu qui n’arrive pas s’achever. Là haut, même la neige ne tombe plus ; la terre recouvre tout. Là-haut, il n’y a de la place que pour le silence, et il est grand.
On marche à travers le froid comme dans ses pensées : lentement, en espérant que la nuit ne sera pas si longue.
Se dire en regardant le ciel tombé une dernière fois ici, sur le visage : ce n’est pas à cela que ressemble le début.
Premiers ciels de l’année : c’est le même qu’en partant, le même qu’hier et qu’autrefois, le même que pour le reste des temps tant qu’il en reste, et cependant : lever les yeux sur lui : se dire c’est le premier ciel de l’année fait de lui le premier ciel de l’année, c’est tout.
On marcherait dans cette croyance qui est le contraire de la foi : plutôt le sentiment d’une promesse. Elle lierait, en dehors de toute réalité, soi et le reste du monde.
Se dire qu’entre ces deux extrémités, entre ces deux impossibles, il y aurait tout ce que la ville pourrait proposer, et qu’elle refuse. Par exemple : ce ciel, ce soir, et derrière, la possibilité d’en rejoindre la promesse et la foi.
Mots-clés
-
les perspectives bleuâtres
samedi 26 décembre 2015
Ce système d’histoire, emprunté aux traditions orientales, commençait par l’heureux accord des Puissances de la nature, qui formulaient et organisaient l’univers. — Pendant la nuit qui précéda mon travail, je m’étais cru transporté dans une planète obscure où se débattaient les premiers germes de la création.
Là s’échapperaient l’année et tout avec elle. Peut-être recommencerait avec la nuit, le reste aussi. Dans Luxembourg, la lumière de l’après-midi est celle de l’aube, et de la nuit tombante. Un crépuscule d’un bout à l’autre de l’horizon. Y puiser une image de l’histoire : où le jour commence et s’achève, un seul mot est là pour le dire. Le crépuscule comme situation historique. On se réveillerait à n’importe quelle heure du jour, on verrait étale le ciel s’effondrer et se dresser à la fois. Les hommes, eux, passeraient lentement. Certains prendraient des photos. La plupart resteraient chez eux, en attendant le lendemain. Plus rares seraient ceux qui prendraient des forces pour la nuit.
Du sein de l’argile encore molle s’élevaient des palmiers gigantesques, des euphorbes vénéneux et des acanthes tortillées autour des cactus ; — les figures arides des rochers s’élançaient comme des squelettes de cette ébauche de création, et de hideux reptiles serpentaient, s’élargissaient ou s’arrondissaient au milieu de l’inextricable réseau d’une végétation sauvage.
La tentation de tourner le dos au monde. De tourner le dos aux faiseurs de mondes impossibles. La tentation de ne plus y croire : et celle, surtout, de renoncer à croire, comme à ne pas croire. De renoncer à l’idée même de croyance. D’être celui qui marche dans Luxembourg éteint en désirant voir ici une image de notre histoire, et regardant par dessus les grilles, les fenêtres des hommes, jugeant à la lumière dans les salons la force d’affronter le jour et la nuit – et pensant : c’est encore une croyance. Le soir, je relirai peut-être Aurélia, sans autre pensée, toujours la même, que celle d’un homme pendu à la lanterne près de Châtelet, et dont la dernière pensée fut peut-être pour le jour ; telle est ma croyance. Et dans la chaîne des pensées et des croyances, de la lumière et de la nuit, de l’année qui s’achève pour engendrer l’année qui va commencer, je ne sais quel est le piège : celui de la croyance ou de son refus. Reste, comme image ultime de l’année : marchant dans Luxembourg presque éteint, cette statue que j’ai prise pour la représentation d’une tragédienne, et qui n’était que la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans, des artistes et des maîtres d’école. Pot pourri de croyance où pourrissent les croyances et les renoncements, où pourrissent le jour et la nuit, et les artistes et les maîtres d’école : tendresse et pensée à ceux qui leur survivent, la nuit.
La pâle lumière des astres éclairait seule les perspectives bleuâtres de cet étrange horizon ; cependant, à mesure que ces créations se formaient, une étoile plus lumineuse y puisait les germes de la clarté [1].
-
plongée dans l’année qui s’achève
lundi 21 décembre 2015
La nostalgie est une structure du temps humain qui fait songer au solstice dans le ciel.
Pascal Quignard, Abîmes
Il est seize heures cinquante-six, et le jour est tombé un peu partout dans cette ville. Demain à huit heures quarante-et-un, il se lèvera peut-être quelque part, mais où ? C’est la plus longue nuit de cette année, et c’est ainsi le jour qui dit le mieux l’année passée, l’année en cours pas encore passée. À quatre heures quarante-huit, ce sera la pointe du jour et de la nuit, le moment ramassé sur lui. Combien serons-nous à regarder le ciel noir, cette heure-là ?
Plongée dans l’année, entièrement arrivée là, ce jour qui aura été produit par tous ces jours ensemble, de cette année entièrement achevée jusqu’à lui. Toute cette année pour ce jour amassé en lui, amassant cette année. Tous les ans pour moi (déjà en 2010, ou en 2013, ou l’an dernier il y a des éternités) par exemple, un même rite : écrire le solstice simplement pour le déposer quelque part, et si c’est ici, c’est tant pis pour moi, et non tant pis pour le solstice. Toute une année perdue, on dirait : dans ce jour perdu lui aussi sous la nuit qui commence déjà.
Dans la librairie, ce livre de Michaux perdu au milieu des romans étrangers. J’ai trouvé le signe suffisamment beau et éloquent pour l’emporter : Moments (Traversées du temps). J’y trouve ces vers si précis, leur langue si radicalement juste
Venant, partant, sans frontières, obstacles fluides à tout parachèvement, détachant et se détachant sans enseigner le détachement,
Moments, bruissements, traversées du Temps.pour nommer ce moment, celui où les moments cessent pour venir s’assembler sur la pointe fine du temps effacé par lui-même.
L’année comme dans le grand silence, mille oiseaux immobiles sur le sol, allant et venant, partant, sans frontières, sur le sol. L’année comme soudain un coup de feu. L’année éparpillée dans la joie d’en finir avec cette année impossible et vaine, l’année dans le ciel qu’on regarde comme du verre brisé dans l’éloignement de mille oiseaux, l’année comme partir, comme aller, comme recommencer le ciel encore, comme une promesse d’inventer le ciel, l’année comme il faudrait qu’elle soit et comme elle ne sera pas, l’année comme plongée encore, mais cette fois vers la surface, et continuer encore d’aller encore malgré le coup de feu et malgré le ciel, et malgré la surface, encore, comme lever les yeux.
-
Paris, le froid et l’exil
jeudi 26 novembre 2015
C’est le froid soudain. L’entrée dans une saison qu’on sait déjà infinie, celle de la nuit dès cinq heures, des manteaux lourds, de la neige bientôt et des cafés brûlants, de la guerre et des raisons qu’on nous trouvera pour l’accepter, du cadavre du premier homme tombé dehors dans la rue, de l’annonce à la radio du premier mort de froid, de son nom qui restera inconnu, c’est la ville quand elle rentre chez elle et qu’elle allume les lumières dans son ventre, et que le dernier ferme la porte, c’est la saison des frontières et des élections perdues, de la paire de gants que je laisserai fatalement dans un bus, de l’odeur des marrons brûlés à la sortie du métro, c’est tout cela qui commence comme toujours par simplement ce regard vers le ciel et le sentiment d’une année pas encore passée, de l’année pas encore nouvelle.
C’est cette semaine le retour à Paris comme un exil ; l’apprentissage de la ville par ses souterrains : de Pantin à Alfortville, c’est traverser la ville seulement sous sa peau ; c’est écrire ensemble dans cette salle chauffée un texte destiné à n’être pas un texte, c’est penser les corps à l’endroit où ils pourraient s’inventer, c’est peut-être se tromper, c’est se tromper et recommencer ; c’est apprendre à être loin ici ; c’est Paris comme de la pluie, celle qu’on voudrait traverser le plus vite possible pour s’en éloigner et pourtant ; c’est dormir à peine ; c’est penser comme le ciel manque, comme manque surtout ce qui donne à la vie ce qui la justifie ; c’est rêver la vie naître vraiment et plus sûrement que sur la page et les scènes vides ; c’est adresser ces dernières pensées à cette vie-là le soir et les premières le matin ;
et c’est regarder le soir Vertigo sur la ville éteinte.
-
semaine des désirs furieux et du chaos fragile
dimanche 22 novembre 2015
Semaine dans le décompte des morts, et comme arrêtée sur vendredi dernier des carnages. Semaine des bavardages ignobles, des avis, des appels. Que la vie continue. Mais laquelle ?
On entend prononcer le mot guerre. Pour s’autoriser le mot guerre, on demande à corriger les ordonnances de 1955, trop lointaines, trop guerrières aussi : une époque où ces ordonnances avaient été établies pour récuser le mot guerre, lui préférer celui d’événements. Cette histoire est la nôtre : elle renverse les mots pour en renverser l’usage.
Risques d’effondrement.
Semaine où pour conjurer les folies meurtrières de ceux qui tuaient au nom de la religion, on lance les mots d’ordre de prière. On affiche des drapeaux. On panse les plaies avec le sel des larmes comme pour préparer les blessures à venir.
Désir furieux de prendre le large. Le prendre.
En début de semaine, une journée au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Pendant que forais dans la voix d’Antonin Artaud, sans doute les types étaient suivis jusqu’à leur appartement, qu’on s’apprenait à prendre d’assaut. Contemporain de ce monde, de cette ville. Le soir, je rentre en train. Que s’éloignent le ciel et les grenades offensives. Trois heures plus tard, je dormirai mille kilomètres au sud quand un des hommes actionnera sa ceinture d’explosifs, à deux cent mètres de là où le midi même j’étais passé.
Marseille, dernier cours de littérature du semestre. Ces trois derniers mois, traverser des lignes courbes de récits intérieurs. Marguerite Duras et Écrire ; puis Henri Michaux et Passages ; et enfin François Bon et Fragments du Dedans. Lire l’entrée Arme, convoquer non pas vraiment l’ébranlement ou l’interrogation, mais aussi la force de proposition dans ces temps où refuser les armes, c’est aussi choisir son monde, même tremblé d’incertitude.
Marseille de nouveau. Soudain un grand froid posé sur la ville. Dans une rue proche d’ici, cette écriture nouvelle (je passe là presque chaque jour) : condamné à être libre [2]. Et sur le côté, ce ACAB rageur.
Et soudain cet homme qui passera et qui regardera l’inscription, sans doute parce que je la prends en photo – cet homme donc que je prends en photo, aussi. Dans tout ce jeu de regard et d’ignorance, de violence muette, d’adresse indirecte, imaginer le froid. Penser que cela n’a rien à voir. À part que notre corps, centralité fragile, est au milieu du chaos qui s’organise lentement tout autour de nous. Et que les hommes passent sur les libertés condamnées, ou sur la condamnation muette. Et que d’autres les voient passer en pensant : où et quand sommes-nous ?
-
lendemains, guerres et larges
mercredi 18 novembre 2015

Puisque tout ce qu’on écrirait ferait honte à ces jours. Et puisque ne pas écrire sur ces jours, ferait honte, aussi. C’est le piège. La tentation du large comme une façon de se sauver de ces laideurs : ou de fuir en lâche ? Aucune issue peut-être. Mais ne pas s’en tenir là.
Ces jours de tuerie, on ne comprend rien. On regarde les infos en temps réel : le temps réel, on le reconnaît à ce qu’il ne produit que de l’attente. Sur les chaînes d’info en continu, des bandeaux "URGENT" défilent, avec la mention : pas d’information pour le moment.
C’est le triomphe du conditionnel, dont souvent on se passe pour faire du temps celui de la rumeur qui dévaste.
On ne saisit toujours qu’en retard. Le compte des morts arrive après les salves. Avant les noms. Et après les visages. (Sur les réseaux, ces proches qui déposent les portraits de ceux qui manquent dans l’espoir que. Terrible mur de visages vendredi soir dernier, où défilaient des vivants qui étaient déjà morts.)
C’est le propre de l’Histoire quand elle a lieu : qu’elle se dérobe sous nos pieds. Viendra le temps de la pensée, puis celle, sans doute, de l’action. Pour l’heure, passé celui de la sidération et de l’émotion, c’est le temps redoutable et infect des bavardages, des avis délivrés comme pour se vautrer dans soi-même, et de jouir de la lâcheté d’en posséder un, d’avis, et que dans sa banalité, ils trouvent là leur singularité.
Pendant trois jours évidemment, surtout ne pas écrire qui ajouterait aux mots d’autres mots et la honte.
Penser seulement : dans les massacres, on partage la ville : l’usage tendre qu’on en a fait, tant de fois ; cafés, terrasses, salles de concert, quartiers. On est contemporain de cela aussi, et dans ce partage nu, simple, sans morale ni colère, il y a seulement ce dont soudain on est privé : d’un usage du monde désormais impossible. Les tueries et l’état d’urgence rendent le monde où qu’on regarde maintenant introuvable, relégué aux oubliettes d’une histoire dont un jour on dira : c’était la nôtre.
Dans ces jours, ce n’est pas encore l’avenir qui se dessine, mais c’est du passé soudain qui a surgi et s’est définitivement posé entre nous et vendredi dernier.
Hier, à Saint-Denis, rejoindre le Théâtre Gérard Philippe pour y parler d’Antonin Artaud : être le jour durant à moins d’un kilomètres d’un immeuble dont on donnera l’assaut, cinq heures plus tard. On est donc contemporain aussi de ce temps, de cette ville ? Mais de quoi sera-t-on préservé ?
Ces heures de carnages, on possède peu de certitudes.
Sauf celle de refuser la guerre, évidemment : guerre qu’on nous impose, de part et d’autre d’une ligne de front qui voudrait faire de nous des soldats sur qui on tire, qui pourraient tirer, ou au nom de qui on frapperait, qu’on frapperait au nom de quoi.
Il y a une guerre plus puissante à mener que sur les corps : une guerre intérieure contre le désir de guerre, une guerre au-dehors, avec des armes minuscules qui n’en sont pas pour travailler à la complexité du monde, à son épaisseur.
Cette guerre, où la mener ? On est sur la brèche : refuser la guerre sans être complice de ceux contre qui elle sera menée.
Plutôt la vie ; plutôt la beauté.
Alors que faire ? Minusculement, d’abord l’évidence de se proposer des combats invisibles pour détruire partout la question (par exemple, mais surtout) des origines et l’enjeu des frontières.
Et puis : fabriquer des hypothèses plutôt que des opinions.
Inventer des communautés qui ne soient pas des familles ; ne trouver de patrie que dans l’enfance. Chercher des mots qui ne seraient pas des positions. Gagner des positions qui seront des mouvements. Habiter des failles. Désirer seulement des devenir.
Refuser la guerre non à cause des morts seulement, mais au nom d’eux.
Dimanche, prendre le large, regarder longuement le sang tomber du ciel : dans la lumière trouver les espaces où la fuite serait une conquête non contre les peuples, mais pour en retrouver la possibilité.
















-
ce jour pour adorer la nuit
dimanche 1er novembre 2015

Je me suis enfui.
Ô sorcières, ô misère, ô haine, c’est à vous que mon trésor a été confié !Rimb.
Un jour où adorer la nuit.
Shakespeare fait de cette nuit, du trente-et-un au premier, celle où Capulet conçut Juliette – fille de la mort et de la vie née dans les derniers jours de juillet, les plus brûlants, qui tiennent leur origine des premiers froids d’octobre d’où surgissent la vieille peur des morts et la tendresse qu’on éprouve à leur égard, aussi, pour s’en consoler.
Rien de la mort et de la nuit dans ces jours-là. Rien qu’un jour de plus, de moins, dans la ville qui semble tenir du printemps, sa douceur inoffensive. Ce n’est plus la rentrée depuis longtemps, ce n’est pas encore la fin de l’année, c’est le battement habituel des semaines quand on voudrait qu’il se passe enfin l’éclat et l’intense et qu’il n’y a que cela : le battement entre deux jours.
« Les “moments nuls” dans une vie, en tout état de cause, n’ont toujours pas lieu de nous retenir » – écrivait Gracq, dans une de ces phrases qui tiennent lieu pour moi d’incitation pure, de guide, de boussole et d’appel. Ne rien retenir des moments nuls, les laisser passer en soi ; ou chercher en eux les forces mêmes minuscules qui pourront secouer. Par exemple un jour comme celui-ci : la nuit où on adore les morts pour le sentiment d’être vivant.
Quelque part au Mexique, au Guatemala, on danse. On répand des fleurs coupées et on verse le mezcal pur sur le sol ; on dessine avec l’alcool et les fleurs un chemin jusqu’au cimetière. On déterre les ossements du grand-père ou de l’arrière grand-tante et on les lance en l’air pour jongler avec le ciel la vie qui continue. On chante jusqu’à hurler dans l’ivresse la certitude de n’être pas mort. On rit parfois des cadavres qui pleurent la peine d’être loin.
Quelque part au Mexique et au Guatemala est l’exacte position où je ne suis pas. La nuit qui tombe ici à cette heure est l’aube là-bas. Quand il fera nuit, là-bas, le jour se lèvera déjà et ce sera le lendemain, un jour d’ores et déjà nul et non advenu.
Je songe au Mexique et au Guatemala, je songe à Juliette Capulet qui dort dans les caveaux de ces ancêtres et qui pourrait se réveiller d’une seconde à l’autre, je songe au sourire de Yorick et au regard d’Hamlet déposé sur lui, je songe à tout cela dans le songe de ceux qui au Mexique et au Guatemala ne songent à rien d’autre qu’à boire et rire la mort qui autour d’eux s’éloignent quand ils l’appellent.
Ici, la nuit tombe lentement ; dans cette ville je ne sais toujours pas où sont les cimetières et les ossements d’Artaud (pourtant proches), ni où sont les chants de deuil joyeux, où les cris de joie sur les terreurs, et où les songes des morts sur les vivants ivres morts de mezcal.
-
automne, loin des gens qui meurent sur les saisons
lundi 26 octobre 2015

Des feuilles comme des cadavres encore vifs. La ville et mon bureau en sont jonchés. Hier encore, c’était l’été étouffant ; écrire pour en finir. Et puis, maintenant ? De l’été, je possède encore la trace, plus qu’un souvenir, sa brûlure. Et des pages, rien, si peu. Ce matin, les feuilles qui recouvrent le sol sont des souvenirs perdus – comme des combats perdus – dessinent un chemin qui vient se perdre loin devant soi, vers l’hiver et les nuits longues, la morsure moins féroce du ciel.
Les mots de Verlaine lancent une douleur qu’on dirait parfaite : achevée et ultime.
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleureAprès midi, je sors pour la première fois depuis des jours : quelque chose manque dans les arbres, qui est la chair des arbres. Une chair arrachée et en lambeaux survit encore, mais pour combien de temps. Les arbres comme des écorchés qu’on lisait en secret, enfant, dans les traités d’anatomie. Des bras tendus vers le ciel en désespoir de cause. À leurs pieds, la peau morte des feuilles. Il ne reste dans ces arbres que des morceaux de ciel qu’on voit à travers la nudité qui annonce le froid, qu’on devine dans la couleur jaune des tilleuls argentés de l’avenue. Les nuances d’or remplacent le vert nacré des feuillages : et les trottoirs couverts de feuilles boueuses déjà. En sentir la blessure : je n’ai rien perçu, entre l’été et l’hiver, d’un automne qui n’aura pas eu lieu.

La rue, sur l’image, comme une paroi qu’il faudra gravir. Se servir des feuilles comme autant d’appuis ? S’en saisir à pleines mains pour de l’autre côté passer, atteindre l’année, l’arche de la pluie et des saisons comme disait Claudel, et aller.
Les mots de Rimbaud guérissent.
L’automne, déjà ! — Mais pourquoi regretter un éternel soleil, si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine – loin des gens qui meurent sur les saisons.

Une feuille après l’autre, faut-il chercher une destination, ou un signe ? Celui de l’éparpillement ? De la défaite ? Sa clôture, alors que rien n’avait commencé ? Ou tracé d’une fuite, tangente, hasard joyeux ? Du délire. De la jouissance de s’échapper. De la douceur d’être sur la terre celui qui vient piétiner la mort. Du désir d’entendre sous le pas la brisure du vent. D’être le soir debout quand tombe la pesanteur des arbres. D’être dans le siècle l’ignorance de connaître la fin.
En éprouver la joie. Savoir que ces morts qui nous entourent incitent à chercher les lieux d’où naître et d’où donner naissance ; choisir ces endroits où naître, et désirer cette vie plus qu’ailleurs parce qu’elle est aussi une manière d’en finir avec la mort.
L’automne. Notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel taché de feu et de boue.
Le soir, je lève les yeux vers la ville ; la nuit est tombée lourdement mais sans bruit, plus rapidement qu’une feuille : par dessus les immeubles, et comme accrochée à la grue du chantier tout proche, la lune d’orgueil danse à l’ombre de nuages qui tremblent autour d’elle la vie qu’elle répand jusqu’ici. On pourrait puiser toutes les raisons de penser au soleil qui brûlait Avignon (c’était hier) ; et pourtant : le sentiment que tout commence, encore. De nouveau à la tâche, ouvrir les chantiers, rêver les phrases, inventer les vies – tout commence, encore, toujours.
-
Hong-Kong ville haute, et le nom de ces murs
samedi 24 octobre 2015

La ville, avec sa fumée et ses bruits de métiers, nous suivait très loin dans les chemins. Ô l’autre monde, l’habitation bénie par le ciel et les ombrages !
Rimb., « Ouvriers », Illuminations
Hong-Kong est un mur. Un mur percé de lumières et de bouches d’ombres, un mur levé d’innombrables murs dont pas un ne se ressemble. De Marseille au retour, c’est le souvenir qui reste et insiste. Dès la sortie de l’avion jusqu’au ciel. Un mur non pas d’enceinte, mais intérieur. Dans la ville, le temps d’une escale – rien que de la nuit autour et seulement pour une nuit. De là, vue sur le mur au pied duquel il faudra attendre le lendemain de partir pour Hanoi. Mais comme il sera impossible de dormir – plein jour dans le corps fracassé contre cette nuit –, simplement regarder ces murs de la fenêtre de la chambre, dans le bruit de l’orage battu sur les vitres.
Ce n’est qu’une image. Comme toujours, l’image porte l’expérience minuscule de cette nuit. Une parabole concentrée sur la noirceur de lumières qui s’éteignent peu à peu pour nous laisser face à une opacité brute ; on sait qu’un mur se dresse tout près qui n’est pas différent de la nuit. Une parabole, oui. Pour des voyageurs en jetlag, en transit, murs qui portent le nom d’une autre ville, d’un autre continent, et qui n’est qu’un mur. Derrière, des milliers de corps respirent et dorment avant d’aller épuiser leurs corps sur des chantiers infinis. Derrière ces murs : des corps qui parlent la langue la plus étrangère qui soit, qui est aussi celle la plus parlée dans le monde.

Le chinois est une langue qui se crie. Je ne sais pas comment on dit mur en chinois, ni ville ; j’imagine que ce doit être le même mot. Inévitablement, ce mot ne serait pas très éloigné de celui qui nomme la fatigue, dit l’éloignement, et raconte l’insomnie. On fait d’étranges rêves dans ces nuits où on ne dort pas, durant laquelle on est au pied du mur, séparé du monde depuis le 23e étage par une mince vitre où s’abat le vent du cyclone. On rêve que dans ce mot qui assemble à lui tout ce devant quoi on se trouve, il pourrait se trouver aussi mon propre nom. Et le nom de la ville. Et son contraire. Jusqu’à tous les mots de cette langue qui aurait ainsi résolu le problème du langage. Un seul mot pour tout dresser devant soi. Comme ce mur fait de villes verticales. Et cette ville faite de murs qui dressent l’horizon du réel.
Et puis, à l’aube, je me suis endormi.