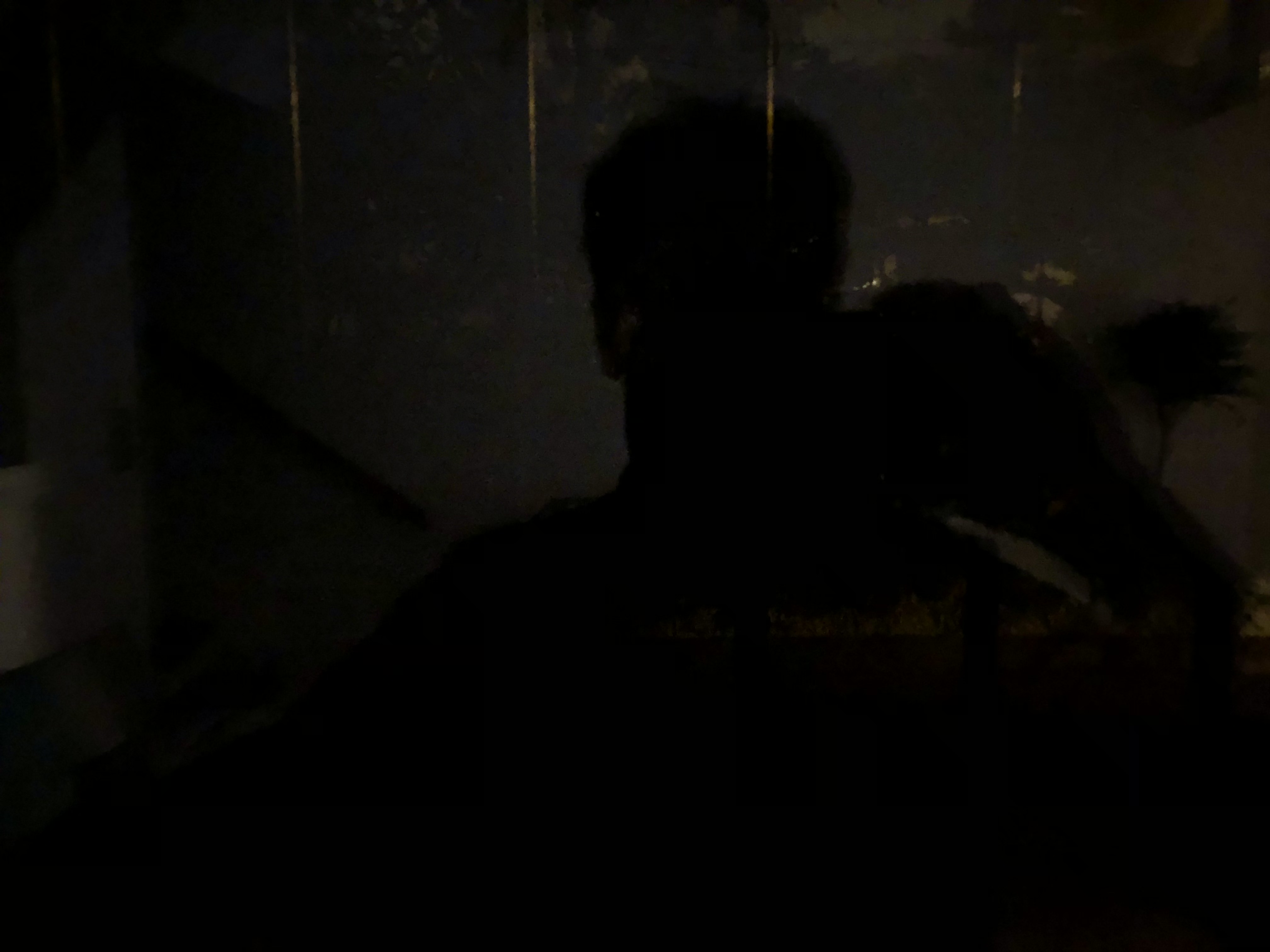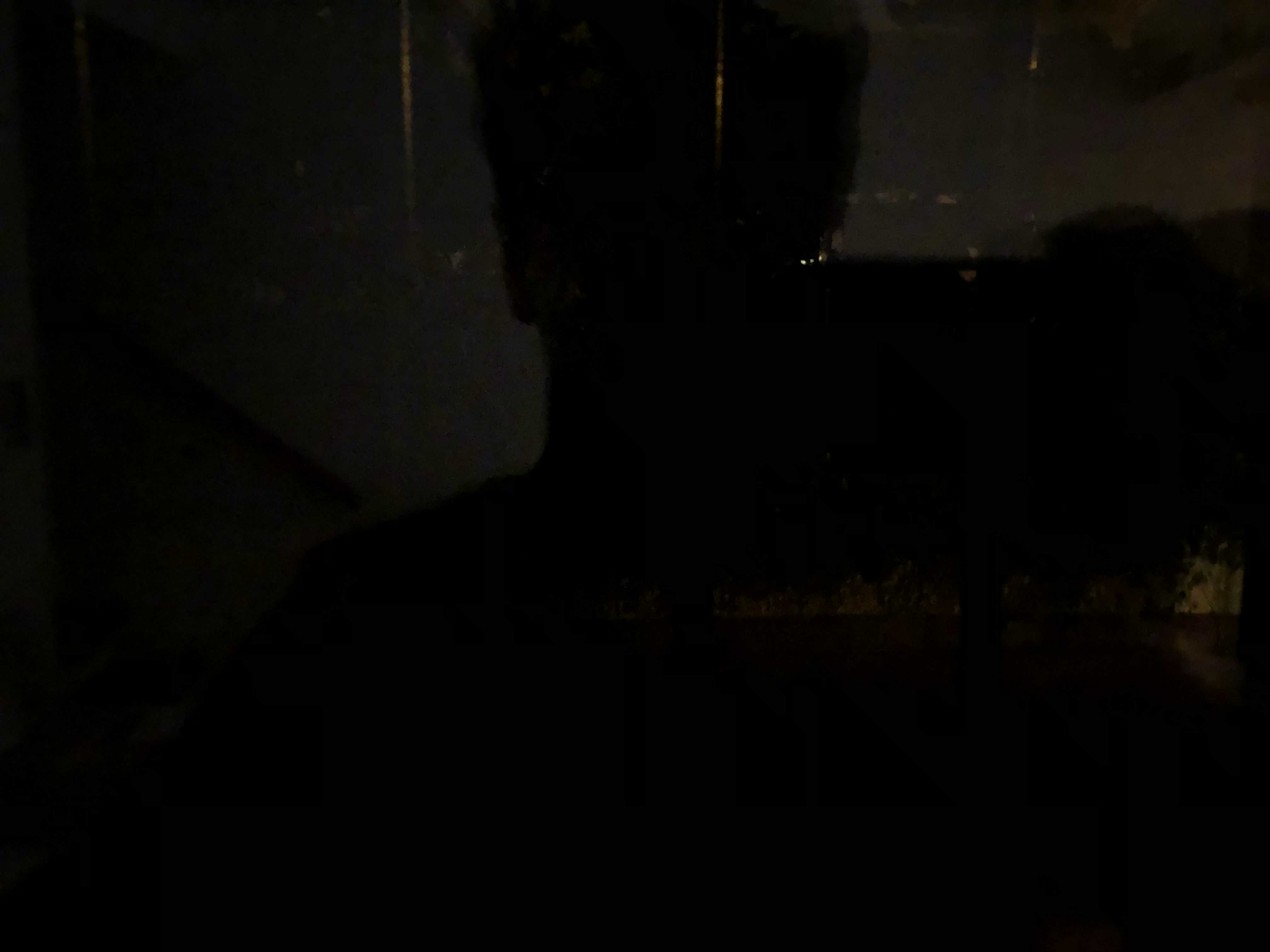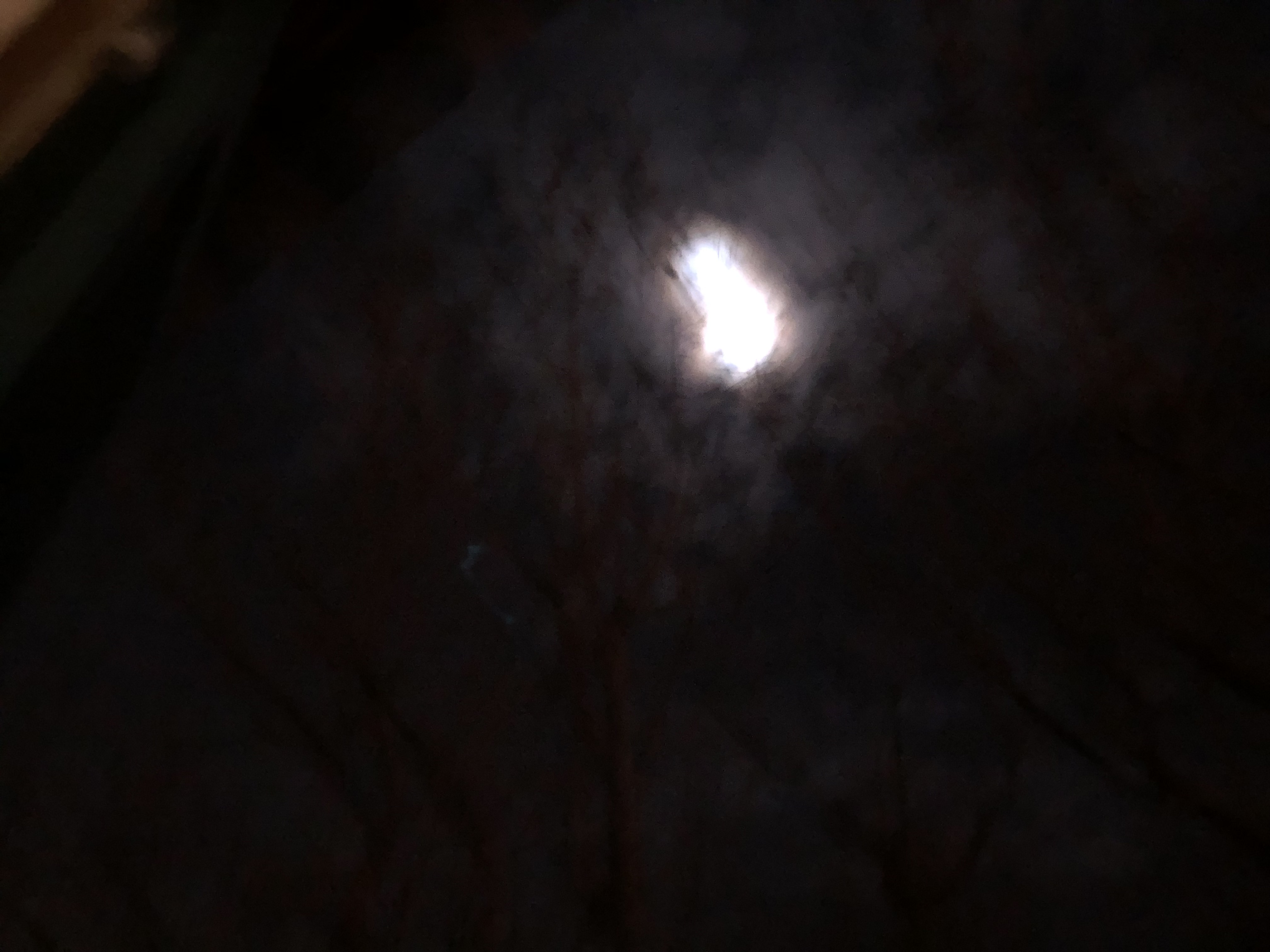Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
-
que le commencement
vendredi 1er février 2019
Elle me dit son nom, celui qu’elle s’est choisi : « Nadja, parce qu’en russe c’est le commencement du mot espérance, et parce que ce n’en est que le commencement. »
André Breton, Nadja
Regina Spektor, Begin To Hope
(Live, 1er avril 2005)
Il y a des jours insupportables que quelques heures justifient pourtant. C’est le bleu des heures arrachées aux heures perdues, c’est courir, c’est perdre haleine, c’est cette musique ce soir, c’est le ciel livré aux animaux seuls, c’est le bruit de pas dans l’escalier du matin, c’est la force des foules aussi, c’est quelques phrases sur un plateau de théâtre au milieu de l’ennui terrible, c’est Pasolini quand il écrit le mot rage, c’est mon aversion pour les listes qui passe aussi par l’établissement de telle liste pour en finir avec, c’est la forme des mains quand elles reposent, c’est les yeux fermés quand on les regarde : c’est voler quelque chose à soi-même.
C’est tout cela, et c’est aussi : ce qui n’a pas de nom dans aucune langue.
Le vent fait un bruit terrible dehors, j’ai l’impression qu’il m’appelle ; il crie plutôt – il fuit. Son ombre peut-être ? Lui aussi cherche sans doute à justifier l’existence de ses heures parmi la nuit.
Je dépose mon ombre pour vérifier ma présence : le résultat n’est pas si convaincant. Je ne me reconnais pas. Ce que je reconnais en revanche : que le temps ne passe pas de la même manière quand on a dormi trois heures la nuit dernière.
Après la fatigue, il y a l’épuisement ; et après l’épuisement, il y a peut-être le matin. On ne sait pas ; il y a peut-être le contraire du matin : les horaires de bureau.
Sur mon ombre, je vois mon regard ; je vois ce qu’il regarde de la nuit, ce qui traverse la nuit – et à travers la nuit, le miroir qu’est la nuit et qui renvoie sur moi d’autres regards, et des cris. Mon ombre sur la vitre : moi sans la peau – autant dire si peu de moi. Dehors, la ville pourrait passer comme le temps, je lui dirai après toi, je te suis, je règle mon pas à ton allure ; je laisserai mon ombre ici.
-
appels en absence
jeudi 31 janvier 2019
Que la poésie soit liée à cette impossibilité de penser qu’est la pensée, voilà vérité qui ne peut se découvrir, car toujours elle se détourne et l’oblige à l’éprouver au-dessous du point où il l’éprouverait vraiment. Ce n’est pas seulement une difficulté métaphysique, c’est le ravissement d’une douleur, et la poésie est cette douleur perpétuelle, elle est l’ombre et la nuit de l’âme, l’absence de voix pour crier.
Maurice Blanchot, Le Livre à venir, 1959
Yann Tiersen, L’absente
En sortant du théâtre hier, la neige ne faisait que voler dans le ciel et n’atteignait jamais le sol. Je roulais lentement. J’écoutais seulement. Chaque mot tombait juste sur moi : c’était le contraire de la neige fondue dehors. La musique était toute entière dans la voix. Elle était claire, posée sur le monde autour. Elle rappelait les douleurs du passé et appelait pourtant doucement l’avenir : la traversée du présent. Je traversais la route dans cette traversée-là ; la voix dans la musique silencieuse de la nuit partageait le passé en deux comme du pain.
Alors, comme on pose sa voix sur la musique pour la soulever et lui parler dans la bouche, la voix se posait aussi sur moi, comme un corps immense et fragile, fort de la fragilité consentie, acceptée, traversée des douleurs jusqu’à ce versant là d’une vie qui aura laissé la mort en arrière – la neige et la voix tombaient sur tout cela, magnifiques, entrelacées – et sur moi ; je roulais comme on tend les mains pour saisir les flocons : on ne reçoit que de l’eau qu’on porte aux lèvres et le baiser fait frissonner.
La musique, ces dernières semaines, est une façon de me relier. À quoi ? Il faut des ruses pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber complètement. Je possède quelques ruses, et si peu de talisman. Je me confie au talisman, au fil tendu entre cette vie et l’autre par dessus tous les vides. Je marche. Cette nuit aussi : je roulais.
L’absence de foi déplace les montagnes – phrase de B.-B. qui chavire. Je suis rempli de cette absence : les montagnes pourtant sont sur moi ; il faudrait creuser plutôt ; et sortir de l’autre côté vivant.
Je tâche ces derniers jours de ne surtout pas tirer les cartes du tarot.
Le soleil qui se couchait dimanche luttait contre le vent : les gabians aussi, qui luttaient de surcroit contre le soleil. Et la terre qui tournait au milieu de tout cela devait lutter contre le soleil, le vent et l’obstination des gabians. Face à tout cela, je luttais aussi – contre la terre qui tournait ; je voulais seulement être le mouvement, la loi de la chute des corps – et pas le corps tombant dans l’espace inerte des vides.
Relire des pages de Brecht pour trouver des forces, des armes, des désirs.
Non. Les désirs se trouvent ailleurs : dans le corps même, et à même les lèvres de qui appelle aux levées.
Sur l’écran du téléphone, plusieurs appels en absence – rappeler, comme on relève mes corps intérieurs après la nuit pour compter ceux qui restent, ceux qui seront présents. Ceux qui vont rejoindre.
-
et exister et mourir
dimanche 20 janvier 2019
(Pas besoin, lumière, que tu la cherches, tu demeures
le filet de neige, tu tiens
ta proie.Paul Celan, À hauteur de bouche
The xx, « Lips »
(I See You, 2017)
De l’autre côté de soi : est-ce bien ce qu’on appelle le soir, les révolutions, le désir d’être autre – celui de se rejoindre ? On se couperait les cheveux pour les voir pousser ? On se poserait des questions pour simplement poser les lèvres sur elles et les goûter, et les mordre ? On ferait son lit pour le défaire ? Et on écrirait pour ne pas se lire ? On vivrait cette vie pour l’autre, celle qui reste à vivre ?
Je regarde les cygnes plonger dans les profondeurs : et j’attendrai qu’ils me donnent des nouvelles de moi.
L’un et l’autre sont valables :
Touché et Non-touché.
L’un et l’autre, avec la faute, parlent de l’amour,
l’un et l’autre veulent et exister et mourir.) [1]Il n’y a pas de lointain : il y a seulement, dans le temps, des approches qui rendent possible ce qui ne l’est pas. À distance des années, des villes et des corps, il y a seulement : tel ciel qui revient, qui est mon corps, qui est celui qu’avec la ville je partage – qui est nu de tout ce qui resterait à voir encore, à voir encore, à voir encore.
Évidemment que le ciel est vide et que la terre est recouverte du cadavre des dieux morts : que ce monde est invivable et que le détruire est une tâche de vivant : pour cela, ce n’est pas seulement à coup de pierres (c’est aussi à coup de pierre et dans la rue), mais dans le corps à corps, quel qu’il soit : et il est.
Il est.
Rêve de cette nuit. Inconnu. Ou perdu ? La réalité manque à notre désir.
Dans le parc, ce soir : le ciel était chargé jusqu’à la gorge au-dessus de la ville, mais vers l’ouest et le sud, là où le soleil tombait (il tombe dès qu’il se lève : il est comme nous), la perspective était nette et on pouvait voir jusqu’aux Amériques. (Mais au-dessus de Montréal, il devait faire nuit et la neige tombait sur un jour qui était encore la veille)
De l’autre côté de moi : la nuit avait été blanche et longue, le réveil longtemps après midi, et le déjeuner presque vers le soir – la fatigue était la joie même, celles des corps qui se retrouvent. De l’autre côté de moi, mille vies que j’invente pour me tenir chaud et près de moi. Au bord d’un lac, les volcans se réveillaient. Près des ruines, les chats ne se cacheraient plus. Deux hommes s’embrassaient. Plus loin encore, devant un vieux film, eux, allaient s’endormir et se réveilleraient pour plonger l’un dans l’autre et entrelacer leurs jambes, et se rendormiraient aussitôt, sans mot.
Stigmates de corolle, bourgeons, blocs ciliaires.
Œil épieur, étranger au jour.
Cosse, vraie et ouverte.De l’autre côté de cela, la nuit tomberait peut-être pendant que je ferai silence.
Lèvre savait. Lèvre sait.
Lèvre finit de le taire. -
tendre visage
samedi 19 janvier 2019
Je crois vraiment que ton plus grand malheur réside en toi-même. Ce qui est affligeant, et qui vient de l’extérieur – tu n’as pas besoin de m’assurer que c’est vrai, car je le sais bien, du moins en grande partie –, est certes du poison, mais ça peut être surmonté, ça doit pouvoir être surmonté.
Lettre de Ingeborg Bachmann à Paul Célan,
datée du 27 septembre 1961,
non envoyée.
Jacques Douai, Le tendre et dangereux visage
Le chien qui hurle dehors, depuis une heure, à la lune ou à toute cette vie entière, est comme l’homme qui, hier soir, frappait sur les poubelles de toutes les forces qui lui restaient en pleurant, qui est comme l’enfant apeuré devant la solitude et qui sanglote sa peur sans pouvoir la nommer, qui ressemble tant à la jeune fille endormie dans son cauchemar, qui ressemble tant à moi.
Dans le rêve, on courrait pour passer la frontière, on gagnait la forêt au moment des premiers coups de feu. C’était un rêve joyeux, nous nous tenions la main.
Je ne sais pas de quoi demain sera fait : pas d’aujourd’hui.
Sur le mur, le visage porte toute la ville. Je le regarde songeant à d’autres vies, quelque part enfouies au Guatemala, à Stockholm (je n’ai jamais vu la lumière sur la mer au large de Stockholm quand il fait de l’orage) ; je le regarde en songeant à Rohmer, à certains plans que fait le cinéma quand il refuse de dire ce que sera le plan à suivre.
Mes nuits fractionnées d’insomnie sont les nôtres, en partage.
Le bruit de pas des flics dans les rues, je ne l’ai pas entendu aujourd’hui ; sur la plage, mes regards vers La Plaine s’enfonçaient en moi-même. Il n’y avait pas de vent, les nuages pouvaient sans crainte jouer avec le soleil parce qu’ils savaient que de toute manière il l’emporterait. J’étais cela aussi : l’absence de vent, et le ciel entier livré au saccage, et la déchirure, et le soir, la lune se dresserait pour faire hurler les chiens et pour que je la regarde, sûr qu’on la regarderait ensemble.
-
où sommes nous
jeudi 17 janvier 2019
Où sommes-nous
Ensemble, inséparables
Vivants vivants
Vivant vivante
Et ma tête roule en ses rêvesPaul Eluard, « Elle se penche sur moi »
(L’Amour La poésie, 1929)
Message to Bears, Wake me
(Folding Leaves, 2012)
Chaos de ces semaines (foules qui crient, vies qui basculent, corps qui au dehors, et au dedans, cherchent, appellent, désirent) ; vertige – le monde tourne, dit-on, à la vitesse du jour : et la nuit ? Regarder la lune pour trouver ce point fixe qui —
Dans les arbres, le vent secoue les feuilles absentes ; vers Noailles, tourner toujours la tête sous le pont du cour Lieutaud, la rue d’Aubagne. Marseille exacerbe les colères, les délires, les fureurs, les mélancolies (les désirs) : colères. Colères contre cette vie organisée contre nous ; colères. Pleurer de rage parfois : rien ne paraît à sa place.
Et puis c’est aussi l’éclat d’immenses joies au milieu des gouffres.
Est-ce que je suis ici ?
Il faudrait se poser comme on pose des questions ; il faudrait du temps, mais la seconde qui suit arrive si vite et renverse tout, jusqu’à la prochaine. Il faudrait moins de il faudrait ; des choix. Je pose cela ici (comme une cigarette cette fois). Il faudrait en finir avec les comparaisons comme une dernière demande.
Il y en aura une autre : comme on demande un autre jour à peine sorti de celui-là.
Est-ce que le temps accompli du temps ? Ou est-ce qu’il faut plier sur lui ? Est-ce qu’on est seul dans nos solitudes ? Où es-tu, toi (dans quel théâtre que dresse cette vie-là) ?
Les foules dans les rues crient le nom d’autres vies aussi.
Le début du poème : ce n’est pas une femme seulement, c’est la vie qui face à soi se tient, et nous regarde. Et juste avant de parler,
Elle se penche sur moi
Le coeur ignorant
Pour voir si je l’aime
Elle a confiance elle oublie
Sous les nuages de ses paupières
Sa tête s’endort dans mes mains -
quoi qu’il advienne
mercredi 16 janvier 2019
… Quand casquée de fumée / je sais à nouveau ce qui se passe, / mon oiseau, mon soutien nocturne, / quand je suis enflammée dans la nuit, / cela crépite dans l’obscurité de la forêt / et je fais jaillir de moi l’étincelle. Quand je reste enflammée comme je suis / et aimée par le feu, / jusqu’à ce que la résine sorte des troncs, / coule goutte à goutte sur les plaies et chaude / enveloppe la terre de son cocon, / (et même quand tu dérobes mon cœur dans la nuit, / mon oiseau sur la foi et mon oiseau sur la fidélité !) / le poste de guet là-bas se retrouve en pleine lumière / alors, apaisé, / tu le rejoins d’un vol dans un calme souverain — / quoi qu’il advienne.
Ingeborg Bachmann, « Oiseau » (Toute personne qui tombe a des ailes)
Beach House, Take Care
Ce qu’est un paysage : simplement la manière dont la peau reçoit la lumière. Sur un visage, et sur les mains, la façon dont le temps évolue à travers le corps. Est-ce qu’il faudrait nommer le désir ? Le mot manque. Je regarde par dessus la mer ce qu’il reste encore de tout ce temps passé. Il faudrait des phrases plus courtes, moins de mots, seulement fermer les yeux sur ce qui nous regarde.
Le corps ne ment pas. Quand il faut marcher dans la ville ou sur la pierre, sur le bord des fleuves quand il neige et que la fille hurle de ne pas laisser de trace (en riant), quand il faut regarder les trains passer, les mendiants tout savoir de l’amour qui passe, quand il faut écrire ce qu’on ne sait pas dire, quand il faut prendre le temps de la douche brûlante, quand il faut essayer d’endormir un enfant qui voudrait le jour, quand le sommeil est trop fort et que l’insomnie est là, étale et large, on est seulement comme ce paysage : présent sous la lumière malgré les insultes des gouvernements et la soif des animaux sauvages.
« Des vies comme des blocs de solitude et d’amour, auxquels on ne rien retrancher sans nier tout entier : et qu’il faut pour cela, et au nom même de la solitude et de l’amour, accepter tout entier, et admirer dans ces trahisons mêmes – ce n’en sont pas. Seulement des façons de rejoindre encore et encore » – dit le chemin qui part le long de la crête pour contourner l’ombre et passer par-dessus le silence.
Ce qui me lie au monde ? La colère, et la soif, et les animaux sauvages, les pierres qu’on évite, celles qu’on prend, les mots qu’on ne dit pas, ceux qu’on garde pour plus tard, les arbres qui tombent.
La mer sur la terre de ceux dont je suis issu possède la couleur des terres de toute la terre. En Nouvelle-Zélande, en Picardie, la même peut-être, avec les nuances qui la rendent incomparable. Sur le visage aussi, on est seul. Dans les bras, la nuit, qu’on s’endort, et la solitude nous unit terriblement.
Rejoindre, c’est chaque jour et parfois dans la déchirure : le fleuve, là-bas, non pas celui de la neige, mais celui des marches qu’à quinze ans je faisais à travers la brume, existe encore pour cette raison que je pense à lui. On fait des promesses qu’on oublie : on n’oublie pas les lieux où on jetait les cailloux, et le bruit que l’eau faisait, pour répondre. C’était déjà écrire, c’était déjà quelque chose qu’on appellera l’amour plus tard ; c’était déjà le paysage. C’était quelque part de perdu. L’enfant qui dort porte en lui mes souvenirs. Je garde, moi, le poids de la pierre dans la main, le vol calme et souverain de l’oiseau qui cherche dans d’autres ciels de quoi assoiffer le désir, tandis que l’arbre qui est mon ombre tend ses bras vers son prochain sommeil.
-
ne plus vivre
lundi 14 janvier 2019
Ce fut si beau que j’aurais voulu ne plus vivre. G. Bataille, Le Bleu du ciel
M83, You Appearing
Dans la violence triste de l’époque, les joies qui traversent éblouissent et ravagent. Face au coucher de soleil dans le vent, on reste aussi pour la douleur, et la beauté qui renverse, devant quoi on est seulement soi-même, et seul. Ce n’est pas une image.
Chercher violemment des antidotes ne soigne pas la tristesse, ne recouvre pas la violence, plutôt au contraire : il ne faudra rien oublier de ces jours. Il y a dans les rêves, ces dernières nuits, des terreurs qui sont des joies sans fin parce qu’on les traverse ; il y a dans ce monde qu’on dit réel, des laideurs qui insultent mais ne laissent au moins pas le choix : on est contraint de récuser ce monde en bloc. Il y a des complots, comme des désirs – non, pas "comme" –, qui travaillent aussi contre le monde, au corps à corps.
Sur le pont du bateau vers Porto-Vecchio, les pensées face au vent étaient celles-là, je ne les ai pas écrites : il n’en reste rien, que ce désir de l’écrire, et sous ce mot de désir, le désir seulement d’en relancer le désir.
Sous ce ciel-là de la Corse, sur cette terre-là, devant les bêtes sauvages et domestiquées d’ici, on pourrait appartenir. On sort devant moi, depuis des petites boites en fer, quelques vieilles photographies qui portent mon visage, mais de centenaires ; corps d’où je suis issu, sans doute. Je regarde par la fenêtre le froid qui tombe, les pensées s’échappent, franchissent la mer elles aussi.
Finalement, la colère est la seule attitude saine de ces jours – avec le désir (qui est l’autre versant). On s’abat contre les corps pour chercher ce qu’on ignore de soi, et qu’on trouve sur la peau. La surface de soi-même, c’est tout ce qu’on possède pour opposer aux coups de matraques. On l’offre aussi aux lèvres.
Ce matin, je regarde des images de film de Rohmer, cherchant à percer le secret de ce désir-là ; les nouvelles tombent (toutes aussi abjectes). Il n’y a pas d’antidote contre ce monde, seulement des pulsions de vie, des déchirures, d’autres corps à corps. Mettre à mort tout ce réel stérile dans la vie arrachée à cette vie.
Le soleil tombera sur ces jours ; cette nuit-là, on cherchera nos corps sous les draps du monde neuf.
-
cendres du soleil
lundi 7 janvier 2019
Et je sais que l’amour, qui ne compte plus à ce point que sur lui-même, ne se reprend pas, et que mon amour pour toi renaît des cendres du soleil. Aussi, chaque fois qu’une association d’idée traîtreusement te ramène en ce point où, pour toi, toute espérance un jour s’est reniée, et du plus haut que tu te tiennes alors, menace de te précipiter à nouveau dans le gouffre.
André Breton, Arcane 17 (1944)
Flavien Berger
Contre-Temps
Puisqu’on a enterré les dieux et les hommes qui les ont enterrés, il ne resterait plus que des signes auxquels croire comme à la terre jetée sur les dieux, et dans leur bouche désormais, ou comme à un grand ciel vide à travers lequel passent des oiseaux migrateurs pour chercher le lieu (et la formule) où cesser de migrer, et faire ici la terre provisoire de leur soif.
C’est la leçon de ces jours, les signes qu’on reçoit, il ne s’agit même pas d’y croire ou de les voir, seulement de les accepter, et d’en faire une autre peau sur les peaux mortes qui sont nos corps.
Des signes, donc : ceux qu’on trouve et qu’on ramasse, ceux qu’on lit sur les murs, ceux qu’on devine dans le destin qui n’existe plus, ceux qu’on apprend à reconnaître comme le visage d’un mort, ceux qu’on espère et qu’on n’attend plus, ceux qui arrivent, ceux qui sont là, et là, et là aussi, ceux qui s’embrassent comme des enfants dans un bus, ceux qui s’éteignent, ceux qui tombent dans la mer pour rien, ceux qui portent en eux la blessure, et ceux qui la délivrent.
C’est une carte qui ne porte aucun nom de ville, pas de direction : une carte à jouer qu’on retourne et qui révèle ce qu’on savait déjà : un trois de trèfle.
La mer qui mord comme sur la peau des choses le désir est une autre leçon : il faut épouser son mouvement.
J’épouse son mouvement.
Que restait-il à vivre ? (C’était la question). Il n’y avait peut-être pas d’autres réponses que le jour où comme des ponts enjambent l’année, un fils suivait l’autre.
Des signes par milliers depuis.
De l’autre côté de ce monde, d’autres vies que la mienne, qui sont aussi la mienne.
« Pour moi la seule évidence au monde est commandée par le rapport spontané, extra-lucide, insolent qui s’établit, dans certaines conditions, entre telle chose et telle autre, que le sens commun retiendrait de confronter. » [2]
-
des portes sans battants
samedi 5 janvier 2019
Dimension qui distend, qui augmente, qui en largeur s’étend, m’étend. Qu’est-ce qui arrive, qui dérive, musique qui me bague, qui me baigne. La tête pleine d’aubes, j’avance poussant des portes sans battants.
Plus de lassitude. Arc-en-ciel de merveilles. C’es si beau le renouveau : le matin pense de partout. Est-ce possible ? Est-ce vrai ? Le mal, l’inquiétant, l’interminable mal, une nappe, une invisible nappe l’a fait disparaître.
Félicité ! Je n’ai plus à descendre.
Arrivée, une nouvelle arrivée. Le fleuve des arrivées s’écoule. Il n’y a plus que des arrivées.Michaux, "IX. Lieux, moments, traversées du temps" (Moments, 1973) Dominique A, Pour la peau (session acoustique, Le Cargo)
On ne sait jamais si on se trouve devant la fin ou le début : et je ne parle pas de la mer. Je parle de ce qui l’entoure, le vent, les hommes qui nous gouvernent, les amours. Je parle de ce qui est entre le vent et les amours, quand l’un emporte les autres, ou quand les autres l’entravent.
Mais je parle aussi de la mer, cette chose du monde qui nous fait penser à tout ce qui n’est pas elle, et qui nomme l’exact sentiment de l’incertitude devant la fin ou le début.
Devant la fin, on sait qu’on doit regretter et pleurer, et trouver les mots justes ; devant le début, on ne sait rien, on désire seulement, et que les routes s’ouvrent. Devant ce qui tient de la fin et du début, on est seulement un regard face à toi, et qui n’ose même pas demander, qui regarde, qui n’attend pas, qui se tient dans le présent étale des secondes qui valent cette peine d’être un homme.
La mer ne sait rien d’elle ; elle croit avancer de toute sa force, elle croit déborder, elle pense être la masse vivante de toutes choses. Si elle savait qu’elle était immobile, remuante, irrespirable : est-ce qu’elle n’essaierait pas de fuir elle aussi ?
Dans ce café où je ne suis pas, des hommes disent les poèmes déchirants qu’on ne peut dire qu’un samedi soir après le huitième verre, et que tu me manques, et que je voudrais le dire ici aussi, ils disent ça, où je ne suis pas – et pour moi aussi ? je crois en cela – ; et quelqu’un enregistrerait toutes ces solitudes en pleurant un peu, à la volée, pour le contraire de l’archive et du vol, mais pour le don aussi, pour relever de ce temps et de ce lieu, et partager la solitude entre ses amants.
Quand le soleil tombe, quelque chose commence qui ne finira pas : c’est chaque jour, le soir. Il y a une leçon. Les hommes qui nous gouvernent pensent à gérer ce qui existe. Je pense plutôt aux gouffres qui séparent la fin du début, aux gouffres en lesquels je suis entièrement, et aux gouffres où je ne suis pas (les nuits qu’il faudrait dormir d’un bout à l’autre auprès de ses propres rêves, de ses désirs mêmes), je pense à l’homme dans le café qui voudrait dire d’autres mots qu’il n’a pas, et pas seulement l’amour, mais l’amour aussi, et je ne les ai pas non plus, mais je les dépose ici, sûr que personne ne saura les lire, et les emporter.
-
les aubes pas encore mortes
mardi 1er janvier 2019
« Jukes demeurait indifférent, insensibilisé, l’on eût dit, par la violence du cyclone, conscient uniquement de l’inanité de tout effort, de tout geste. Il tenait pour absorbante suffisamment l’occupation de préserver, de cuirasser son cœur tout gonflé de jeunesse, et éprouvait une répugnance invincible en face de toute autre forme d’activité. Ce n’était pas de l’épouvante, il le reconnaissait à ceci que, tout persuadé de ne plus voir la prochaine aube, cette idée pourtant le laissait très calme. »Joseph Conrad, Typhon Molly Nilsson, Never Oclock
Que ce monde finisse - c’est toujours la même pensée, le dernier jour du dernier mois : l’arbitraire des calendriers a cet avantage au moins : il libère ces pensées rageuses de la fin –, et cette année, avec plus de rage encore, de précision : que tout finisse, pour que tout commence ? Que tout finisse d’abord, et que tout commence enfin ? encore ? Ou que le commencement précède la fin ? Peu importe l’ordre réel des choses : la nuit tombe.
Dans le parc, des vieillards parlent de la pluie et du beau temps comme s’ils vivaient encore, comme s’ils étaient sur le point de commencer à vivre.
J’écoute beaucoup de musique ces derniers jours pour garder le silence. Je lis Madame Bovary les larmes aux yeux – une émotion neuve ; un corps neuf ; des désirs neufs : est-ce le début ou la fin ? Je multiplie les questions [3] comme les parenthèses (pour m’y réfugier comme dans de la musique) parce que je sais les réponses, et le temps qu’il faudra pour les dire.
Les vieillards s’éloignent, au passage, j’entends les mots retenue à la source : je sais bien qu’ils ne parlent pas de fleuve sauvage, de courant maintenu par des barrières rocheuses : je sais bien. Ils se tiennent la main. Ils tournent le dos au soleil qui s’effondre. Et moi je lui fais face longtemps jusqu’à vouloir me brûler les yeux pour mieux le voir encore.