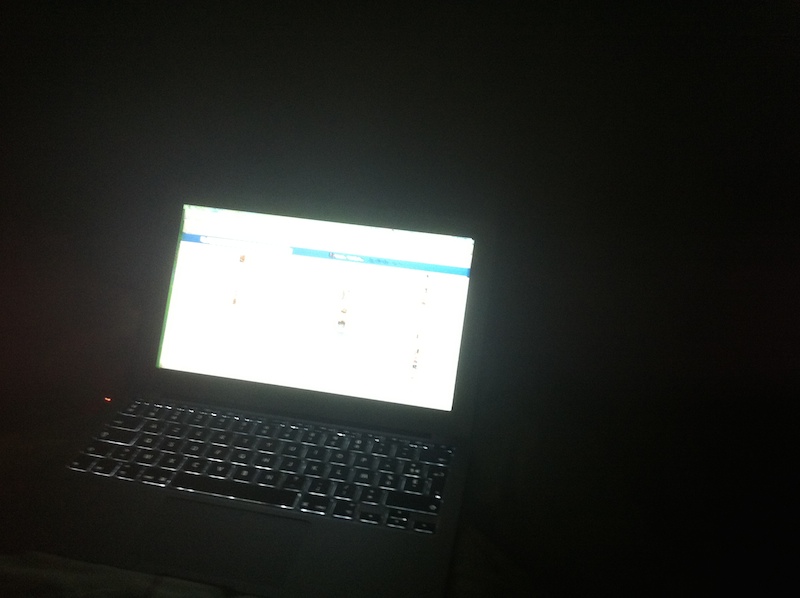Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
-
où se perdre
mardi 15 avril 2014
[15 avril]

C’est le jour où les vers de Rimbaud, qui devaient sauver — eux qui avaient raison pour toujours — ne sauvent plus, s’échappent, s’enfuient entre mes doigts, pourquoi ?
Oisive jeunesse
À tout asservie,
Par délicatesse
J’ai perdu ma vie.
Ah ! que le temps vienne
Où les cœurs s’éprennent.Je sais bien pourquoi. Comme chaque vers porte, aujourd’hui ; tous frappent fort et juste.
Ne rien écrire, ces jours derniers, ne rien dire, ne rien porter en soi — le journal et son adresse, comment y croire encore ? Il y a des jours qui sont plus lourds que d’autres, plus endeuillés que d’autres — ce jour-ci, par exemple, sans autre exemple.
Bien sûr, l’orgueil qui pèse sur ces pages, je l’ai su, et tant voulu le dompter, l’orgueil sur le moindre geste d’écrire, celui qui touche à l’audace de croire que dans les mots on pourrait avancer la vie en soi et en renouveler les forces, je le sais - oui, je sais l’orgueil qui menace tout, prêt à tout effondrer. Mais il y a des jours où finalement tout s’effondre quand même, prêt ou non — parce que le désir se retourne et brûle.Pas plus de mystère — jour de repli, tentation.
Moi, j’avais voulu d’un journal quelque chose qui recueille dans le jour des instants de force contre l’idée du journal, contre l’idée du souvenir ou de la mémoire, seulement l’instant, l’espace d’un instant, une brèche dans laquelle je peux m’engouffrer et grandir, comme je grandis en lui. Je réalise aujourd’hui, des signes par milliers me le disent, et l’absence de signe aussi, combien j’ai échoué, et la porté de cet échec.
Dans ces jours où je le vois, si grand, si fort, si incontestable (pas un échec comme dans la vie sociale, les échecs contre les vies réussies, pas cet échec-là, non : l’échec comme les vagues échouent : à force de recommencer à mordre, ce qu’ils mordent n’est que du sable, et c’est pourquoi elles continuent d’aller : et pour la lune) — dans ces jours donc, où j’ai compris, par bien des voies, par bien des manières indirectes et violentes, et secrètes et intimes, et politiques, et — dans ces jours donc, écrire sur ce journal fait violence même à ma propre vie, comment le dire autrement ? L’écrire — et espérer ainsi le conjurer ?La tentation du repli ; ici, simplement poser ces mots pour voir — noter ce jour.
Comme l’espérance est violente, oui.
Ce qui commence n’aura pas de fin — on est si pauvre en certitude, autant en posséder quelques unes comme celle-là, solide.De l’écriture au désir, et de la folie du jour à la sagesse des nuits, je continuerai de regarder la lune comme elle est, dans le savoir que sous elle passe ce qui passe encore, de vivant, et de lumineux pour faire l’épreuve de la vie ; tandis que moi, ici, je serai celui qui regarde et se tait (c’est cela, la leçon de ces jours).
Apprendre d’autres mots, d’autres manières de parler maintenant — parce que maintenant que je sais l’adresse effondrée, il faudra bien en inventer une qui tiendrait dans le geste même, la foi que l’adresse traverse. Et sinon, alors seulement aller et qu’on n’en parle plus. Le vent souffle pour l’espace et le temps et à force de distance se rejoindre, peut-être. Où se perdre, se retrouver.
Je ne sais pas ce que je retirerai de ces jours. Mais je sais le deuil immense désormais, comme devant la terre remuée on imagine les corps qu’on n’aura jamais connus, et qu’on pleure pour cela, et qui nous console.
Tout à reprendre, tout à redire, et la faux du regard sur tout l’avoir menée, oui.
Mots-clés
-
au silence qui lui est propre
dimanche 13 avril 2014
-
comment mesurer les tremblements de terre
mardi 8 avril 2014

terra trema — à la surface du verre d’eau posée sur mon bureau, de minuscules vagues soudaines et dérisoires, quelque chose tremble et je ne sens rien. Il est 21h30 à peu près et j’apprendrai plus tard qu’il était en réalité 21h16. C’est sur l’écran de l’ordinateur deux heures plus tard, au moment de m’effondrer, que je lis les nouvelles des journaux en ligne : la terre a tremblé ici, à quelques kilomètres d’ici, pas très loin, tout autour de moi, la terre a tremblé un peu, pas suffisamment pour qu’on la voit trembler, ou pour faire trembler la ville : je repense aux vagues dérisoires à la surface du verre, l’eau qui tremble quelques secondes dérisoires, le sismographe dont je n’avais pas su lire les signes.
Je possède d’autres d’instruments semblables pour mesurer le temps et la vie : et tous sont comme ce verre d’eau ; il peut trembler, je ne verrai que l’eau tremblée, et je resterai, imbécile, ignorant de ce qui tremble vraiment.
J’affine les instruments pourtant.
Autour de moi les conséquences du tremblement de terre paraissent évidemment terribles : elles sont inexistantes. Le soir est établi à la même place, en long vêtement de deuil. Je suis au centre précis de mon corps et la faille peut bien parcourir sous mes pieds la ville, je suis en équilibre entre chaque seconde, celle qui précède est derrière moi et celle qui arrive se lève déjà devant moi. Ne pas se pencher, ne pas regarder le vide, tendre les mains poser le pied sur l’invisible fil du temps mort.
Ce journal comme sismographe. J’ai bâti lentement toutes ces années un journal comme un sismographe : mesurer le pouls battu du temps sur moi. Dans ces temps où le temps manque et l’absence partout, si juste est cette image du verre d’eau comme sismographe, ultime et précieux. La soif comme un repère. L’eau comme un instrument rétrospectif, retard, précis et infime. Le temps comme des lignes d’eau tracées sur de l’eau, la vague comme la secousse d’un corps soulevé de plaisir par la déchirure d’une surface qui s’ébranle. Et lentement la sensation de la vie, puissante et douce, le corps de la terre qui crie encore, qui a assez de force pour s’ébattre, s’éployer, rejoindre le mouvement des arbres qui se répandent en fleurs, peut-être.
Je bois le verre d’eau rempli encore, juste avant le sommeil — je songe qu’ainsi mes lèvres se portent à la surface même du tremblement. Dans la soif, je vois le mot secousses, je vois le mot corps, je vois le mot soif, et comme ils s’accordent ce soir, dans l’absence, et le manque.
La terre a tremblé seule, elle qui voulait sans doute qu’on s’y recueille, et la console. Et à la surface du verre d’eau, quelque chose faisait signe, mais quoi ? si je dois faire l’épreuve du silence de la terre aussi, à déchiffrer dans les entrailles d’un verre d’eau les tremblements qui annoncent les déchirures, alors je l’accepte.
-
comment respirent le ciel et le sable
dimanche 6 avril 2014

Le désert, c’est le vide avec sa poussière. Au cœur de cet univers pulvérisé, dans son absence intolérable, seul le vide conserve sa présence ; non plus comme vide, mais comme respiration du ciel et du sable.
Jabès si dans cette chair bouleversée qui est pourtant dans la continuité d’une vie singulière, je peux croire encore au ciel (vide), c’est à cause de la route — et du bouleversement à traverser, de la continuité à chercher, de la vie peut-être à inventer, je cherche les signes : elle est dans ma chair, peut-être — l’interruption pour chercher les reliances —, et dans celle d’un monde en lequel je voudrais me confondre.
je ne trouve aucune correspondance pour nommer la couleur de cette blessure. L’accepter.

Écrire sur du sable — on écrit toujours sur du sable. Mais parfois on l’oublie. Maintenant que je ne l’oublierai plus, maintenant que j’écris vraiment sur du sable (que derrière l’épaule, dans le prolongement de mon bras, aucun visage), le geste évidemment de mes doigts dans la terre pour dessiner les visages, je le trace pour la raison de la terre, parce qu’étendue devant moi, je ne lui connais pas d’autres usages — ou plutôt, la savoir étendue devant moi appelle à ce geste, pour en poursuivre le mouvement rond qui l’achève sans cesse.
Ce qui efface les visages dans le sable — au milieu de ces barres d’immeuble, rue andré gide, le sol est jonché de cendres roses. Je lève la tête pour recevoir le signe adressé dans le silence.
-
par où les déchirures du ciel
mercredi 2 avril 2014

Le monde s’étire s’allonge et se retire comme un accordéon qu’une main sadique tourmente
Dans les déchirures du ciel, les locomotives en furie
S’enfuient
Et dans les trous,
Les roues vertigineuses les bouches les voix
Et les chiens du malheur qui aboient à nos troussesCendrars, proses
Il n’y aurait rien à écrire de ces jours.
Dans les déchirures du ciel seulement, les déchirures de soi — je voudrais me confier, entièrement me confier à la déchirure (pour de l’autre côté des lambeaux endosser la plénitude d’un soir comme un vêtement) ; seulement la plénitude.
Rien (et rien ne s’écrira — puisque rien ne sera lu).
Je pense au dernier vers de la prose en vers adressée à Jehanne de France.
Rien à écrire, et même pas les cris des chiens, plutôt le silence du malheur à mille pas que mes pas éloignent.
Et au bruit que cela fait : la déchirure d’une lettre qu’on aurait commencé mille fois, qu’à la mille et unième on aurait regardé par la fenêtre le soir effondré aux pieds :
« la seule et vraie cruauté n’est pas celle d’un homme qui en blesse un autre […], la vraie et terrible cruauté est celle de l ’homme qui rend l’homme inachevé, qui l’interrompt comme des points de suspension au milieu d’une phrase, qui se détourne de lui après l’avoir regardé, qui fait de l’homme une erreur du regard, une erreur du jugement, une erreur, comme une lettre qu’on a commencée et qu’on froisse brutalement juste après avoir écrit la date. »
Koltès, Dans la solitude… À cet instant : Only the wind d’O. Arnalds bat aux rideaux invisibles de la chambre — en partage de quelle blessure secrète ?
Ce qu’il faudrait, c’est renoncer à faire de l’écriture le nom de la déchirure, pour tâcher de l’habiter comme mouvement capable de la traverser, je le sais bien, je l’ai appris : entre les mots et les choses, une porte battante (ouverte comme des lèvres — y poser les miennes), ce qui passe passe, je suis en travers, le reçois.
Il n’y aura rien à écrire ; j’apprends davantage ce pendant à regarder la terre rouler sur elle-même, désirant de toutes mes forces être parmi ceux qui marchant sur elle la font rouler pour approcher du jour et de la nuit où la nuit trouvera l’équilibre par le jour.
Vendredi soir, une lecture publique, cela faisait si longtemps : une heure comme sauter dans le vide qu’en soi-même j’aurai ménagé, un vide suffisamment grand pour tout y loger : la blessure politique, et l’appartenance, et le désir de recommencer l’histoire, celui de marcher, tenir le pas gagné, le partage de quel chemin : la déchirure — et poser sa voix sur cela, simplement, avec toute la simplicité qui me reste, poser ma voix comme un corps sur le sol dans une forêt où la lumière parfois passe découpée entre les branches. Poser ma voix et tenir le corps droit et debout pour se délivrer aussi du temps passé à avoir écrit cela, approcher aussi les secrets, tout confier à l’illisible pour qu’il devienne lumineux sans que j’y ai ma part. Le tu soit la lumière du dit.
Je suis la propre distance qui me sépare du ciel et de la ville, l’intermédiaire des mondes ; je suis l’espace de respiration qui nomme la déchirure, et la reliance des territoires déchirées, désirées ; je suis l’intervalle du désir et de sa déchirure ; je suis à cet instant capable de dire cela ; je suis là, qui frappe sur les touches des mots illisibles qui ne seront pas lus à cause du vent et de ce que le vent exige pour qu’on lui appartienne.
-
que faire
lundi 24 mars 2014
[ i n s é r e r i c i u n e i m a g e d ’ u n c i e l p o s s i b l e
— e t d u v e n t b e a u c o u p d e v e n t ]ces lendemains, toujours les mêmes depuis que je suis en âge de voter — 2002, avril —, toujours les mêmes mots sur les écrans qui sont les mêmes, les visages seulement un peu plus vieillis, et peut-être le mien l’est-il aussi (évidemment, non : si je peux voir encore des visages vieillis, c’est que je ne le suis pas), toujours la même colère contre les mêmes colères dérisoires, toujours la même fatigue et plus grande encore dans la pensée que cela recommencera — relire Robespierre pour se guérir, un peu, ce matin ; et quelques pages de Breton ; ces lendemains, la tentation du repli, aussi ; laisser passer ; mais pourtant, ces lendemains comme toujours impossible de ne pas penser en croisant ces visages que plus d’un tiers parmi eux ont délibérément fait le choix qui m’exclut de fait de l’air qu’ils respirent ; et cette question : est-ce que j’habite la même ville, le même pays qu’eux — sans doute non (si vivre est le choix d’un monde possible) ;
Aujourd’hui, sur mon appareil photo, je n’ai pris aucune image (sauf du terrain vague où j’ai l’habitude de travailler le lundi après-midi quelques scènes de Quai Ouest avec les étudiants : cet après-midi, terrain vague occupé par un cirque), je n’en déposerai aucune ici : jour blanc écrasé de fatigue avec un vent froid de février et un ciel dégagé d’août, entre les deux penser surtout à tout le temps qui manque, penser aux mondes possibles et aux possibilités d’en inventer d’autres.
En rentrant, des couples dansaient dans un café, et les voir tourner, depuis le silence de la rue, autour d’une musique que je n’entendais pas, m’a bouleversé ; comme m’a bouleversé plus loin, au milieu de la place, ce danseur qui esquissait des pas de danse classique pour rien : pour le vent, et moi qui au loin le regardais sans qu’il le savait. Allégorie. C’est cela. Inventer le monde, c’est organiser l’espace contre l’espace lui-même : et le renouveler. C’est y croire — c’est le croire, et son miracle lui-même.
Dans ce monde qui s’avachit de plus en plus dans ses haines d’arrière-garde, dans la peur de lui-même, dans la honte d’être ce qu’il devient, j’écoute ce soir les rites indiens de fondations du monde ; je ne veux pas en faire un refuge, non. Au contraire. J’ai, avec ces textes indiens, d’autres textes : et auprès de moi ces textes sont comme des appuis, des tuiles non pour protéger du dehors, du vent ou de la pluie, mais pour agrandir l’espace, inventer des volumes au dedans pour mieux affronter le dehors, oui, faire du dehors le lieu d’une appartenance.
Mélancolie des lendemains, quand tout ce qui est censé organiser le monde nous crache à la figure. (La République n’est vraiment pas la même chose que la Démocratie, me disais-tu le matin — et la République manque décidément.)
Que faire d’autres qu’écouter les rites Navajo de la fondation du monde, non à cause de l’origine et de sa nostalgie, mais en raison des prophéties qu’ils portent, des rêves qui tendent à devenir réels contre un réel de pourcentage et d’estimation qui s’acharne contre nos rêves.
-
quand s’ouvrent les premières Eucharis
vendredi 21 mars 2014

Depuis lors, la Lune entendit les chacals piaulant par les déserts de thym, — et les églogues en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette, bourgeonnante, Eucharis me dit que c’était le printemps.
Rimb. Après le déluge
C’est le jour où le soleil bascule dans l’hémisphère nord — ou est-ce l’hémisphère nord qui pivote et s’oriente vers le soleil ? C’est le lieu, plutôt, où la lumière passe ; frappe à l’inclinaison la plus proche. C’est l’espace qui sépare la lumière du jour. C’est la première saison, le premier temps — prins / temps, dans la langue ancienne : la reverdie, peut-être.
Si de plus en plus, ce journal note la position du soleil, c’est à cause du ciel [1] qui prend tant de place qu’il lui arrive peu à peu d’entrer dans la pensée et le corps.
Dans Conrad, les marins ne parlent que de cela : la pluie, et le beau temps (la pluie surtout et le vent) — et ce n’est jamais bavardage, mais pour trouver l’orientation du monde, s’y repérer et aller plus avant, c’est pour savoir où la vie les emporte, par où aller maintenant.
Dans le ciel les arbres montent davantage, l’herbe leur pousse aux terminaisons de l’être et montent encore, paumes ouvertes lentement qui les grandissent, et les grandissent chaque jour. En Iran, Norouz célèbre le miracle : le nouvel an, évidemment, quel autre jour pour l’an neuf ?
Tout recommencer maintenant que tout recommence.
Ver Sacrum (printemps sacré) — si le vers est sacré lui aussi, où dieu manque partout surgit ce qui renouvelle le temps de la création ("que les dieux existent ou non, nous sommes leurs esclaves", Pessoa)
Sur le miroir, regarder son visage pour la première fois, les rides sous les yeux, les cheveux blanchis par le passé (ou l’avenir ?), l’impression qu’il reste à dire, que tout reste à dire encore.
Je n’ai jamais su quand commençait le printemps — le vingt, le vingt-et-un, hier, demain ? Au moment des fleurs, des premières Eucharis, du premier soleil, du changement d’heure, du désir redevenu désir ?
Je regarde ce soir les yeux fermés d’Eucharis quand elle fait ses adieux à Télémaque. J’apprends que la toile de David est le double du portrait d’Amour (regard posé sur nous, de défi) et de Psyché (endormie, rêveuse peut-être). Et j’apprends qu’Eucharis est une plante.
Je regarde ce soir les yeux fermés d’Eucharis.
Tout recommencer maintenant que tout recommence.
-
où respirer la puissance
lundi 17 mars 2014

Le jeune Creighton restait appuyé au bastingage, l’œil rêveur plongeant dans la nuit orientale. Il y voyait la perspective d’un chemin creux paysan, des rais de soleil dansant sur des feuilles bougeuses. Il voyait frémir des rameaux de vieux arbres dont l’arche encadrait le tendre et caressant azur d’un ciel d’Angleterre. Et, sous l’arceau des branches, une jeune fille en robe claire souriant sous son ombrelle, semblait debout au seuil même du tendre ciel.
Conrad, Le Nègre du Narcisse 
Marcher dans les arbres pour les mettre à nus, arracher à l’hiver ce qui empêchera le printemps, et dans nos villes où le béton est leur terre et les racines invisibles sous les murs, arracher les arbres vifs à eux-mêmes fait signe vers ce chemin intérieur que tout autour nous impose : le dépouillement après le froid, oui, et nos branches en nous-mêmes, celles qui trop lourdes pourraient faire ployer l’ensemble : les jeter à terre, et aller.

Voir où le manège manque et au lieu du manque y poser son corps pour en rappeler la brûlure, ici le soleil tape et se laisser transpercer et poursuivre toute une journée avec cette image, ou sans elle plutôt, d’une roue du temps tournée sur elle-même qui a comme dévalé la pente, suivre des yeux ce silence, saluer les spirales qui jamais ne reviennent où elles ont commencé le cercle, et toujours, comme le soleil tombe, aller.

Respirer la puissance, chercher à travers l’enchevêtrement des vies répandus en bataille comme des cheveux en désordre dans les buissons ce qui perce davantage et devance le temps, chercher le nom longtemps et le laisser à lui-même (l’hibiscus — si j’avais su, en aurai arraché une, et puisque ces fleurs se mangent, dévorer lentement), lentement se demander au soir comment déjouer l’infinitif qui déjoue le temps et celui qui voudrait en lui, et simplement m’assoir auprès de moi, consoler ce qui s’éteint dans la nuit que la ville partout éclaire et qui n’appartient qu’à elle.
-
comment porter le deuil de l’hiver
dimanche 16 mars 2014

Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas.
Genèse, 8.22
Il faudrait un mot qui dise le contraire du deuil. Et peut-être est-ce un deuil encore — et comment dire le deuil d’un deuil ? Comment le porter sur le bras, de quelle couleur l’étoffe, les jours qui se lèvent et agrandissent le ciel et le temps.
Dans le jardin des plantes, cette pensée que l’hiver s’était arrêté là, net, à nos pieds, dans l’odeur de la terre et de la ville enroulées l’une sur l’autre. La brume légère dans l’air, les particules fines qui dansent lentement autour de nous et alourdissent le jour a levé cette étrange lumière du soir dans Paris. Les trajets sont gratuits et flottent alors partout dans la ville comme une joie, le sentiment des vacances. Les gens sourient en passant le métro, avec cette impression d’enfant d’être fraudeurs légitimes — semblant ignorer que cette fleur qu’on leur fait est au prix d’une brume qui s’attache sans qu’on le voit à nos poumons.
Je me demande si les derniers jours du monde laisseront flotter une même légèreté dans les cœurs, que la catastrophe ouvrira les métros que la foule joyeuse prendra le temps de prendre, lentement souriante et reconnaissante à la ruine à venir du cadeau qu’elle leur fait de leur accorder la douceur. Je me demande si l’effondrement de la civilisation lèvera en nous le sentiment d’entrer dans une saison neuve.
Paris derrière moi et sa brume, le train longe le ciel encore et toujours comme il le fait si bien, puis s’arrête à l’endroit où la lumière s’engouffre ailleurs : pendant une heure au milieu de cette interruption de toutes choses je regarderai ma vie déposée sur la vitre, et mon visage se faire peu à peu dans la nuit qui montait.

Du deuil qui s’ouvre alors, en faire le deuil aussi ? L’hiver achevé, qui pour le pleurer ? La terre froide est maintenant noire. Si le pays lance l’alerte à l’air pollué, c’est parce qu’il fait trop froid le matin et trop chaud le jour — le deuil impossible du froid.
Je tenais à la main sur le quai mon écharpe et mon manteau, dehors grandissait encore comme il le fait chaque soir, et je pensais à ce qui commençait, encore. Que la fin soit la plénitude même puisqu’elle ouvre à ce qu’elle-même avait achevé. Que les commencements dans l’odeur des cerisiers et des villes de trottoirs neufs lancent vraiment ce qui s’était amassé en soi, les plus grandes fictions, les désirs atroces et les joies pures. Que les merisiers plongent aussi profond dans la terre comme au ciel, sans autre raison que nos regards sur eux soudain. Que deuil l’hiver, et pour le porter, comme un crêpe noir, nos bras nus. Sur l’écran les lignes qui se suivent et s’enchevêtrent comme des câbles à travers les villes pauvres.
C’est dans les fins du jour qu’on reconnaît ce qui commence, et ce qui commence n’aura pas de fin maintenant, comme des révolutions qui peuvent bien échouer sur les corps enterrés, d’autres savent où plonger les mains et souffleront sur les cendres pour chercher la direction des vents, et dans la direction opposé courir.
-
la ville est impossible (ciels d’ouest)
jeudi 13 mars 2014

À l’ouest est une porte, là que les anciens disaient croire la mort et ils y croyaient tant qu’elle tombait sur eux, chaque jour quand le jour descendait.
Je garde pour moi les images des ruines sur lesquelles tombe le ciel, et peut-être le ciel tombe-t-il pour cela, pour elles et pour le sacrifice qu’elles implorent et que le ciel honore.
Dans cette ville, je me suis longtemps demandé pourquoi demeuraient vides le soir ces larges rues commerçantes près de la rotonde, alors qu’il y a tant de porches pour s’abriter du vent et dormir, ou dealer, ou rester là simplement. Hier, je suis passé, et, sur toute l’avenue, le désert. On passe par là mais quelque chose d’insupportable, de malsain, empêche de respirer ici et de rester longtemps : quelque chose d’imperceptible qui rend ces lieux si bondés le jour impossibles la nuit. Finalement, on m’explique, en rentrant du théâtre : ce sont les ultrasons, sans que je m’en rende compte, qui nous en chassent : comme c’est simple au fond. Même méthode que dans le métro ces bancs qu’on scinde avec des accoudoirs pour empêcher les hommes d’y dormir les nuits de grand froid. La ville est un espace bâti contre nous.
Contre elle, on possède le ciel et quelques ruines, voilà tout.
Contre la ville, haïssable et impossible à vivre, pas faite pour qu’on y vive (mais hors de laquelle on ne saurait vivre), on possède les lumières d’Ouest.
Je garde pour moi les légendes d’Angkor, qui faisaient de l’ouest une tombe, puisque le soleil y venait mourir, autant le rejoindre ; là-bas qu’on levait l’encens et les yeux à mesure que le soleil descend. Je garde pour moi, en partage, la lumière qu’il fait sur des ruines où l’Est est partout pour qu’on regarde à l’Ouest.
Là où le soleil descend est là où l’on vit — toujours le soleil ne descend qu’à l’endroit où il se pose sur nous. Si la mer vient le recouvrir, c’est une forme de ville. Où qu’on aille ici-bas, il y aura de l’ouest, c’est une grande leçon. On aura beau courir. On aura beau s’y jeter, et rejoindre la mer.
L’ouest est un grand trou avec des corps entassés qui sont nos rêves et nos désirs d’ailleurs, commencer par l’est est une façon de commencer la vie là où la tombe se retourne en berceau. Là où le trou dans lequel on plonge les yeux est de la terre noire retournée et fraiche, où les rois d’Angkor dorment et veillent la poussière qu’on emporte sous la chaussure jusque dans nos villes d’Ouest, qui relèvent de leur poussière et de nos insomnies.
Mots-clés
[1] grâce au