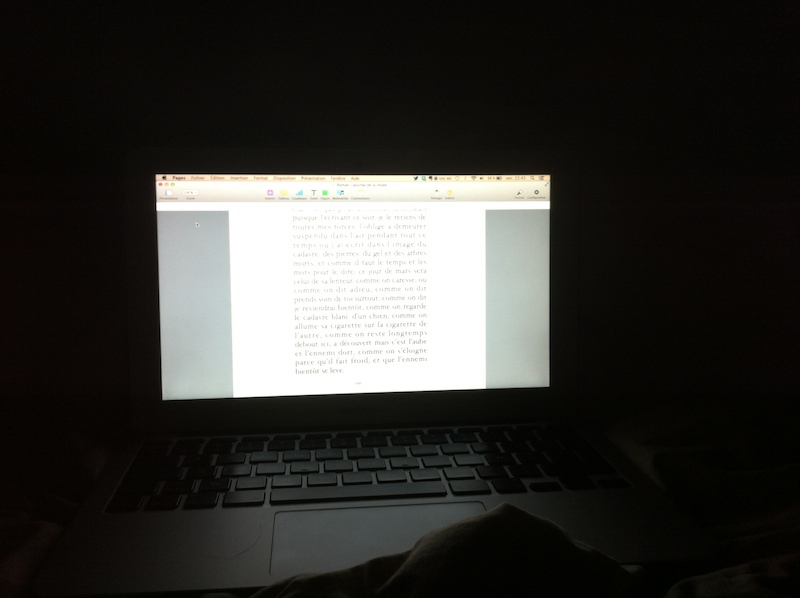Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
-
Quod scripsi, scripsi (les roumains)
mardi 4 février 2014

Ce sont surtout les cris, terribles, qui jaillissent du ciel, soudain et cessent immédiatement ; les gens s’arrêtent dans la rue, regardent là-haut ce qui se joue, et quand le silence revient, reprennent leur marche, et leurs parcours de vivants sur cette ville.
C’est signe que la mer est proche : elle est proche. Les hurlements des oiseaux dans le feu du ciel, personne ne me l’avait dit. Au-dessus d’un port, on ne les entend pas, mais ici : ici, c’est affolant.
Je pense à ces cris, pensant à la phrase de Rim. sans quitter le ciel des yeux et le prenant à la volée, à mon passage — ce soir, j’écrirai un peu contre lui, et ses pensées ; mais avant, je passe, traversant les cris, et regardant, dans les moments de silence d’où ils surgissent, et pourquoi.
Puis, je cherche les signes (ce jour-là précisément) — les relectures achevées (rapides), et l’écriture de nouveau (achever le visage de Casarès) par-dessus tout cela, dans ces mardis qui sont livrés au travail sur la page, à la fenêtre où je vois le temps passer comme il mord sur la façade de l’immeuble en face. Je ne trouve pas — une ligne après l’autre encore.
Je sors quand c’est impossible d’en avancer une autre.
Je fais le tour de quelques rues, et je rentre, il fait nuit, complètement nuit — sur le pas de ma porte, les cris des mouettes cessent, et à cinquante mètres derrière moi, une voiture heurte violemment une borne sur le trottoir ; des cris d’hommes, leur langue étrangère, si belle de l’être, je me retourne, croise le regard d’un vieillard qui rentre, le visage ravagé, je détourne la tête, il a déjà commencé à parler,
ce sont des roumains, ils sont très gentils.
je le regarde, je ne dis rien,
oh pardon, je vois que nous ne sommes pas de la même planète, au revoir.
et s’éloigne.
Je le retiens d’un mot, non, non, ce n’est pas ce qu’il croit, je ne sais pas ce qu’il croit, mais oui, sans doute le sont-ils, pourquoi croirai-je le contraire, au contraire, oui,
oui, ce sont des roumains, je les connais,
il s’approche de moi, très près,
ce ne sont ni des voleurs, ni des menteurs, ni des tricheurs, je les connais, rien, c’est leur voiture qu’ils viennent d’abîmer, mais ils sont très gentils,
plus près encore, je recule un peu, il parlera en souriant, plongeant ses yeux noirs au fond de mes yeux, avec douceur, et méchanceté, parlant avec élégance dans des accents de vulgarité, ou est-ce le contraire, appuyant certains mots comme qualités, ou comme dieux,
vous savez je connais des arabes, des noirs à montpellier qui sont des racistes, ils n’aiment pas les français, les blancs, et je dis : ce n’est pas bien, moi je viens de la Réunion, et les français, leurs valeurs, leurs gentillesse, leur qualités, je les aime, les français ce sont des dieux, voilà ; bonne année.
Il est déjà parti.
Mots-clés
-
Vincit qui patitur (la brume)
lundi 3 février 2014

Journée longue comme un arbre qui va s’effondrer.
En remontant le soir vers la ville, les affiches électorales, de nouveau, grotesques, dérisoires — quelque chose comme ce mot de foutaises, et pourtant, je pense (mais pourquoi ?) au Bachelier de Jules Vallès, et aux camarades qui dans Le Ventre de Paris s’assemblent dans ce petit café à Châtelet pour parler de la Sociale.
Grande mélancolie passant devant une banque en voyant un jeune garçon (mon âge peut-être), le visage mangé par une capuche, qui se réchauffe dans ce hall, à genoux, et attendra ici que la nuit passe si on ne l’en chasse pas ; nous croisons nos regards.
Vers la rue Van Loo, la noirceur des rues mal éclairées. Une très vieille femme descend des paquets par dizaines, les abandonne là : dedans, des jouets d’enfants.
Et le manque, d’être loin.
Toute l’après-midi à travailler sur les mots de Quai Ouest, tenter de dire les mots qu’il faut pour approcher la voix d’Abad, comme il garde le silence, et à qui il le garde, pour qui (et comment avancer sur le plateau avec ce silence-là ?). « Mais après ce que vous venez de dire, ce ne sera pas possible de jouer Abad ». J’ai répondu oui.
Il y avait du ciel à jardin, et cour, un immense ciel noir d’orage qui n’est jamais tombé.
Ensuite, achevé un long mail ce soir, à l’ami universitaire travaillant sur la morale de la beauté, pour Dans la solitude… — lui décrire lentement la brume dans le train, près des contreforts des Alpes, comme on la déchire, l’approche et ne la repousse pas, comme, en lui appartenant tout entier, on ne la voit pas, puisqu’on est en elle, son propre horizon : habiter cela, chaque jour, en faire une morale, oui (me décrire lentement cela à moi-même) — chaque jour y croire.
-
Camera obscura (les courses vives)
jeudi 30 janvier 2014

Cette phrase écrite il y a plusieurs jours sur une page de l’ordinateur, que je retrouve ce soir :
« Là où il y a un espace entre le sol des humains et les murs des humain, nous allons dans des courses vives à la recherche de nourriture ou de nos semblables »
Aucun souvenir de l’avoir écrite, de l’avoir lue, de l’avoir traversée en moi — et cependant ce soir, sa justesse qui foudroie.
Peut-être à cause du temps dehors et du temps passé à l’avoir perdu aujourd’hui, la colère : dehors, sa noirceur lourde d’une pluie qui est tombée toute la journée ; quand je ferme les volets, le bois est gorgé d’eau. Peut-être à cause de ce mot de semblables. Peut-être parce que tout à l’heure, devant les étudiants très tôt, j’ai parlé en regardant par la fenêtre disant les mots qui venaient et comme j’ai prononcé courses vives peut-être, intérieurement. Peut-être plus sûrement à cause de moi.
L’appartement est décidément impossible à chauffer : c’est la fournaise ou la glace, je choisis la chaleur — et face à la fenêtre, vue sur la façade aux volets fermés (une allégorie). Hier en rentrant, je suis passé par le Pavillon Vendôme — vide dans le soir. C’était magnifique. Je suis resté un peu. J’ai regardé des ombres passer sous les arbres, s’enfuir, c’étaient les ombres des arbres.
Vers quelles courses, vers quels morts ?
(Mon regard sur les plantes qui ici semblent mourir, mais semblent se battre — se battre de quoi, et contre quoi, et pour quoi ?)
Toute l’après-midi passée à des tâches du vieux monde, les papiers, les envois, les mails en retard (lu Jabès pourtant, pour l’émerveillement, la secousse ; pas assez). Et pourtant, je l’avais préparé en moi, ce jour : il fallait écrire les pages que je me devais — hier déjà, sensation d’un jour gâché ; et aujourd’hui encore.
Mais au réveil ce matin une phrase lumineuse que j’ai vite notée sur le téléphone, qu’il fallait prolonger, et ce soir la fatigue est plus grande que moi, alors je laisse là cette phrase, comme une plante à moitié morte et à moitié vive, sans raison d’une part et d’autre de la vie et de la mort, seulement là d’être là, et moi penché au-dessus d’elle, la regarde.
À quoi cela tient, cette vie ; des phrases notées à la volée entre deux portes battantes. Mais entre ces portes, l’air qui frappe, les appels, les serments, les désirs, les rues à emplir, les angles des villes, les routes, les trains et les montagnes, les temples sous la jungle, les chemins de terre mouillés, les désert où prendre froid, où brûler, et dans la course, ce que je perds sur la page, ce que je tâche d’agrandir — ce soir, je pense aux courses vives et je regarde l’ordinateur qui me semble vide des pages qu’il faudrait écrire pour mieux appartenir, pour mieux nommer, pour mieux désigner la beauté où elle est, et s’échappe ; ce soir, comme hier soir, je regarde la façade aux volets fermés en face, et pensant : tant pis pour moi, ce ne sera pas tant pis pour la vie.
Au pied du jour je dépose ce texte pourtant, mais quand je veux le regarder, c’est le ciel qui passe, miroite, s’efface, tremble et disparaît à mes pieds.
-
Tempora si fuerint nubila, solus eris (le sacrifice de l’ombre)
mercredi 29 janvier 2014
c’est un cri qui me réveille à trois heures, je me redresse sur le lit — le cri s’arrête : c’était le mien. Un mauvais rêve, voilà tout. (Un type entrait dans ma chambre avec douceur)
c’est le bruit de l’orage, six heures plus tard, comme un ventre dans le ciel, un raclement de gorge, un hurlement rentré qui parfois s’échappe, et dehors le jour noir comme je ne l’avais jamais vu ici, presque la nuit tombée alors que c’est le matin.
[i c i u n e i m a g e d u j o u r n o i r ] c’est jusqu’à midi où je travaille dans ce café minuscule, trois tables à peine, et moi seul avec le serveur, musique jazz et violente, les pages de l’ordinateur qui défilent sur la thèse déjà si ancienne et le visage de Casarès, qu’il faudra écrire aujourd’hui.
c’est en sortant du café, le ciel ouvert en deux, comme du miracle éparpillé, de l’eau partout sur de la lumière humide.



c’est l’après-midi durant, penché ainsi sur le visage de Casarès, espérant trouver ce qu’il faut de puissance décisive pour engager une vie, ces phrases de Barthes par exemple, dans lesquelles je cherche le regard de Koltès — et dans la suite des regards qui se détournent du mien, j’y cherche le mien, qui s’échappe davantage.
L’art de Maria Casarès possède le pouvoir capital de la tragédie : fonder le spectacle sur l’évidence de la passion. […] L’intonation, le geste, la marche, l’attitude sont à chaque fois risqués dans leur totalité, poussés si loin qu’il n’y a plus de place pour les fuir : le spectateur est lié par ce sacrifice de l’ombre, qui a lieu devant lui, sur une scène incendiée, où toutes les petites raisons du spectacle (coquetterie, cabotinage, belles voix, beaux costumes, nobles sentiments) sont jetées au bûcher, dissipées par un art qui est véritablement tragique parce qu’il inonde de clarté.[…]
c’est la phrase où le sacrifice de l’ombre résonne, comme un signe qui dure ; c’est la lumière et l’obscurité, c’est la voix que je n’entendrai pas et qui peuple certains parts du jour pour moi les plus précieux, c’est tout cela que j’écris cet après-midi, sur quelques pages que je rature au soir.
c’est sur la vitre devant laquelle je travaille, soudain un visage qui apparaît, le mien, lentement posé sur moi, qui résout le rêve de cette nuit, comme sa propre prémonition accomplie jusqu’à moi, qui ici l’accepte, et la reçoit, et va la traverser cette nuit encore.

-
a mari usque ad mare (la reliance)
mardi 28 janvier 2014

Elle était entièrement nue. Couchée sur le ventre, recouverte de quels rêves ? Le ciel, je sais comment le regarder, d’un seul coup et chercher le soleil pour le contre-jour, l’éblouissement semble ce miracle : ce qui permet de voir est ce qui aveugle, alors je ne reste pas longtemps les yeux plongés dans le soleil ; assez pour éprouver ce moment juste avant la douleur, et m’éloigner. Mais la mer ?
À cette distance la mer est à la fois tout le temps là, c’est le vent ; et si lointaine — la montagne paraît plus proche, et la ville partout. Mais à cette distance, la mer bat comme la possibilité de l’amour : s’y livrer est un serment.
Vivre auprès d’elle et ne pas s’y rendre — non. Tout à l’heure, je suis allé auprès, et au plus près même, jusqu’à pouvoir tendre la main.
Et rester un peu, là.
D’ici, on regarde l’Afrique.

Ici les cris de douleurs de Rimb. pour remonter à bord, je le sais bien. Mais ici surtout, la mer qui repose. Dans le dos, tout un continent, je suis à l’extrémité. À Brest (dernière escale avant New-York), on éprouve sans doute cela aussi — devant moi, c’est Carthage, je ne la vois pas, mais la touche des yeux.
La mer entièrement là, que j’apprends à voir chaque fois. C’est comme écrire : quelque chose d’impossible, poser les yeux sur ce qui au loin arrive sans cesse et ne rejoint pas, et qui est relié à ce qui de l’autre côté est invisible mais fait tenir le monde dans une seule main, ronde comme le corps du désir.
C’est comme y croire, lentement, croire que c’est possible, qu’il suffit de la voir pour la regarder, mais chaque fois, c’est toujours une déchirure, une puissante et joyeuse déchirure, qui permet les reliances. C’est s’éprouver de la terre et savoir que cette terre est de l’eau surtout, qui parfois surgit, parfois s’enfonce ; c’est être celui qui est de ce côté-ci des choses, où la vie l’a emporté ; c’est être debout, celui qui aurait traversé — mais quoi ? Devant la mer, on est toujours celui qui a traversé, ou va traverser.
C’est le contraire du manque : un pur désir.
Aller voir la mer souvent est une tâche de vivant — à cause du mystère, et à cause de l’évidence ; à cause de la nudité de la mer, du miroitement des apparences, du vertige de la profondeur qu’on ne mesure pas.
J’ai ce soir les lèvres gercées et je pense à la mer, je pense que c’est parce que je suis trop longtemps resté dans le vent et le froid, regarder la nudité, et mordu en elle jusqu’au sang le désir d’appartenir à ce regard.
Je suis venu seulement pour la saluer, rendre grâce au mouvement, y puiser le désir.
Au moment de partir, j’emporte une image avec moi — quand je la dépose ici, je remarque qu’un oiseau déchire l’image, s’éloigne, ou revient.
-
ô tempus edax (le viaduc)
lundi 27 janvier 2014

Au poignet me manque depuis ce matin la montre que je porte depuis quelques années — avant elle, j’en portais d’autres aussi, comme depuis que je sais lire l’heure sans doute : et depuis ce matin, c’est comme si je portais son absence, d’un poids plus lourd encore.
Ce n’est pas tant pour l’heure, je crois, que j’aime l’avoir à mon poignet ; je la regarde finalement peu : ma montre depuis trois mois était cassée, et je savais que je devais la laisser plusieurs semaines. Étrange comme on est possédé par ce qui finit par nous constituer, un corps étranger posé sur moi. Est-ce un geste ? Est-ce son absence qui manque, ou le manque qui a remplacé le geste ?
Le poids de la montre absente me démange, cette piqure d’araignée sur l’avant-bras de celui qu’on ampute, qui le grattera toute la vie, oui, à l’extrémité de son corps manquant — et surtout, dépouillé de ma montre, l’impression que le temps passera sans moi, passe sans que je lui appartienne, traverse mon corps malgré moi (cela relève aussi, peut-être, de mon refus de lire aucun journal depuis un mois maintenant, qui me coupe du monde).
Le temps détruit toutes choses, dit le latin — comme la vie m’a beaucoup changé, le temps lui même accomplit son effondrement pour se produire : et dans le mouvement des choses que j’habite, apprendre des gestes inconnus, comme par exemple : ne plus porter de montre. Via negativa de mes gestes.
Première nuit depuis trois soirs sans réveil : la lumière frappe mon visage ce matin dès huit heures mais je goûte à ce luxe, mesure la fatigue qui s’éloigne. Les cours à l’université battent maintenant le rythme des semaines régulières. J’ai eu envie de relire ce matin Notre Dame des fleurs en reprenant hier Le Condamné à mort — lire chaque soir une page de Genet avant d’écrire, oui.
L’après-midi, premier atelier de travail, salle très lointaine, il faut marcher longtemps, passer sous un immense pont, magnifique viaduc que franchit le train quand il enjambe l’autoroute. L’envie de travailler avec les étudiants sous ce pont, immédiate, pour lancer les mots de Quai Ouest, travail qui m’occupera tous les lundis. (De plus en plus, je crois que le théâtre ne peut être possible que dehors, quand le soleil tombe, qu’il faut crier). Je ferai lire le texte dehors, loin du pont, mais à cette heure du crépuscule et dans le froid pour que les mots soient plus serrés contre soi.
En rentrant, je passerai sous le viaduc dans la lumière du soir complètement tombée — le décor parfait qui n’en pas besoin (je pense à un immeuble que j’ai pris en photo hier à Marseille, sa façade dont la lumière était fascinante, au pied duquel j’ai imaginé regarder une tragédie en alexandrins, rien qu’à cause de la lumière, et des draps qui séchaient, de la butée de cette façade contre la ville) ; la semaine prochaine, il faudra essayer de lancer les mots contre ces murs ouverts, la parois des pierres noirs, le bruit des voitures rapides de l’autre côté du muret, la solitude de ce lieu, le désert tout autour, le froid et le désir des ombres de l’arbre où reposer son corps jeté dans l’Hudson River, l’Ogun, les passages à franchir entre soi et ailleurs où le temps ne battra qu’au rythme inventé pour soi-même.
-
entre (en silence la fatigue)
dimanche 26 janvier 2014
oui, entre

et

beaucoup de vent, et de fatigue, celle d’être en avance, celle d’attendre, de prendre possession des lieux, de regarder le plateau de théâtre vide, de le voir se remplir d’étudiants, de parler de Genet (de prononcer son nom), de dire les vers du condamné à mort (de s’en vouloir de ne pas les dire mieux), de regarder les étudiants chercher dans les gestes pour les faire, et les mots pour les dire, puis les trouver, de demander la confiance, d’aller regarder parfois vers le ciel ce qui reste de mer ou de ville, d’être fouetté davantage par le vent, alors de revenir, d’être plus fatigué, de passer la journée ainsi, dans les mots de Genet et sur le plateau pour les entendre et les dire parfois, voir les gestes se lever pourquoi, pour rien, pour cela, qu’ils se lèvent, nomment l’endroit où on les lève, d’être là, de voir le plateau se vider, de ranger les chaises et de se dire que cela fait partie du théâtre, de fermer la porte derrière soi après avoir longuement considéré la poussière remuée sur le plateau, de repartir puisque c’est le soir, d’attendre longtemps le bus à la gare, de repartir dans la nuit, de revenir dans le froid — de n’être pas assez fatigué alors de poursuivre.
(Peut-être est-ce la fatigue qui me tient éveillé moi aussi)
Ce soir, livre ouvert encore — pour demain je dessine à la main les plans des théâtres du XVII et du XVIII, des théâtres du Palazzio Vecchio, de la cour de Florence et de Venise, cherchant à comprendre où le Prince et où la foule — là peut-être (je fais un cercle avec le crayon sur une page chiffonnée, avec des triangles renversés) ; cela importe si peu ; ce qui importe, c’est la fatigue qui restera demain en moi pour dire avec des mots dans ma voix voilée par où l’infini passe quand on l’observe depuis une salle de théâtre, par où le fini déborde sur quelque chose qui nous observe et se replie sur nous pour s’ouvrir davantage, peut-être ; aurai-je assez de fatigue ?
(Avant de m’effondrer totalement, impossible de ne pas, pourtant, ouvrir mon Condamné à mort pour vérifier les vers, les lire à voix haute, doucement, faire résonner dans le silence de ma chambre leurs justesses, la déchirure [1].
-
il peut arriver que l’on s’impatiente un peu (zone de silence)
samedi 25 janvier 2014
Des cent quarante-huit images prises dans la journée, je ne parviens à en déposer aucune ici. Toujours des forces entre soi et le monde résistent, surtout quand ces forces sont le monde lui-même : s’y soumettre.
Je n’ai pas la patience d’attendre ce soir (ni la force de veiller davantage) — si je ne connais pas le mot qui dirait le contraire de l’attente, je sais la valeur de l’impatience.
Plus tard, peut-être.
Plus tard, je déposerai les images que j’ai arrachées au trajet de train, quand au matin je me suis placé sur la droite cette fois (toujours je me mets à gauche d’habitude, pour voir la Sainte-Victoire), à cause de la mer : alors ici imaginer entre deux tours d’immeubles écrasées par la ville, des reflets noirs et d’argents qui s’éloignent et reviennent avec la mer puisque c’est la mer elle-même.
Je déposerai aussi les images de cette inscription sur les murs de la ville, vers La Friche en poursuivant la route qui longe les rails (expulsons les riches) ; et l’image de la fresque de tag bleutée ; et l’image de l’œil immense qui encercle la porte et regarde le ciel ; et l’image de la Friche elle-même près des Grandes Tables, ses perspectives nettes entre les fenêtres.
Je déposerai aussi, surtout, les images prises sur les toits qui surplombent la ville et la mer mêlée, sans qu’on sache laquelle et l’horizon de laquelle, et la lumière qui là possède toutes les nuances de bleu, et plus tard, ici, couvre tout le spectre entre le rose et l’orange.
Des dizaines d’images sur les toits qui surplombent la ville et la mer mêlée.
Et sur le toit, ce potager : ici je déposerai les images de ce potager (c’est une installation artistique : à côté de pots de plantes (la mémoire végétale des toits), des pots de ciment et de béton, plantées d’étiquettes : en théorie, quelque chose devrait se produire ; ailleurs : ici pour le moment rien ne pousse ; ailleurs aussi : invisibles à l’œil nu ; ailleurs encore : il peut arriver que l’on s’impatiente un peu ; et encore : zone de silence.)
Au retour, près de la Gare Saint-Charles, ce bâtiment public : Institut de Mécanique : Statistique de la Turbulence.
Ou cette inscription sur un immeuble en ruine : AVENIR TELECOM (compagnie franco-indochinoise).
Ou ce carré de pelouse au bord de l’autoroute, avec des souches d’arbres coupées à ras comme s’ils allaient repousser (écrire sur ce carré de pelouse)
Enfin, en rentrant vers Aix, la fontaine aux corps dressés dans la noirceur.
Mais rien, ce soir.
Rien ou presque : seulement cette image de ce matin : l’aube qui ressemble à un crépuscule d’or, sa misère de fatigue avant que tout commence : ce jour qui se levait tombe ce soir à mes pieds, je le relève et le dépose ici — sur la trace effacée de tout ce qui a suivi, reste inatteignable ce qui a permis ce jour.
Mots-clés
-
légendes de mes corps morts (ciel noir d’images)
vendredi 24 janvier 2014
(Puisque ces jours sont impossibles, qu’à courir après eux je n’ai le temps d’arracher un peu de temps qu’en silence, entre deux trajets, et c’est seulement là, dans un bus, un train, une marche d’un bout à l’autre de la ville, que je peux écrire, intérieurement, les pages que je n’écrirai jamais sur des pages, mais ces pages je les porte en moi davantage peut-être que celles que j’ai écrites, alors je l’accepte.
Au temps j’arrache quelques images dont je rêve la légende, silencieuse, qu’ici je dépose pour moi seul — chaque image porte le rêve secret d’un récit manifeste, d’un roman qui serait le seul que j’aurais écrit puisque je ne l’écrirai pas ; je garderai d’eux seulement ce corps mort d’une image achevée sans mot sur le bord d’une page arrachée.)

aube comme un ciel sans nuages avec des nuages
ou se pencher vers la lune
et s’accrocher aux branches des arbres
vouloir recevoir l’aveuglement
peut-être lever les mains aux ciels, en célébrer le miracle
quelque chose là-bas éclatait comme une fleur
une montagne, enlacée par la lumière (envier la montagne et la lumière)
bordée d’écumes
mon visage, œil plus vert d’être traversé par la lumière traversant l’usine (autoportrait à Gardanne)
comme une trajectoire qui filait loin de sa trajectoire
ô amour, ô délices ! (Dans ton élan tu ressembles au palmier)(et toute la soirée, penché sur Genet, penser aux blessures secrètes, aux irrémédiables de la beauté fouillée avec les doigts et les lèvres et les corps levés pour elle seule, aux notre-dames et aux fleurs, aux splendides abjections qui rendent la honte honteuse et la mort morte vive au bûcher de vanités perdues, toute la soirée et davantage, penché sur Genet dans cette solitude qui n’en est pas une puisque je sais ce qui s’accroit en moi et à travers le manque, ce que la lecture de Genet rend essentielle : d’être l’appel à fermer le livre pour dehors, doucement, regarder le ciel ce soir noir d’un soleil qui a simplement changé de nom le temps de la nuit pour s’appeler nuit, et on croit que ce nom suffit pour croire que le soleil est de l’autre côté passé, moi je sais bien qu’il demeure, ce qui demeure, comme un visage s’endort et ignore qu’il est peut-être mort.)
-
ces jours singuliers (qu’on retient comme des caresses)
jeudi 23 janvier 2014

Le réveil ajusté au lever du soleil, il est presque huit heures et pourtant le jour était déjà répandu à grandes eaux sur les trottoirs et griffait sur la rue en bas ; la pensée soudaine en moi à ce qui vient de naître avec ce jour est une adresse ; une immense bouffée, oui, de tout ce qui me dépossédait d’ici et de maintenant, et me reliait plus loin à ce qui est, donne sens, me traverse — du vent peut-être.
Du journal que je tiens ici, je reste fidèle à la dictée du temps, simplement déposer ici ce qui lui revient, le temps battu, le temps qui prête corps et se délivre seconde après l’autre et remplit chaque jour, et que chaque jour soit traces et signes — qu’à chaque jour pourtant lui revient ceci : d’être dépôt d’une mémoire, le soulèvement du jour vers la nuit où il s’abat. Mais cette mémoire n’est rien, seul importe comment au présent je l’intercepte (et y cherche mon ciel comme un drap secret).
Pourtant dans l’épuisement vif de ce soir, sa joie simple, doucement déposée sur moi comme un don, et si grande qu’elle doit venir de plus loin que ce jour, peut-être des années, aussi nombreuses que les jours d’un seul mois, j’écoute, très fort, les notes répétées du About Today de The National pour me convaincre que ce jour n’est pas passé, et il n’est pas passé puisque je l’écris et le retient un peu, comme une caresse, encore un peu contre moi comme on est serré au milieu de la nuit, parce que la nuit n’est qu’à son milieu, et qu’il faut bien le passer, qu’on sera mieux ainsi.
Les journées pleines, quand je me retourne, me donnent souvent l’impression qu’elles n’ont pas eu lieu — les pages à écrire, pour travailler la matière du temps autrement, n’ont pas été écrites aujourd’hui ; à la place, encore et toujours le change donné à la vie sociale impossible à comprendre ; et pourtant, et pourtant elle a eu lieu, et je sais bien où, parce que j’étais la part vive de quelque chose qui m’est plus important que moi, que j’ignore, dont j’ignore la force et la portée, mais répond à la fatigue, répond au manque, répond au désarroi.
Ce matin, j’aurais parlé quatre heures d’affilées devant les étudiants à m’en casser la voix, un peu. Plusieurs fois j’aurais dit que l’histoire du théâtre n’est pas celle de ses ruptures, mais de ses seuils (je ne pensais pas seulement au théâtre).
Le soir, j’ai vu la ligne du jour mordre sur le ciel en montant sur la façade en face de mon immeuble à mesure que j’avançais le travail sur Jean Genet (phrases immenses [2]), et chaque heure je pensais à chaque heure qui m’approchait de la nuit, où ce jour finirait, je ne voulais pas, je voulais demeurer dans ce jour-ci précisément, pour le vivre davantage, y déposer ma pensée de chaque instant où je chérissais ce jour — comme chaque jour être à cette tâche, mais ici brûlant davantage, ici désirant davantage.

C’est étrange, les sortilèges de ces jours singuliers, comme on leur accorde une force, une joie. Comme on leur demande d’être simple sur la peau comme du soleil, comme de la nuit crue. C’est peut-être simple, aussi, d’être comme le jour grandi chaque jour d’avancer sur lui-même, et que la nuit recule elle n’en sera que plus noire, et plus désirable.
Ensuite, j’ai lu en silence des vers jusqu’à l’effondrement.
Mots-clés
[1] Dans Les Paravents, l’édition que je possède relève cette erreur : entre parenthèses, au milieu d’une parole, cette indication jugée impossible : il est écrit "en silence", au lieu, dit l’édition : de "un silence". Je veux croire qu’"en silence" est plus juste, qu’on peut, ainsi, dire les mots : la preuve.)
[2] _J’arrive dans l’amour comme on entre dans l’eau,
Les paumes en avant, aveuglé, mes sanglots
Retenus gonflent d’air ta présence en moi-même
Où ta présence est lourde, éternelle. Je t’aime.