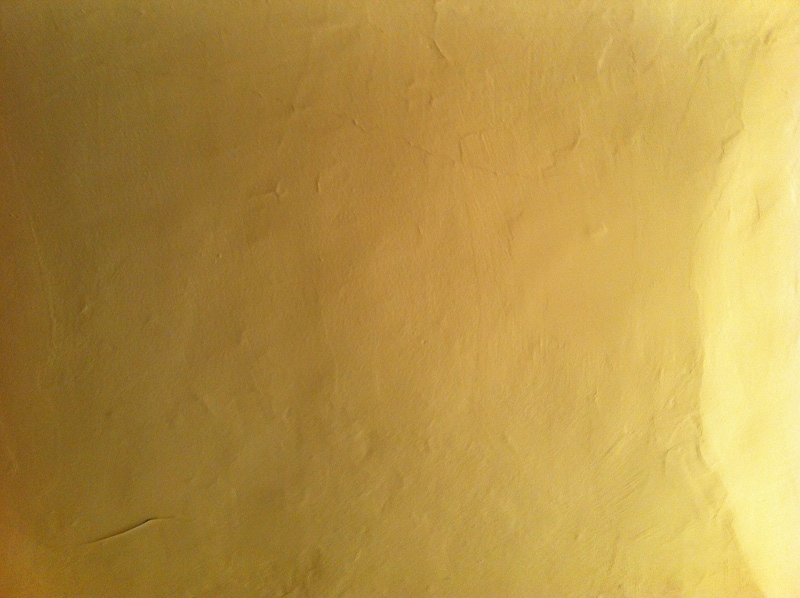Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)
-
mille passus meare (désormais)
mardi 25 février 2014

Marcher, ce n’est que tomber, un pas après l’autre, une jambe après l’autre lancer pour interrompre le déséquilibre. Aller, ce n’est rien d’autre que retarder la chute qui n’aura pas lieu. Devant la fontaine s’arrêter et les deux pieds posés sur le sol, attendre que la terre tourne encore un peu, à sa vitesse qui nous emporte sans qu’on s’en rende compte, amoureusement, et sentir contre soi non pas l’instant qui s’échappe, mais celui qui va venir, c’est certain, qui est déjà là, bientôt.

La plénitude ne vient pas après le manque, disait tout autour de moi le déséquilibre des forces ; la plénitude n’est pas la saturation des choses, la réalisation d’un gouffre ; mais plutôt, peut-être, la mesure admise de ce qui pour ce soir suffit — et chaque jour, c’est rejoindre le soir pour chaque soir abattre devant soi les cartes : est-ce que ce jour a suffi, et chaque jour dire, amoureusement comme mordre, et les cheveux humides dans le désir d’être celui qui tombe, dire que oui, s’abattre contre ce oui.

L’orgueil, c’était de vouloir être cette plénitude, c’était d’abolir le déséquilibre. Dans le chemin de dépouillement qui m’emporte désormais, j’ai appris le poids de ce mot, désormais, j’apprends encore. La plénitude est toute entière dans chaque seconde : s’y accorder, désormais, amoureusement. Quand je regarde le ciel maintenant, c’est pour refuser d’accomplir. Je ne sais pas, moi non plus, ce que veut dire "ça traverse" — je sais que j’y dépose une part de cette vie, la part vive, la part encore vivante ; désormais.
-
Spoliatis arma supersunt (passe d’armes)
lundi 24 février 2014

Trancher dans le vif d’une journée, essayer de la nommer. Ce matin, et jusqu’à ce soir, c’est l’expression passe d’armes qui vient. Elle est sur les journaux que je ne lis pas, mais c’est difficile de manquer les titres : en passant près du kiosque ils s’étalent comme du poisson mort. Une passe d’armes, l’expression convient bien avec ce jour — je crois que c’est, en escrime, ce moment où l’on croise le fer ? Aujourd’hui, c’est seulement pour évoquer des escarmouches de mots, où l’on n’échange que des mots, des invectives pour de faux et se jauger, de loin. Mais le bruit du fer qui touche le fer de l’autre, comme du matin l’aube et le midi déjà lourd du poids du soir, je l’entends — comme dès le réveil on sait le jour et qu’il faudra en affronter l’assaut et intérieurement s’en mesurer pour être là, et le soir surtout, avoir conservé suffisamment de forces pour engager d’autres assauts encore, plus sourds, avec soi-même : heureusement passant près de ce banc du Parc Jourdan, j’ai en moi cette phrase de Rodin, comme une arme.
Étudiez religieusement : vous ne pourrez manquer de trouver la beauté, parce que vous rencontrerez la vérité.Travaillez avec acharnement.

Lu hier cette phrase de Samuel Butler :
Définir, c’est entourer d’un mur de mots un terrain vague d’idées.En longeant cette route, je passe devant deux terrains : le premier, impeccable pelouse, le second, de la terre — les gamins toujours sont sur celui-ci, à tirer dans des buts vides comme pour jouer à jouer avec un fantôme.

Sur le pont qui enjambe, laisser passer le courant et sentir les forces de la vitesse traverser.
(an-jan-be-man) — Terme de prosodie. L’état ou le défaut du vers qui enjambe sur le suivant. L’enjambement est surtout usité dans la poésie familière ; ailleurs on ne l’emploie guère que pour produire un effet.Littré, admirable de mauvaise foi (plus loin Claudel : « Dans les derniers drames de Shakespeare le principal instrument prosodique est l’enjambement, la rupture de la phrase au milieu d’un membre logique, l’introduction de blancs, comme pour laisser passer un autre sens à travers le discours disjoint. »)
Au-dessus de l’autoroute, je regarde la sainte-victoire, impression qu’elle est grandie encore par le ciel qui se dégage et le vent, tout ce vent.

Non,
il n’y a rien dans le miroir
et avec mon reflet quand le cours est achevé, je joue avec le dehors un jeu de chaises musicales sans musique, et sans personne d’autres que moi et mon reflet qui cherche au-delà de moi ce que je suis les yeux fermés.

Un proverbe dit à peu près ceci
Si le corps est droit, peu importe que l’ombre soit penchée
et je me demande si le proverbe connaît celui qu’avait inventé Claudel (« Dieu écrit droit en lettres penchées »), et immédiatement, je me dis que je pense trop à Claudel, dans cet hiver qui ressemble à un printemps interminable.
Au-dessus du Parc Jourdan où je suis revenu pour vérifier les ombres, il n’y a que le mienne — passe d’armes avec les ombres des arbres, qui balancent lentement la vie qu’ils ne portent pas encore au bout de leurs branches, que je regarde.

Passe d’armes dans la ville que je remonte et sa fatigue ; à gauche : une arrière-cour que je veux saisir à cause de sa lumière bleue — à l’image la couleur est verte, pourquoi ? passe d’armes — ; à droite : un enclos pour recevoir une statue : vide (et l’inscription dont je ne peux lire qu’un mot "Bethléem", ville de naissance)
Passe d’armes encore.
Passe d’armes quand je rentre et que je veux tout noter, que je retrouve seulement ce mot de passe d’armes entre moi et la journée passée ; comme l’enclos vide d’une statue — vide que l’imaginaire doit faire naître, jour toujours vide que le jour doit combler pour en épouser la forme avant de se donner le jour : vide comme du désir de se donner au monde —, ou comme l’ombre des ombres dans les parcs noirs ou bleus, comme sur moi un corps neuf d’un autre jour.
-
ab irato (l’impitoyable)
dimanche 23 février 2014

J’aurais écouté Callous Sun dans une tendre rage ce soir, lentement pour l’apaiser en moi, ou pour éprouver davantage la lumière qui est si loin où je la respire, où je voudrais qu’elle soit.
J’aurais devant les pages rédigées tout à l’heure voulu souffler comme sur des cendres — tout qui se serait éparpillé.
J’aurais derrière moi quand la ville s’éloigne désiré retenir toute la vitesse du monde, et dire je reviens.
J’aurais remonté cette ville-là, dans le noir, et aux angles les tours de verre, tourner, et passer par le Cour les amandiers comme des branches mortes tordues, monter vers les étages, s’arrêter avant le ciel.
J’aurais voulu retrouver le passage de Pessoa qui m’aurait sauvé ce soir.
J’aurais regardé ensuite rapidement les images d’arbres en fleurs déjà, en réclamant du temps encore.
J’aurais eu du sang sur les lèvres, qui ne serait pas venu de la rage.
J’aurais pensé : pourquoi ces phrases, quand je les voudrais plus rapides sur le nerfs des choses, plus raides encore, plus vives sur la pente vive du réel, pourquoi quand je voudrais l’allure de l’effacement, cette pesanteur du mot qui ancre. Ma lenteur me désarme, celle qui s’écrit à chacune de mes phrases, celle qui conduit cette vie, celle qui tout autour de moi leste.
C’est un long chemin de la rage jusqu’à l’accepter ainsi, plus lente encore comme elle fait advenir ce qui apaise la rage et la relance.
J’ai retrouvé par hasard cette page, à cause de Callous Sun — je me demande ce qui me lie à ce garçon. (Tout).
Les pages que je noircis ici n’ont pas d’autres raisons, une mémoire retard qui efface le souvenir, en l’inventant. J’écoute Shannon Wright ce soir, en travaillant le cours de demain.
Il n’y a pas de rapport entre le ciel et la page que je lis, en dehors de moi qui est l’exacte intersection du ciel et de cette page, aurais-je pensé dans la rage encore.
(La colère de n’être pas ailleurs)
Des cheveux entre les doigts, comme un désir de moins, un de plus qui est toute la rage de tourner ces pages et ces jours et ces mois, et comme du maquillage coulé sur mon visage qui n’en aura jamais porté ; oh ce qui reste et restera toujours à force d’être lentement arraché.
Et quelque chose recommence.
-
In absentia (de quelque chose noir)
mardi 18 février 2014

Cinq heures du matin en sursaut, quelqu’un rentre dans la chambre (c’est personne, c’est le rêve, c’est l’absence de personne, c’est quelque chose dans le rêve qui appelle et réveille et ensuite empêche à la fois de se lever et de s’endormir). Une peur d’enfant. Et tout ce noir autour ; je tends la main et prends la photo. L’image est bleue.
Évidemment ce n’était pas un cadeau ordinaire. celui de me livrer, à cinq heures du matin, un vendredi, l’image de ta mort.
Pas une photographie.
La mort même même. identique à elle-même.
Je ramasse au pied du lit le livre de Roubaud que je voulais relire et dont je n’ai pas ouvert une page, hier — à la place, le Danton de Wajda, terrible et doux, devant lequel je me suis effondré. J’ouvre le livre qui s’est toujours un peu confondu en moi avec une autre élégie tendre et cruelle, le chant de Michaux de Nous deux encore [1] Le requiem de Roubaud pour Alix parle soudain de ce qui m’entoure, ce qui se recouvre, ce qui advient aussi du noir quand sur l’image il ne l’est pas, si noir — au contraire.
Gouffre pur de l’amour.
S’endormir comme tout le monde. ce que je veux.
Je t’aime jusque là.
De loin la bouffée de silence qui me vient est bouffée de lenteur de ce qui est loin, et dont je m’approche en pensées lentement, et je vais m’endormir dans cette pensée, tout à l’heure — mais pas tout de suite, pas tout de suite.
D’abord j’ouvre la fenêtre pour regarder dehors la ville morte elle aussi noire, noire de suie noire plus noire même — sauf la lune, qui vient poser les yeux sur moi.
De ne pas rester acceptant que tu n’es pas, le silence
Mais ignorant, ignorant ce que serait le contraire du rien de toi
J’écoute un peu de musique qui font danser les ombres, et reculer la nuit encore ; je m’y installe comme dans une maison étrangère. Je ne sais pas quelle heure il est et peu importe : il pourrait être deux heures ou six heures, c’est pareil : c’est la nuit noire, c’est cette heure-là, elle est une seule coulée de noir où je reste le seul éveillé sur la terre. Et la pensée du loin me tient vivant parmi les endormis.
Te nommer c’est faire briller la présence d’un être antérieur à la disparition
Le lendemain, je me surprends à posséder de nouveau une montre, après un mois sans — le temps bat la mesure du poignet, et avance sur moi à sa lenteur de tigre et d’éléphant, et je suis moi, à l’une des extrémités du temps, je ne sais pas laquelle ; non, je ne sais pas si cela commence, ou si je suis l’aboutissement de mon passé, je ne sais pas. Je regarde le mur sur le mur : il est d’une blancheur qui s’effrite. Je pense aux bouffées de silence encore, et de lointain.
Dehors il fait grand ciel et je m’en vais.
-
Tempora mutantur et nos mutamur in illis (se consacrer à la mesure du temps)
lundi 17 février 2014

J’attendais le titre de mon film idéal mais j’ai finalement décidé de seulement lui donner un nom, il fallait que ce soit bref, un mot court, très familier, j’ai cherché les noms les plus communément utilisés. Le nom numéro un était temps, et tout de suite je me suis sentie moins isolée, je n’étais pas la seule, tout le monde y pensait aussi. Le numéro deux était personne, le numéro trois année, le numéro trois cent vingt était futur. Le futur. Je n’avais pas eu l’intention d’écrire un scénario sur le temps, mais plus je mettais de temps à l’écrire à le faire, plus le temps devenait un protagoniste dans ma vie. […] Tout mon temps était consacré à la mesure du temps.
Miranda July, Petites annonces pour vie meilleure
Sur ma liste est couché le mot temps en premier, aussi, mais pas celui qui passe, pas celui qui s’en va qui s’éloigne, pas celui qui vient celui qui arrivera trop tôt, trop tard, pas celui qui se perd est perdu est la perte même de ce qui n’arrivera pas, pas celui qui est le temps des autres qu’on voit passé en passant lentement devant les tombes et les dates et les lieux et les portraits des vivants sur les stèles des morts, pas celui qui dit bientôt, après, avant, peut-être, viens, pas celui-là, et je pourrai continuer d’allonger l’ombre de mon immeuble sur l’immeuble en face tout le temps que cet ombre viendra s’y déposer pour la dépasser et la recouvrir avec la nuit, je ne pourrai pas faire autrement que de poser mes mains négatives sur ce que ne sera jamais le temps pour moi, et je sais bien, je sais bien que vivre est au contraire cette faculté de traverser le négatif sur l’image impressionnée du temps et de poser, devant soi, et pour l’instant accordé à son instant, une parole qui ne serait pas négative, et cependant je suis face à ce qui s’écroule et je reste debout il n’y a que des murs autour de moi et le temps qui demeure.
Je ne me souviens plus de la phrase de Kafka (Le bonheur, c’est de comprendre que la place que tu occupes ne peut être plus grande que ce que peuvent recouvrir tes deux pieds.), qui me semble désigner au plus haut ce que saurait être le temps, pour moi, mais comment le dire ?
J’habite dans cette ville depuis peu de temps, et les premiers mois, je n’arrivais jamais à savoir où vraiment était mon immeuble : dans cette rue, ils se ressemblent tous. Je m’arrêtais un peu avant, essayais ma clé sur une porte qui n’était pas la mienne, ou un peu après. Maintenant, je sais : je me repère à cette lanterne sur l’immeuble d’en face (celui qui me sert de cadran solaire quand je travaille à ma table, face à la fenêtre, que je vois la ligne d’ombre monter face à moi). Cette lanterne (comment l’appeler autrement ?) reconnaît les mouvements. J’aime aller lentement et passer sans qu’elle ne me voit. J’ouvre ma porte à l’aveugle. En pleine nuit parfois, elle s’allume (avant-hier, sous les cris et les pleurs et la rage de ce garçon (Maud reviens, toute la nuit) — je sais que quelqu’un passe, sur le pas de ma porte, que dans ce temps de la nuit quelqu’un veille, et s’éloigne, que nous sommes tous deux seuls peut-être à voir cette minute de la nuit la plus lointaine enfoncée en elle — jamais je ne saisis mieux le présent que dans ces heures.
J’écris cela et avançant chaque mot sans savoir quelle sera la prochaine phrase, je reconnais cependant combien alors, dans ce geste simple et ignorant, que je suis là au présent aussi, que toute ma vie m’aura conduit à ce mot là, que ce mot-là porte trace et poids de tout cela, poids qu’il faudrait évanouir pour ne retenir que la force légère d’une trace de pas dans la neige, qui court rejoindre la neige et d’autres pas. J’écris ce mot et je ne sais pas que le temps est déjà là.
Ce que je sais pourtant — ce savoir est tout ce que je possède — c’est que toute ma vie sera occupée à aller d’une seconde à l’autre, en prenant soin d’elle, et de chaque minute de chaque heure ; la lumière de la lanterne dehors s’éteint soudain.
-
Mihi cura futuri (et le ciel féroce)
dimanche 16 février 2014

rien d’autre que les pensées adressées.
sur ce toit quand je suis remonté tout à l’heure, j’ai revu le ciel, celui du soir hier qui tombait, et je suis resté là, un peu.
Le ciel est un tableau noir sinistrement effacé de minute en minute par le vent, écrivait à peu près Breton ; je sais que le ciel écrit aussi lentement l’effacement pour que je puisse voir à travers les lettres.
ce qui est précieux : tout ce que je possède est ce qui ne m’appartient pas, qui est loin maintenant — dans la fatigue de ce soir, plus que ce ciel pour l’appartenance déchirée.
Mais le passant passe et le ciel féroce reste sans orage. Grand ciel., écrivait à peu près Desnos ; je sais qu’il passe aussi sous le passant, et que sous l’orage il reste grand, pour que nous puissions prendre mesure du minuscule : que tient dans un regard aussi, pour que je puisse penser comme nous sommes devant toute une vie qui sera toute entière la nôtre.
le ciel est ce qui relie (je crois) ; ce soir pourtant, je cherche encore la lune, elle n’est pas là.
si je la trouve je sais que nous sommes là.
je sais que nous sommes là malgré tout, sous le ciel qui va se lever.
Le ciel tout engourdi, le ciel qui se dévoue n’est plus sur nous. L’oubli, mieux que le soir, l’efface. Privée de sang et de reflets, la cadence des tempes et des colonnes subsiste., écrivait à peu près Eluard, qui se trompe sur l’oubli, qui ne s’oubliera pas.
je m’effondre.
-
Aut viam inveniam aut faciam (un trajet)
vendredi 14 février 2014

Pour me souvenir de ce jour, je n’ai rien d’autre : quelques images prises à la volée du ciel, en passant vite entre deux portes, deux heures, deux moments où la ville s’ouvre et où je m’engouffre, je crois que c’est cela : une brèche.
Je suis la brèche elle-même, et le mouvement en elle, et la force d’en retenir quelques fragrances, quelques épars dans l’étoilement des choses, la lapidation des regrets, et sur tout cela pèse comme le sentiment de ce qui passe, et ne reviendra plus, et pour cette raison même : rendre grâce et se tenir prêt pour ce qui bientôt va passer de nouveau, d’autres violences si douces, des colères aux frondaisons de soi, des épaisseurs de signes, des voix qui ne se taisent pas en soi pour dire : je ne me tais pas en toi pour ne pas te perdre en route ; reviendra à la route de te disperser.
Cette phrase en latin qui dit : je trouverai le chemin ou je le percerai.
Je suis déjà la brèche, je suis le mouvement dans la brèche, je suis ce qui passe dans la brèche, je suis quelque part où je ne peux distinguer la brèche de ce qui coule en elle, comme des larmes, mais sans larmes, ce qui se répand dans le soir où je vais moi aussi pour rejoindre quelques ombres qui s’éloignent.
Je ne me souviens rien du jour mais quand je regarde sur l’appareil, quelques traces font signe d’une direction prise, d’une présence étrange, persistance d’un regard qui me regarde ; je les dépose ici pour m’inventer des souvenirs, je le sais bien.
Je les dépose ici parce que je suis incapable de faire autre chose : écrire sous ces images la légende minuscule qui ne parvient jamais à raconter d’autres histoires que celle-ci dans ces pages, où le jour est une image et quelques phrases sans mémoire qui inventent les territoires où je crois la vie possible.

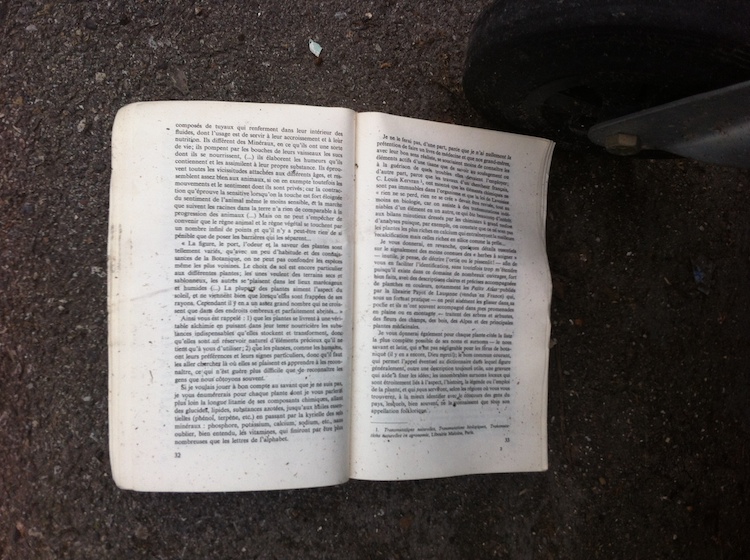

l’autre nom
c’est peut-être un autre encore ; les livres jetés ce matin — l’anti-oracle, les pages qu’on ouvre au hasard pour se lire ; ici couvertes de pluie et de poussière, de terre, traces de pas, rien.

le miracle
des bourgeons déjà lancés dans le jour ; je m’arrête longuement, je regarde ; je finirai par être en retard à mon cours ; quand je repasserai, l’arbre aura continué de pousser encore, et encore, par le bas et par le haut, infiniment minuscule, comme des cheveux sur son désir et rejetés en ailleurs sur le corps prêt à être enveloppé par le désir qui s’avance sur lui pour le mordre doucement, lentement, plus lentement encore, les terminaisons de l’arbre comme une force avance sur le terrain, gagne davantage d’espace sur l’occupant, finira par tout recouvrir, je m’en vais et presse le pas, je suis encore en retard pour mon autre cours.


le sud
on peut voir la mer d’ici, on peut la toucher (suffit de le rêver suffisamment) ; entre, l’escalier en colimaçon monte nulle part, et le soleil descend

le nord
des yeux je touche la route, et je l’emprunterai bien, remonter vers la Ville parfois, mais cette lumière.
Une merveille,
d’une beauté sans limites. Je ne verrai pas le film, mais près du cinéma, dans la foule, un couple s’enlace.
-
Respice finem (sous les hurlements d’oiseaux fous)
mercredi 12 février 2014

J’aurai marché lentement dans le soir. La lune est haute, presque ronde. À la verticale des arbres, elle semblerait tomber. Et toujours le cri des mouettes à la mort. Je me serai demandé pourquoi. En rentrant, j’aurai penché pour le soleil, parce que le soleil s’éloigne, elles hurlent. Ou ce sont eux qui le chassent, peut-être. Les mouettes chaque soir rejouent la cérémonie sacrée de la fin d’un monde qui recommence chaque soir de recommencer. Je serai rentré en ralentissant davantage pour en retenir la lumière, comme une leçon que je ne parviens à apprendre.
Cette phrase : non, je ne sais plus (il était question du rêve que dans le rêve on ferait : un reproche à celui qui ne sait pas rêver ses rêves dans son rêve, mais je ne sais plus, plus du tout).
Quatre jours, j’aurai repoussé les courriers en retard — alors toute l’après-midi aura été consacrée à cela ; sauf le soir, où j’aurai lu, longtemps. Et écris ceci, un peu. De plus en plus, j’ai l’impression que je n’écris que lorsque je n’ai pas le temps d’écrire. Il fait si noire dans la chambre ; seules les touches de l’ordinateur allumées me permettent d’avancer un mot après l’autre chaque mot comme des mains dans le noir, les mots pour le dire.
Et Threnody de Goldmund, qui remplit tout l’espace de cette chambre, et dedans moi.
Je ne pensais pas que m’affecterait autant la mort de mes plantes ; leur longue agonie. Mon hypothèse est que je leur ai donné trop d’eau ; la soif, à l’envers.
J’ai ouvert cette page parce que je voulais écrire ce qu’il y avait posé sur mon bureau, en pile, sous enveloppes, mais il n’y a rien à dire, alors j’ai parlé de la fin du jour et du cri des mouettes.
Seulement ceci — on écrit pour cesser d’écrire, oui, pour dehors être rendu au jour, oui ; pour que, après avoir écrit, on puisse de nouveau être cela, qui est rendu au jour ; et on recommencera d’écrire pour de nouveau infiniment être celui qui aura cessé d’écrire et qui pourra, lentement, rentrer sous les cris d’oiseaux fous qui en appelant le soleil le chassent, et le font tomber dans la mer.
-
Amor fati (changer le passé)
lundi 10 février 2014

Le vent immense, dont je mesure la force aux arbres sur les routes, arrachées, éparpillées.
La pluie si forte en torrents minuscules pentes sur les routes, qui dévalent ; j’attends à l’abri-bus qu’elle se calme, elle redouble, je sors alors et pendant une demi-heure affronte le déluge (je suis vaincu), je rejoins la salle où pendant six heures je parlerai de Quai Ouest, quand j’arrive la pluie cesse.
La phrase de l’étudiante dans son dossier : Changer le passé.
Rentrer, sans voix dans la gorge épuisée, par le chemin qu’indique le téléphone par l’itinéraire automatique : découvrir des routes inconnues dans cette ville qui ne l’est déjà plus : quand on emprunte tous les matins et tous les soirs les mêmes trajets, on l’épuise vite ; ce sont là cependant des murs vierges, où je m’enfonce.
Sur le sol une ombre gigantesque répandue à mes pieds qui recule à mesure que j’avance, dans ma nuque un souffle, je presse alors le pas, l’ombre toujours là, qui semble s’approcher puis s’éloigner, je presse davantage, cours, cours ; c’est la mienne, et le vent.
Avoir prolongé l’hébergement du site il y a trois jours ; recevoir un message disant qu’il expire demain.
La voix du maire de cette ville qui a vu une montagne s’effondrer sur un train qui passait là toutes les trois heures : c’est simplement le destin
Cette chanson de Damien Rice dans les oreilles ce soir (Rootless Tree)
Une phrase dans le dossier d’une étudiante : Changer le passé.
Écrire ici une première fois un texte et le perdre entièrement en raison d’une coupure de connexion. Le sentiment d’avoir tout perdu ; tout réécrire — chasser le fantôme du texte premier, ne jamais le trouver, sauf l’inconsolable perte qui a permis de réécrire.
-
Sit tibi terra levis (je veille)
mercredi 5 février 2014

Ce sont de grandes pluies, sur fond de ciel complètement évanoui, entre nous et lui quelque chose qui appartient à la déchirure, et le long d’elle s’écoule la peine qu’il faut pour la rejoindre, comme des larmes sans cesse, sur fond d’aucune tristesse — cette phrase que j’entends pour la première fois, comme une émotion comme éprouverait pour la première fois :
« La douleur est comme une souffrance qui n’a trouvé personne pour la vivre »

Je marche le long de cette pluie, et à travers elle et sur elle, et sous elle où je ne me cache pas pour aller, je vais ; au matin, c’est des secousses, et en moi, rien que la pensée d’adresse à ce qui manque.

D’écrire ces derniers jours les naissances d’un désir d’écrire et de chercher encore et encore où naître, et où choisir d’où aller, m’occupe le temps qu’il faut pour passer le jour et la nuit et la nuit devient une part du jour que je veille.

Le soir quand il est ce soir où la nuit est d’une noirceur de chat, je regarde les photos prises : quatre seulement — l’aube (les milliards qui insultent et l’amour au loin), le midi (flou et involontaire), l’après-midi (bleu soudain comme un corps à travers les cheveux), le soir (de feu et de rage douce).
Dans la musique de Philipp Glass, je pose mes mains dans ce noir qui recule à mesure que j’avance ; est-ce moi qui le repousse, est-ce le noir qui s’éloigne ? Si j’avance, ce n’est pas à cause de moi ni du noir, mais de la déchirure, qui s’ouvre davantage. Si j’ai écrit ce soir, ici, dans ces carnets arrachés, c’était pour parler du vent, et à cause de cette image de la terre et des ventsqui s’arrêtent aux rochers des rives, et je réalise que je n’aurais pas même prononcé son nom de vent éparpillé dans le vent tandis que j’avance et rejoins.
Mots-clés
[1] Les années ont été pour nous, pas contre nous. / Nos ombres ont respiré ensemble. Sous nous les eaux du fleuve des événements coulaient presque avec silence. / Nos ombres respiraient ensemble et tout en était recouvert.